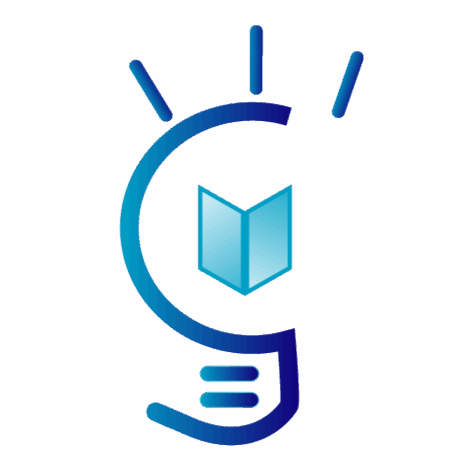INTRODUCTION
L’humanisme est un mouvement littéraire et culturel du XVIème siècle ; il rassemble des penseurs qui mettent l’homme au centre de leurs œuvres et de leur réflexion. Cette foi qu’ils mettent en l’homme se trouve cependant mise à mal par les crises de l’histoire, notamment les guerres de religion. Les humanistes se réclament par ailleurs de l’antiquité gréco-romaine tout autant que des histoires bibliques dont ils cherchent, la découverte de l’imprimerie aidant, à mettre les textes à la portée du plus grand nombre. En fait, d’un point de vue littéraire, l’humanisme peut être résumé à travers trois grands mots d’ordre :
– la diffusion de la connaissance
– la référence à la culture antique
– l’intérêt marqué pour l’individu
Comment ces principes ont-ils influencé les thèmes et les genres dans la littérature humaniste ?
I. LA THEMATIQUE HUMANISTE
Le premier, c’est le thème de l’éducation. Les humanistes ont confiance dans le caractère perfectible de la nature humaine. Raffermir le savoir, éduquer l’individu en général, l’enfant en particulier, revient donc à faire progresser l’humanité toute entière. Si au XVIIème siècle on parlait de l’honnête homme, cet homme très mesuré dans ses moins faits et gestes, l’humaniste en est le père. Nous le rencontrons par exemple dans l’étoffe de Pantagruel, à l’instar de cette fameuse lettre que son père Gargantua lui avait adressée lorsqu’il se trouvait à Paris pour des études supérieures : « science sans conscience n’est que ruine de l’âme », lui disait-il, entre autres règles de vie.
Le deuxième, c’est l’altérité. En effet, la découverte du nouveau monde, les Amériques entre autres, grâce aux caravelles, a engagé l’Europe à rencontrer cet « autre » dont les mœurs et la religion sont si différentes. Sur ce sujet, les humanistes engagent leurs contemporains à la tolérance et à concevoir cette variété plus comme un enrichissement que comme source de polémiques, de mépris, de déconsidérations.
L’idéal de pureté constitue un troisième thème clé. En littérature, il s’agit de revenir aux textes originaux de l’Antiquité. Ces anciens auteurs deviennent des références, des modèles de perfection dont il faut s’inspirer des œuvres, selon les humanistes. Sur le plan religieux, les évangélistes prônent un retour à la parole biblique authentique et les protestants veulent rénover la morale chrétienne. C’est justement ce qui fera naître cette guerre meurtrière et sans précédent des religions.
Dernier thème enfin : la nature. Elle reste la mère des hommes et, comme telle, est donnée en modèle. Les peuples dits sauvages l’ont bien compris. Ils méprisent les artifices de la civilisation et vivent en harmonie avec le monde naturel.
Toujours est-il que ces thèmes de l’humanisme sont indissociables des principaux genres littéraires prisés à cette époque.
II. LES GENRES LITTERAIRES EN VOGUE
C’est important de connaître les principaux genres de ce mouvement.
1. LA POESIE
Sous l’impulsion des mécènes de renom, à l’instar du roi François 1er lui-même, la poésie s’impose comme le grand genre de la Renaissance. Clément Marot, à la suite des grands rhétoriqueurs, se livre à des jeux savants de rimes inspirées pour la plupart de la littérature italienne et espagnole. Louise Labé et Maurice Scève (représentants de l’école de Lyon) font de l’amour et de ses souffrances un de leurs thèmes de prédilection et témoignent par là que l’existence d’une littérature lyrique ne date pas d’hier ; Ronsard, prince des poètes et poète des princes s’est d’ailleurs beaucoup inspiré de sa vie intime pour composer ses trois célèbres recueils poétiques dédiés chacun à une femme aimée : si Cassandre de Salviati lui a inspiré les Odes (de 1550 à 1552) et Marie Dupin Les Amours (de 1552 à 1578), Hélène de Surgères lui aura inspiré un recueil de sonnet portant le titre sans ambiguïté de Sonnets pour Hélène (1578). Agrippa d’Aubigné (auteur protestant) donne à la poésie engagée ses lettres de noblesse dans Les Tragiques, chef-d’œuvre paru tardivement en 1717 à cause du contexte de crise. Cette guerre opposant catholiques et protestants, cette longue guerre insensée dont l’apothéose s’exécuta lors du massacre de la Saint Barthélemy (1570), fut une des pages sombres de trente-six années de conflits entrecoupés d’édits, de l’histoire de France. L’incontournable Pierre de Ronsard (auteur catholique) s’y est également consacré à travers Les Hymnes (de 1555 à 1556) et les Discours de la misère de ce temps (de 1555 à 1564). Par ailleurs, la Pléiade quant à elle, (Ronsard et Du Bellay en tête), participa activement à la « Défense et illustration de la langue française », en promouvant une poésie en français nourrie aux sources gréco-latines à même de faire accéder ces auteurs à l’éternité.
2. LA PROSE
Le genre narratif oscille, lui, en brièveté (la nouvelle) et prolixité (le roman). D’une part, la nouvelle donne dans la veine réaliste ; c’est le cas dans l’Heptaméron (1558), ce récit en sept parties et composé d’un recueil de soixante-douze nouvelles correspondant à sept journées, publié par de Marguerite de Navarre en 1559 largement inspiré du Décaméron de Boccace. Mais ce condensé est dense dans la mesure où le discours polyphonique révèle beaucoup à redire et empêche de se faire une idée précise sur la pensée de l’auteur qui virevolte entre l’amour idéalisé et l’amour charnel, la saveur des textes sacrés et les abus au sein de l’Eglise. D’autre part, l’œuvre romanesque célèbre de François Rabelais met en scène deux géants qui donneront naissance, et tour à tour, à deux héros éponymes : Pantagruel (1532) et Gargantua (1535). Souvent comique tout aussi que grotesque, le récit de leurs aventures chevaleresques vote aussi pour une initiation à la sagesse. Ce gigantisme incarne métaphoriquement l’appétit de savoir (« abîme de sciences ») auquel s’adonne l’humaniste sans s’économiser. Le Tiers Livre (1546) et Le Quart Livre 1548) n’en diront pas moins.
3. L’ESSAI
À la frontière des genres, il faut ajouter les Essais (1580) de Michel de Montaigne. C’est une œuvre qui embrasse les sujets les plus divers sur lesquels l’auteur s’essaie, c’est-à-dire met à l’épreuve ses jugements, ses réflexions philosophiques loin de toute certitude. C’est pourquoi un essai peut être partisan ou polémique. Cette liberté d’expression donne ce genre littéraire son caractère engagé mais il séduit aussi car si le style peut paraître violent, il offre quand bien même une grande variété d’expressions, allant du monologue à l’argumentation, en passant par l’information, la critique, la description, le portrait, la narration, l’anecdote, la maxime, l’illustration, le dialogue simulé… Toute cette palette au service de l’écriture offre donc une diversité qui donne libre cours à la pensée philosophique sur ce siècle riche en événements et en sujets de conversation sur l’humaine condition.
CONCLUSION
Ainsi, l’humanisme voit le jour à la Renaissance mais trouve nombre de ses principes dans l’Antiquité. Au-delà des doutes que font surgir les conflits religieux et coloniaux, il affirme une confiance nouvelle dans l’humaine condition à laquelle il consacre ses travaux et qu’il célèbre dans ses réalisations.