Exercice d’application sur la dissertation littéraire
Sujet3 : Selon Jeanne Bourin « un livre de poème n’est rien d’autre qu’un cœur ouvert »
Dans un développement organisé, vous discuterez : en montrant d’abord que la poésie est liée à l’expression des sentiments personnels ; ensuite en expliquant que la finalité de la poésie se traduit alors dans sa capacité à analyser des problèmes sociaux ; enfin en prouvant que la véritable fonction de la poésie est de valoriser la recherche de la perfection personnelle.
I. Compréhension
1. Première lecture : lecture compréhension
a. Contextualisation.
Dans ce sujet, la contextualisation c’est l’auteur de la citation à savoir Jeanne Bourrin. Elle est une écrivaine française née en 1922. Elle est connue pour ses romans historiques mais aussi pour son goût sur la poésie dont le chef-d’œuvre est intitulée Les plus belles pages de la poésie française, 2008. L’information qu’on pourra retenir et qui viendra effleurer le sujet soumis à notre réflexion est qu’elle a pris en compte toutes les fonctions de la création poétique française dans son œuvre y compris celle lyrique.
En témoigne cette citation « La poésie, c’est beaucoup qu’une forme littéraire, c’est la traduction anoblie de nos émotions, de nos rêves, de nos peines, de nos désirs. A travers le langage soudain magnifié, nous atteignons à la source de ce qui nous fait agir, penser et croire » (Bac 2000). Donc notre sujet est placé sous l’angle de la poésie lyrique, personnelle.
b. L’opinion
Nous tenons ici pour opinion, tout ce qui se trouve dans entre les guillemets :
« Un livre de poème n’est rien d’autre qu’un cœur ouvert »
Thème : un livre de poème : Poésie
Prédicat : « …n’est rien d’autre qu’un cœur ouvert »
Problème : la fonction lyrique de la poésie
c. La consigne
Nous avons ici la forme des nouvelles consignes améliorées qui consiste à dégager visiblement le plan :
D’abord : vous développerez la fonction lyrique de la poésie
Ensuite : vous expliquerez la fonction sociale de la poésie
Enfin : Vous montrerez que la véritable fonction de la poésie est l’esthétique.
2. La deuxième lecture : lecture analyse
Analysons les mots clés.
Livre de poème : la création poétique,
Cœur ouvert : une sorte de métaphore qui substitue les sensations du cœur, c’est-à-dire l’expression des sentiments personnels : cœur sensible ≠ cœur insensible, fermé, impassible.
Reformulation : La création poétique n’est rien d’autre que l’expression des sentiments personnels.
Problématique : la poésie est-elle uniquement lyrique ?
Ou quel est le véritable rôle de la poésie ?
3. Troisième lecture : contrôle/évaluation
On doit vérifier si l’auteur ou la consigne nous propose des arguments ou des grands axes. Dans ce sujet ci-dessus, nous avons dans la consigne des grandes lignes : fonctions lyrique, sociale et esthétique de la poésie.
II. Dissertation traitée entièrement pour donner une idée aux élèves.
1. Introduction
Schéma de l’introduction
o Amorce du thème par ses origines
o Rapport logique avec le sujet (situation restreinte)
o La reprise du sujet (le sujet est court)
o La reformulation
o La problématique
o Le plan
La poésie fut à l’origine un genre lié à l’oralité. Elle a été utilisée par les peuples pour expliquer les réalités du monde, les histoires des peuples et des civilisations. Cette tradition est déjà perceptible chez les aèdes (poètes de l’Antiquité grecque), chez les troubadours et les trouvères (poètes du Moyen âge), qui chantaient, par l’usage des ressources du langage, leurs sentiments personnels. Cet élan de la poésie lyrique trouve son siège dans les méandres d’un cœur en mouvement. C’est probablement dans cette dernière perspective que nous devons ranger ces propos de Jeanne Bourin qui déclare qu’ « un livre de poème est un cœur n’est rien d’autre qu’un cœur ouvert ». En termes plus clairs, la création poétique est par essence l’expression des sentiments personnels. N’a –t-elle pas d’autres finalités ? Ainsi, pour une meilleure analyse de ce sujet, il conviendrait d’abord de montrer que la vocation réelle de la poésie est de traduire les sentiments personnels ; ensuite d’analyser que l’essentiel de la finalité poétique est de prendre en compte les maux de la société quels qu’en soient la nature ; enfin nous démontrerons que le véritable rôle de la poésie est de rechercher la perfection formelle.
2. Développement
Schéma de l’analyse
Phrase de présentation
a. 1e partie : la poésie lyrique
Argument1 : l’exaltation du moi du poète…
Argument2 : la poésie comme communion avec les éléments de la nature.
Conclusion partielle + Transition
Phrase de présentation
b. 2e partie: la poésie sociale
Argument 1 : la poésie un moyen de dénonciation
Argument2 : la poésie altruiste qui enseigne la société.
Conclusion partielle + Transition
Phrase de présentation
c. 3e Partie : la poésie esthétique
Argument1 : Poésie comme recherche de la perfection formelle.
Argument2 : l’impassibilité de la poésie (l’impersonnalité)
Conclusion partielle
NB : n’oubliez surtout pas la présentation de la copie avec le saut des lignes, le respect des alinéas etc.
On a remarqué que certains considèrent la poésie comme non seulement une expression des sentiments personnels grâce au moi du poète, mais aussi comme une sorte de communion avec les éléments de la nature.
D’abord, retenons que la création poétique est profondément liée au lyrisme personnel, c’est-à-dire l’expression du moi. En effet, pour les défenseurs de cette thèse, c’est de cette dernière perspective qui permet à la poésie d’avoir une dimension hautement personnelle, voire même subjective. Ainsi, pour refléter les méandres et les mélancolies qui rongent son cœur, pour manifester ses angoisses personnelles ou ses joies profondes, le poète utilise et mobilise toutes les ressources nécessaires pour mieux représenter le miroir de son for intérieur. Une telle attitude fait de ce dernier une personne égoïste, égocentrique d’autant plus qu’il ne fait que s’occuper de ses seules préoccupations au regard des autres. Il exclue alors dans son œuvre poétique cet acte altruiste qui aurait dû l’attribuer cette dimension d’altérité ou d’humanité. D’ailleurs, c’est cet égo qui amène aux poètes romantiques à crier sur tous les toits, partout où besoin sera, leur « mal du siècle ». Alors, le poème, sous toutes ses formes, devient l’instrument privilégié d’expression et d’exploration de cette complexité des rapports inédits du moi et du monde. C’est la raison pour laquelle le poète romantique se reconnaît d’abord à ce qu’il dit « je » et qu’il revendique l’usage de cette première personne comme le signe de sa spécificité littéraire. Ainsi, le moi, sujet et objet du poème, tel est désormais le signe de reconnaissance premier. C’est dans cette mouvance que, à propos des Méditations Poétiques, Lamartine écrit : « Je n’imitais plus personne je m’exprimais moi-même pour moi-même. Ce n’était pas un art, c’était un soulagement de mon propre cœur qui se berçait de ses propres sanglots.». On voit clairement, dans cette approche de Lamartine, la primauté du moi souffrant qui s’exprime pour soi-même. S’inscrivant dans la même dynamique, Alfred de Musset écrit en 1831 : « Ce qu’il faut à l’artiste et au poète, c’est l’émotion. Quand j’éprouve, en faisant un vers, un certain battement du cœur que je connais, je suis sûr que mon vers est de la meilleure qualité que je puisse pondre… ». Ainsi, on conviendra avec ces derniers que la poésie est le miroir du cœur ouvert à toutes les sensibilités humaines.
En outre, une telle perspective est élargie par d’autres préoccupations personnelles comme la communion avec la nature, source de consolation, de médiation et d’évasion. Comme tout artiste, le poète a besoin de promouvoir sa poésie en tenant compte des éléments de la nature qui l’entoure. De par ses caractères paisible et sauvage où les chants des oiseaux, les vagues de d’eau remplissent les cœurs des poètes, la forêt devient un lieu de refuge pour un certains nombres des écrivains romantiques. Ces moments solennels des rencontres témoignent de la prolifération des livres de poèmes évoquant la nature, berceuse des âmes angoissées. Ainsi, un tel mariage entre poète et nature trouve son expression en général à travers ce grand courant de la sensibilité dénommé le romantisme. A cette époque, le lyrisme personnel était à la mode et les poètes n’avaient pas manqué de témoigner leur gratitude envers cet univers qui leur offre des joies communes ou des sentiments mélancoliques. D’ailleurs, ce que l’on retrouve dans les Méditations Poétiques de Lamartine ; une œuvre dans laquelle on peut lire un texte poétique très intéressant évoquant le désarroi du poète qui s’est fait poser un lapin par une de ses amantes Julie Charles dénommé Elvire à qui le destin impitoyable à arracher de son affection amoureuse. Pour se consoler, il prend en témoin le « Lac » qu’il rappelle en ses mots :
«Un soir, t’en souvient-il ? nous voguions en silence ;
On n’entendait au loin, sur l’onde et sous les cieux,
Que le bruit des rameurs qui frappaient en cadence
Tes flots harmonieux ».
En prenant le « Lac » » comme compagnon de dernier recourt, le poète le confie, alors, ses souvenirs afin de pouvoir immortaliser ces heureux moments passés avec sa bien-aimée. C’est aussi une manière d’ouvrir son cœur au lac, car la confidence pour lui demeure une thérapie qui dissipe les douleurs aigues. Un autre poète du nom de Verlaine ne s’est pas démarqué dans cette logique, car, envahi par un sentiment de tristesse, le poète nous livre son poème en rapport avec la saison d’automne, symbole de la langueur et de la tristesse. Ainsi, dans Poèmes Saturniens, « Paysages tristes », le poème intitulé « Chanson d’automne » illustre bien cette conception :
Les sanglots
Des violons
De l’automne
Blessent mon cœur
D’une langueur
Monotone.
Ainsi, cette monotonie du cœur de la vie de Verlaine est à l’image de la saison d’automne ; une saison qui rend non seulement triste aux poèmes, mais devient un thème récurrent qui traduit leur mélancolie. Donc, l’évocation des éléments de la nature demeure un motif pour mieux exprimer ses sentiments personnels.
En résumé, nous avons vu, à travers cette analyse précitée les manifestations du lyrisme personnel. Pour mieux traduire ses sentiments, le poète s’ouvre à lui-même de manière subjective avant de pouvoir trouver ses forces à travers les éléments de la nature, lieu de prédilection des romantiques. Cependant, force est de constater que cette attitude égoïste est blâmable, car pour certains, la poésie ne doit nullement être assujettie à des égos personnels, mais plutôt elle devrait être un instrument de dénonciation et de stabilisation.
La création poétique a toujours été une option choisie par les poètes pour traduire les préoccupations des sociétés en leur offrant une possibilité de prendre conscience sur leur sort, mais aussi en leur apportant des solutions favorables à leur épanouissement.
Etant l’expression de la société qui l’a vue naître, la poésie n’a nullement manqué de hausser le ton quand ce dernier est opprimé. Ainsi, face à un monde désordonné, un monde où les valeurs cardinales sont aux antipodes de la morale sociale, les poètes se font toujours les échos sonores de leur peuple. Par de là, la poésie cesse d’être une fin en soi pour devenir un instrument de dénonciation et de protection. Elle se mue selon les impératifs du moment. C’est probablement ce qu’a compris le poète romantique répondant du nom de Lamartine ; pour qui le poète a le devoir et l’obligation d’oublier son art quand la partie est menacée dans réponse au Jeune Barthélemy, dans l’hebdomadaire « La Némésis », qui l’accuse d’avilir sa poésie par ses ambitions politiques. Ainsi, déclare-t-il « Frère, le temps n’est plus où j’écoutais mon âme/ Se plaindre et soupirer comme une faible femme ». Donc devant l’urgence brulante, le poète oublie son égo pour devenir un soldat défenseur de son peuple comme l’a si bien compris aussi le mythique poète Victor Hugo qui, dans Les Châtiments (1853), plus précisément dans son poème « O Soldats de l’an deux ! », déclare que : « J’aurais été soldat si je n’étais poète.». Ce militantisme est salutaire, car il permet aux poètes d’avertir le peuple sur les dangers qui menacent la cité. Ainsi, c’est la raison pour laquelle qu’on a ces illustrations susmentionnées qui témoignent une fois de plus la mission salvatrice du poète vis-à-vis de sa société. D’ailleurs, c’est ce qu’a compris très tôt le poète surréaliste Paul Eluard qui disait à l’époque que « Le temps est venu où tous les poètes ont le droit et le devoir de soutenir qu’ils sont profondément enfoncés dans la vie des autres hommes, dans la vie commune ». Par conséquent, c’est de par leur courage que les poètes arrivent à relever le défi quels qu’en soient les risques encourus.
Par ailleurs, certains poètes se donnent comme objectif premier de guider leur peuple en leur offrant des joies de vivre. Considéré comme un démiurge, un mage, le poète se donne toujours toutes les ressources et les moyens que dispose la poésie pour satisfaire sa communauté. Un rôle qu’il considère comme nécessaire ; car l’ignorance négative dévie le peuple du droit chemin. C’est de cette manière que beaucoup de poèmes ont vu le jour, rien que dans l’optique d’être aux aguets pour guérir les maux de cette communauté vivant dans les ténèbres. Une telle position est saluée par le père de la littérature engagée, Jean Paul Sartre quand il nous dit que « la fonction de l’écrivain est de faire en sorte que nul ne puisse ignorer le monde et que nul ne s’en puisse dire innocent ».Il veut signifier qu’il est du devoir et de la responsabilité de l’écrivain d’informer sur les péripéties de la société. Ainsi, dans son œuvre Cahier d’un retour au pays natal (1939), Aimé Césaire qui, se portant garant comme étant le porte-parole de son peuple, déclare que « Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n’ont point de bouche ; ma voix la liberté de celles qui s’affaissent au cachot du désespoir ». Ici, le poète martiniquais, conscient des souffrances et des oppressions que subit son peuple, compte apporter dans l’urgence pressante des solutions en se mue non seulement comme un héraut qui alerte, mais aussi en se portant garant pour apporter de la lumière à son peuple frappé de cécité acquise. Les poètes sont donc des éducateurs, des précepteurs en donnant toujours des leçons de morale au leur société. C’est dans cette dernière perspective que s’inscrit la poésie de Jean de La Fontaine avec ses Fables (1668-1693) comme cette fable des « Animaux malades de la peste » ; une fable dans laquelle, le poète nous enseigne la loi générale du monde : la raison du plus fort. Ainsi, on peut dire que le rôle social de la poésie est riche d’autant puisqu’elle apporte des enseignements à la communauté pour mieux éclairer et satisfaire ses besoins.
En somme, nous avons pu
constater que le poète qui se met au service de sa société peut avoir un double sentiment à savoir dénoncer les injustices sociales que subit sa communauté pour mieux l’instruire sur sa condition. Cependant, il est important de souligner que le rôle véritable de la poésie n’est-il pas d’user toutes les ressources du langage pour être au service d’elle-même ? C’est-à-dire promouvoir la recherche de la perfection formelle.
Aux défenseurs des valeurs sociales s’opposent les puristes qui pensent que la poésie ne devrait pas être associée à des convictions politiques encore moins sociales. Pour eux, la poésie doit être impersonnelle tout en mobilisant ses ressources langagières pour assurer sa perfection au niveau de sa forme.
En se référant de son approche primaire, nous constatons que la poésie est profondément liée à la forme, à la perfection grâce aux travaux des poètes. En effet, du grec « poiêsis » qui signifie « fabriquer », « créer », la poésie est donc un art du langage. Tous les poètes ne peuvent, malgré leurs diverses positions, outrepasser cette dimension élogieuse de la poésie qui, aux yeux de tous, demeure le domaine de prédilection de celle-ci. Ainsi, la beauté d’un texte poétique se mesure à travers la forme, c’est-à-dire la manière dont les poètes utilisent les ressources du langage notamment les rimes, les sonorités, les rythmes, l’harmonie et les images pour assurer les splendeurs de leurs poèmes. Le travail du poète est donc à l’image de celui de l’artisan. D’ailleurs, les poètes du mouvement Parnassien se comparent à ces derniers. On les appelle, alors, les artisans du langage. En termes plus clairs, ils prônent la théorie de l’art pour l’art. Une telle conception a valu la naissance d’un certain nombre d’œuvres poétiques qui clament cette caractéristique de l’art. Ainsi, récusant toute forme politique, sociale ou religieuse de l’œuvre d’art, les poètes de l’art pour l’art adoptent, alors, un goût esthétique commun ; c’est-à-dire préserver l’œuvre poétique contre tout acte d’engagement en vers la société. C’est la raison pour laquelle Charles Marie René Leconte de Lisle, considéré comme le chef du file du mouvement, écrit que « L’art est un luxe intellectuel, indépendant de la vérité, la politique et la morale, et n’ayant qu’un seul objet : le Beau.». Il veut témoigner ici et avec gratitude la valeur essentielle de l’œuvre poétique à savoir la recherche de la perfection formelle. Dans cette même logique, il critique les romantiques les accusant par la même occasion, dans le sonnet des « Montreurs » (Les Poèmes barbares, 1862) qui est comme une réplique à Musset, de se livrer facilement à la plèbe « Carnassière » avec leur « cœur ensanglanté »
« Je ne te vendrai pas mon ivresse ou mon mal
Je ne livrerai pas ma vie à tes huées
Je ne danserai pas sur ton tréteau banal
Avec tes historions et tes prostituées »
Ici, le poète refuse donc d’ouvrir son cœur pour ne se verser dans les méandres de la mélancolie ; caractéristique de la poésie romantique. Donc, les défenseurs de l’art pour l’art disqualifient l’art poétique contre toute forme politique, car « L’œuvre d’art ne doit servir à aucune doctrine sous peine de déchoir. » nous disait déjà Gustave Flaubert.
Par ailleurs, défendant la même idée, les poètes formalistes récusent ainsi, la personnalité trop fréquente dans l’œuvre poétique. En effet, unanime est le constat que nous pouvons faire à travers les différentes formes de poèmes où la personnalité du poète est marquée au premier plan. Cette attitude est décriée par les pourfendeurs du lyrisme personnel. Pour ces derniers, l’art doit être impersonnel, c’est-à-dire désintéressé à toute forme qui l’instrumentalise. L’œuvre poétique doit être une fin en soi, sinon elle doit périr dans la politique sociale. C’est pourquoi les poètes Parnassiens prônent l’art raisonné. C’est- à-dire pour eux, l’art doit être comparé à la science pour oublier son caractère personnel, subjectif. A ce niveau, nous pouvons convoquer encore Leconte de Lisle qui nous disait que « L’art et la science, longtemps séparés par suite des efforts divergents de l’intelligence, doivent tendre à s’unir étroitement, si ce n’est à se confondre. ». Cette convergence entre les deux domaines trouveur leur dénominateur commun dans ce qu’ils ont d’objectif et non de subjectif. Donc, il appert que l’œuvre d’art est conçu grâce à la réflexion, à la documentation, ou au retour à l’Antiquité, des poètes ; et non par la prédominance des sensations personnelles. C’est d’ailleurs ce que souligne Chateaubriand dans son texte du « Vague des passions », en montrant que les anciens, références des poètes parnassiens, n’étaient pas enclins à cette prédominance des passions comme on le voit aujourd’hui dans les sociétés modernes. Ainsi, dit-il « Les anciens ont peu connu cette inquiétude secrète, cette aigreur des passions étouffées qui fermentent toutes ensemble : une grande existence politique, les jeux du gymnase et du Champ de Mars, les affaires du Forum et de la place publique remplissaient leurs moments et ne laissaient aucune place aux ennuis du cœur. ». Donc l’ouverture du cœur en détresse peut être bloqué par des activités anti stresses. Ainsi, la position de José-Maria Heredia est très illustrative quand il dit que « Le poète est d’autant plus vraiment et largement humain qu’il est plus impersonnel »
Bref, les défenseurs de la poésie esthétique nous ont donnés la possibilité de comprendre la valeur intrinsèque de l’œuvre poétique qui se caractérise de par sa recherche de la perfection formelle et sa recherche d’un art objectif.
3. Conclusion
Schéma
Bilan de l’analyse
Point de vue
Perspective
En définitive, cette analyse de la poésie de manière générale nous a permis de comprendre que la création poétique obéit à des exigences qui régissent son fonctionnement dans la société et dans la littérature. Ainsi, si les adeptes de la poésie lyrique prônent l’expression des sentiments personnels ; par contre les chantres de la poésie sociale apportent des solutions à la communauté en détresse. Cependant, ces conceptions sont battues en brèche par les poètes de l’art pour l’art qui pensent que l’œuvre poétique ne doit nullement être assujettie à des convictions politiques ou encline à des passions extravagantes. Pour eux l’art doit traduire ses propres valeurs en promouvant la recherche de la perfection formelle. Nous pensons que cette dernière perspective devrait être le crédo de la poésie en l’absence de tout engagement social ou politique. Cependant, avec l’avènement de l’internet quel avenir pourrons-nous attendre de la poésie ?
M. BADJI, Professeur de Lettres Modernes
Au Lycée DIOUDE DIABE
IA SAINT-LOUIS
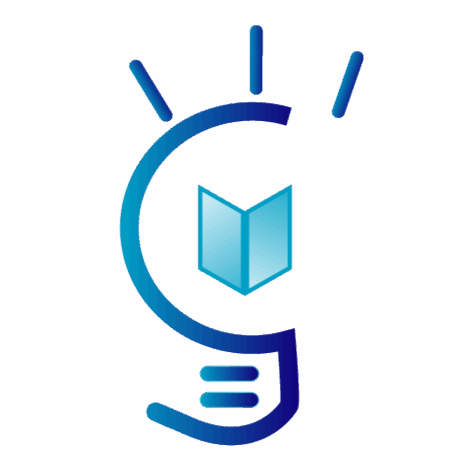

1 commentaire
Merci vraiment c’est très bien vous nous aidez