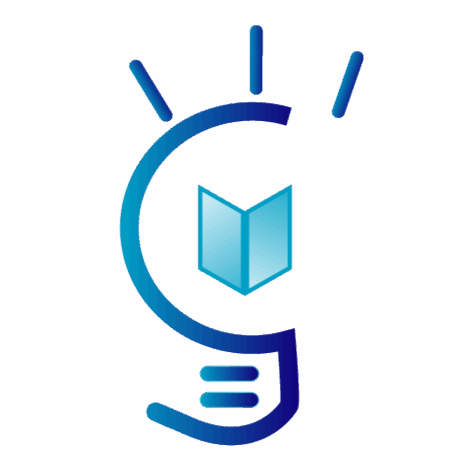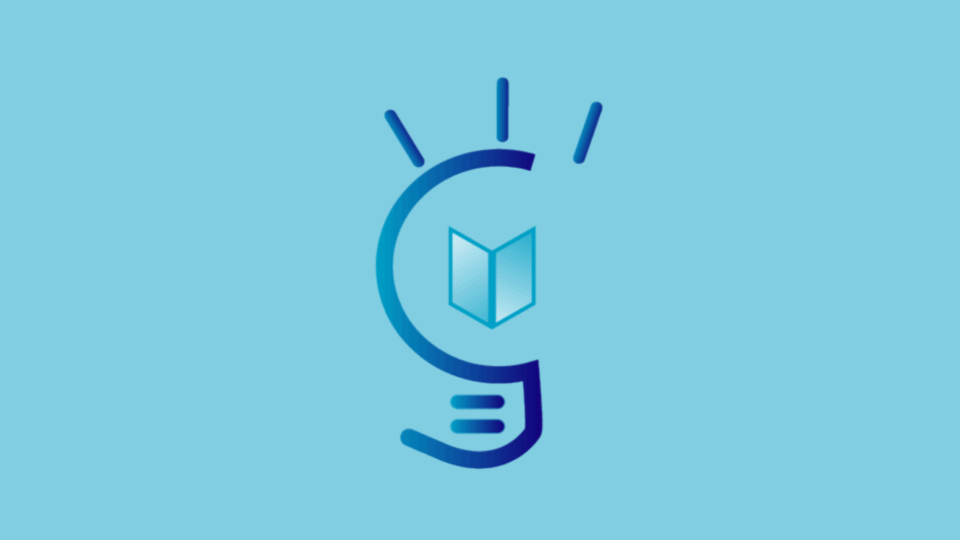Une étude détaillée et constructive d’un sujet de dissertation sur le Roman
Par honnêteté intellectuelle et par l’objectif visé, nous avons pris le sujet chez un collègue. C’est pour dire que la vraie citation a été modifiée. Elle est de Henri Troyat qui disait d’alors que « je suis écrivain, un rêveur, et plus je m’engagerai, plus je m’éloignerai de ma vraie nature.»
(Traitons celle qui se trouve ci-dessous)
Sujet : Un romancier déclare « je suis un romancier, je suis un rêveur et plus je m’engagerai, plus je m’éloignerai de ma vrai nature. »
Partagez-vous cette conception du rôle du romancier ?
Rappel :
I. Approche théorique : qu’est- qu’une dissertation ?
Répondre à cette question nous amène à faire comprendre aux élèves que la dissertation nécessite, certes de la théorie, mais nous préférons la répondre par des analyses pratiques. C’est la raison pour laquelle nous verrons successivement ses différentes composantes qui sont susceptibles de l’élucider ou la de parfaire. Ainsi, découvrons ensemble la composition de ce sujet, son domaine d’application, sa problématique ; trouverons des idées, l’organisation des idées et bâtissons un plan solide. Nous rédigerons une dissertation complète qui comportera une introduction, un développement dûment écrit (Thèses, phrases de présentation, des paragraphes argumentatifs, des illustrations, une conclusion partielle plus une transition nuancée), et une conclusion. Ainsi, pour mieux cerner efficacement les contours d’un sujet de dissertation, il s’avère important de bien lire son sujet avec à la clé une vigilance escomptée. C’est la raison pour laquelle, l’élève ou le candidat(e) devrait procéder d’abord par la lecture imprégnation ou lecture compréhension, ensuite par la lecture analyse (analyse des mots clés), et enfin par une lecture de contrôle/évaluation. Ces lectures susmentionnées sont au nombre de trois et nous permettent de répondre efficacement, le problème que soulèvent le libellé du sujet.
II. Approche pratique
a. Lecture compréhension.
Elle consiste à lire attentivement le sujet pour en rechercher trois éléments essentiels : le contexte dans lequel le sujet est inscrit, l’opinion, et la consigne.
Prenons le sujet ci-dessus.
Compréhension : ici je fais toujours un travail détaillé avec mes élèves, mais dans ce sujet, je compte aller vite…
Opinion : ce qu’il faut retenir sur l’opinion, c’est qu’elle se définit comme ce que nous tenons pour vrai sans l’avoir examiné. Donc, dans ce sujet, l’opinion c’est la proposition « je suis un romancier, …nature. »
Consigne : c’est des instructions que l’on donne, ce qu’on me demande de faire.
Ici la consigne est : Partagez-vous cette conception du rôle du romancier ?
Dans cette consigne, on demande votre avis, du coup, il faut déjà présent supposer que la position de l’auteur est ce qui trouve entre guillemets, c’est-à-dire la citation, l’opinion. De la même manière vous devrez aussi présupposer position. Alors, il faut retenir que cette consigne admettra deux positions différentes : une thèse, une antithèse et éventuellement une synthèse. Donc, nous avons une consigne qui se lie avec le plan dialectique.
NB : Avec l’harmonisation du Bac de l’UEMOA (Union Economique Monétaire Ouest Africain), les nouvelles consignes sont claires, plausibles, et le plan du travail est quasiment dégagé. Il suffit d’accorder du crédit à cette consigne qui se décline sous forme de parties nécessitant parfois à suivre une logique matérialisée par des connecteurs logiques du genre (d’abord, puis, ensuite, en fin ou d’une part, d’autre part…). A ce niveau, l’élève doit faire preuve de vigilance et de pragmatisme.
En plus, il faut faire très attention ; car les consignes proposées ne sont pas figées dans les fonctions comme on a l’habitude de le voir dans les anciens sujets. Cette fois-ci, on parle de parties ; et une seule partie peut prendre en charge plusieurs fonctions. Juste une précision pour vous permettre de prévoir et d’anticiper sur les nouvelles consignes. A ce niveau, nous pensons que les arguments ne manqueront pas, car vous serez toujours dans l’embarras du choix. Revenons-en au sujet.
Thème : il faut dire que le thème s’inscrit dans le domaine général ; son champ d’application est beaucoup plus vaste que le motif ou le prédicat. L’objectif de chercher le thème, c’est juste pour vous permettre d’éviter les hors sujets. Il faut toujours penser au thème dans le corps du devoir. Toutes vos illustrations, dans ce sujet susmentionné, viendront uniquement du roman tout en évitant de convoquer d’autres genres littéraires comme la poésie, le théâtre, etc. Tout autre genre littéraire, (poésie, théâtre, nouvelle, conte etc.), qui fera l’objet d’illustration sera considéré comme faute grave ; car le sujet vous limite uniquement au roman. Il s’agit, de rechercher ici, de ce qu’on parle de manière générale.
Thème : Je : romancier : roman
Prédicat : Ce qui est dit de la chose ou de la personne dont on parle : « je suis un romancier, je suis un rêveur, et plus je m’engagerai, plus je m’éloignerai de ma vraie nature. »
Ce qu’il faut retenir ; c’est que dans un sujet de dissertation, tout est important même les virgules.
Ce que j’ai mis en valeur (gras et italique) constitue ce que l’on dit de Je
Prenons les unités de sens qui vont ensemble :
Je romancier = Je rêveur = Je vraie nature ≠ Je engagé
b. Lecture analyse (élucidation des mots clés).
Romancier, rêveur, vraie nature : imaginaire, création romanesque relatant des histoires imaginaires, illusionniste du réel, la vraisemblance, le menteur vrai etc.
M’engagerai : servirai la société, exprimerai les réalités sociales
M’éloignerai : tiendrai une distance, un écart, observerai une ligne de démarcation…
Reformulation : le but du romancier n’est point d’exprimer la réalité, mais, de par son talent de créateur, de relater des histoires imaginaires.
Ou : On peut dire que le romancier de talent doit toujours promouvoir la vraisemblance.
Ou : La vraie nature de la création romanesque est de mettre en valeur l’illusion du réel.
NB : Ces reformulations, ci-dessus, sont uniquement des propositions parmi tant d’autres, d’autant plus que si nous aurions autant d’élèves, nous aurons autant de reformulations.
Problématique : la vraie nature de la création romanesque est-elle de donner uniquement l’illusion du réel ?
NB : les élèves devraient penser à ce niveau que la réponse de cette problématique constituerait le corps du devoir. Nous rappelons qu’il serait possible d’avoir d’autres questions et réponses qui peuvent constituer la problématique. On peut les voir à partir de la lecture contrôle/ évaluation.
c. Lecture contrôle/ évaluation
Il s’agit de chercher le thème général, de voir si l’auteur dans son opinion à développer des arguments, si oui, lesquels, et si non, quels sont les arguments que vous proposez ?
Alors, quelle est la vraie nature du romancier ? La réponse à cette question nous permettra d’identifier clairement la position de l’auteur de la citation, C’est-à-dire la thèse. Quel est le plan qui s’en dégage ? A ce niveau, l’élève peut évaluer la problématique, au brouillon, en jouant sur des réponses d’approbation et/ou de désapprobation.
Amusons à le faire ensemble :
D’autres peuvent répondre par approbation : le Oui, et comment ils vont y prendre ? = Thèse
D’autres peuvent répondre par la désapprobation : le Non, et comment ils vont y prendre ?= Antithèse. Et la complémentarité de ces deux positions va donner la Synthèse
Une précision, l’élève quand il traiterait son sujet devra toujours soutenir ces deux positions même s’il est aux antipodes de la position de l’auteur de la citation.
Proposition de plan
Thèse : le vrai talent du romancier est de faire en sorte que lecteur ne se rend pas de son luxe mensonger.
Antithèse : Par contre, pour beaucoup d’écrivains, la vraie nature du romancier est d’être le miroir fidèle de sa société.
Eventuellement une synthèse : un vrai romancier est celui qui réussit à concilier réalité et fiction.
A présent, je vous propose une introduction rédigée, un développent complet, une conclusion rédigée.
III. La Rédaction complète
1. Proposition d’une introduction
Les questions liées au genre romanesque suscitent moult controverses qui déterminent ses rapports avec la société qui l’a vu naître. Ainsi, aux défenseurs du roman réaliste, s’opposent les illusionnistes qui pensent que la vrai qualité d’un romancier est de faire valoir son talent de créateur ; c’est-à-dire donner au roman une dimension hautement imaginaire. C’est probablement, dans cette dernière perspective que s’inscrit cette citation qui nous dit que le but du romancier n’est point d’exprimer la réalité, mais, de par son talent de créateur, de relater des histoires imaginaires. Cependant, il importe de savoir, à ce niveau, si la vraie nature du romancier se résumerait-elle à donner uniquement l’illusion du réel ? Quels rapports réalité et fiction entretiennent-elles dans la structure de la trame romanesque? Dès lors, dans une dynamique d’un développent organisé, nous monterons d’abord que l’art romanesque est un luxe mensonger; ensuite nous expliquerons que la vraie nature du romancier est de traduire la réalité sociale; et enfin nous essayerons de prouver que fiction et réalité sont consubstantielles dans une trame romanesque.
2. Proposition développement
Thèse : la nature du roman demeure un luxe mensonger
Une phrase de présentation : Bon nombre de romanciers pensent que l’art romanesque doit toujours promouvoir des histoires fictives et vraisemblables.
Argument 1 : D’abord, le principe premier du vrai romancier est de valoriser des histoires fictives à travers l’imagination. En effet, de par sa définition même, c’est-à-dire œuvre d’imagination en prose qui présente des personnages donnés comme rée, le roman serait donc consubstantiellement lié à la représentation des choses dans la dynamique d’un choix opéré par le truchement de l’imagination du romancier. Ainsi, dès que ce dernier adopte et applique cette forme de représentation, il nous verse dans son monde univers imaginaire. A la différence des histoires biographiques ou des discours documentaires, le roman est essentiellement ancré dans ce grand bourbier de l’imagination romanesque. En voulant trop être réaliste, le romancier se révèle et s’engage dans la voie de l’irréalité, d’autant plus que toute œuvre romanesque est née et vit dans le carcan des histoires fictives. Disons même que la fiction reste le premier principe du romancier. Exemple 1 : D’ailleurs c’est ce que souligne Albert Camus dans sa Conférence intitulée L’artiste et son Temps (1957), en mettant en cause la valeur même de l’art, surtout sur les artistes qui se disent réalistes en déclarant que « Le seul artiste réaliste serait Dieu, s’il existe. Les autres artistes sont, par force, infidèles aux réels». Il sied de comprendre clairement que cette position relève d’une dimension catégorique, car pour lui, tout artiste vrai ne peut outrepasser les mesures de l’irréalité pour faire valoir la dimension réaliste de l’œuvre d’art. En termes plus clairs, « il (artiste) reconnait franchement qu’on ne peut reproduire la réalité sans y faire un choix ». Ainsi, il faut reconnaître par-là que c’est de ce choix opéré par le romancier, dans ses imaginations supposées propres, qu’il faut revoir la dimension fictive du récit romanesque. Exemple2 : C’est la raison pour laquelle l’un des plus grands auteurs réalistes, Guy de Maupassant avait très tôt reconnu cette insuffisance réaliste du roman en disant, dans la Préface de Pierre et Jean (1888), que « Le réaliste, s’il est un artiste, cherchera, non pas à mous montrer la photographie banale de la vie, mais à nous en donner la vision plus complète, plus saisissante, plus probante que la réalité même » (probante : vraie). Une telle approche du roman est visiblement compressible d’autant plus qu’il est perçu par ces auteurs précités comme une œuvre qui fait la copie banale de la vie et c’est dans ce même conteste qu’il conclue en ces mots « […] les Réalistes de talent devraient s’appeler plutôt des Illusionnistes ». On peut dire, enfin de compte, que la nature du romancier est définie par rapport à sa manière de raconter des histoires grâce à son talent de créateur.
Argument 2 : En outre, nous pouvons dire que le romancier est un beau menteur, c’est-à-dire que son rôle est de faire en sorte que lecteur ne se rend pas compte de la présence de l’irréalité. En effet, toute œuvre romanesque serait vouée à retranscrire la réalité fidèlement sans ajouter ni retrancher. Mais une telle conception s’avère impossible d’autant plus que le romancier conçoit son œuvre romanesque dans la dynamique de son imaginaire. Ainsi, son mérite à ce niveau reste dans ce talent de génie à combiner le matériau nécessaire pour faire jaillir des histoires vraisemblables ou pour faire représenter des personnages présentés comme réels. Une telle valeur du romancier est saluée par certains écrivains et artistes qui pensent que l’art romanesque est un luxe mensonger. De surcroît, on peut dire que, dans un roman, les fonctions des personnages romanesques sont déterminées par l’action qu’ils exercent dans l’intrigue. C’est la raison pour laquelle, le romancier leur attribue des identités vraisemblables. C’est ainsi, en tant que sujet, le personnage a un nom, une psychologie, une apparence physique. En plus, en tant que fonction : sujet, objet, adjuvant, opposant. En réalité, toutes ces caractéristiques présentent le roman comme une histoire vraie, et le romancier devient, alors, le « singe de Dieu » nous dit François Mauriac. C’est que Louis Aragon appelle le « mentir vrai » ». Exemple1 : D’ailleurs, ce dernier avait répondu quelque part que : « l’art du roman est de savoir mentir ». Il appert dès lors que la vraie nature du romancier serait de raconter des histoires vraisemblables à tel point que les lecteurs ne puissent pas trouver les mensonges mis en exergue. Ainsi, tout comme Aragon, un autre romancier du nom de Claude Roy se lance dans la même mouvance en montrant que le droit du romancier réside dans sa capacité à dévoiler des histoires proches de la réalité des faits. Exemple 2 : C’est ainsi qu’il déclare que « le romancier a beaucoup de droits dont celui de mentir pour mieux dire la vérité ». Cette assertion confirme le talent du romancier qui, de par son ingéniosité et sa virtuosité, fascine le lecteur qui se trouve dans l’incapacité parfois de discerner du vrai du faux. Exemple3 : C’est la raison pour laquelle Camus nous dit que « Le génie ressemble à tout le monde et nul ne lui ressemble ». Donc, il est important de comprendre que toutes ces histoires racontées dans des œuvres romanesques relèvent d’un luxe mensonger.
Conclusion partielle: En somme, nous pouvons retenir dans cette analyse préétablie que le vrai visage du romancier demeure dans sa capacité à transfigurer la réalité en des histoires imaginaire et vraisemblable, c’est-à-dire de par son talent et son art il parvient à nous montrer sa vraie nature. Transition : Néanmoins, force est de constater que le romancier est tenu par un déterminisme social, et qu’il est obligé de dire vrai les faits sociaux.
Antithèse : le roman reflète les réalités sociales
Phrase de présentation : Beaucoup de romanciers, surtout les romanciers réalistes, pensent que la vraie nature du créateur romanesque est de montrer les réalités de la société quels qu’en soient les risques, et cela sous diverses formes.
Argument1 : De prime abord, on peut dire que le roman est le reflet fidèle de la réalité sociale. En effet, le projet pressant de tout romancier consiste de se muer en acteur averti, et cela selon les exigences du temps, pour faire valoir ses devoirs d’écrivain. C’est ce qui lui motive certains d’entre eux d’adopter une attitude réaliste d’autant plus que la survie de son art dépend son engagement social. En plus, tout romancier est cependant lié ou confronté aux problèmes de son temps. C’est probablement ce qui lui pousse à vouloir dire toute la vérité et rien que la vérité dans son œuvre romanesque. Aucun de ces prosateurs ne demeure indifférent, impassible aux cris et surtout aux détresses de son peuple. Ils deviennent donc des témoins privilégiés qui reflètent littéralement les maux qui gangrènent ce grand bourbier de la société. Ainsi, c’est l’occasion pour lui d’imprimer ses marques en dénonçant ouvertement au même moment la pauvreté rampante, les misères sociales, les conséquences fâcheuses des révolutions qui aliènent le bas peuple. Exemple1 : C’est dans cette perspective que nous devons convoquer l’œuvre d’Emile Zola Germinal ; une œuvre dans laquelle le romancier nous étale les conditions déplorables des mineurs qui se sont révoltés pour manifester contre l’hostilité du capitalisme inquiétant. C’est ainsi, vivant dans l’exploitation totale et dans la misère, les ouvriers s’organisent en formant « une masse compacte, serrée » pour protester contre l’oppression bourgeoise. Cette révolution est appelée la révolution rouge. Dans ce cas de figure, nul ne peut douter de la vigilance avertie des romanciers qui font de leurs œuvres des miroirs fidèles qui traduisent avec exactitude la réalité qui prévaut dans sa communauté. Exemple2 : D’où la pertinence de la déclaration d’un des personnages de Stendhal, dans le Rouge et le Noir (1830), qui disait en ces mots « Eh, monsieur, un roman est un miroir qui se promène sur une grande route. Tantôt il reflète à vos yeux l’azur des cieux, tantôt la fange des bourbiers de la route. Et l’homme qui porte le miroir dans sa hotte sera par vous accusé d’être immoral ! Son miroir montre la fange, et vous accusez le miroir ! Accusez bien plutôt le grand chemin où le bourbier, et plus encore l’inspecteur des routes qui laisse l’eau croupir et le bourbier se former ». Donc le rôle du vari romancier est d’exposer les faits sociaux dans leur nudité pour faire réagir les ayants droit dont la mission est d’apporter au peuple une vie décente.
Argument2 : Par ailleurs, le romancier peut faire preuve de courage en dénonçant les injustices politiques. Ainsi, soulignons que ce dernier, en tant qu’écrivain, se doit de participer pleinement à la bonne marche de sa cité. Il devrait donc porter ce manteau du député averti afin de pouvoir veiller sur la bonne gouvernance des dirigeants ainsi que la bonne gestion de l’Etat de droit. Il s’engage, alors, dans un combat perpétuel pour permettre au peuple de retrouver sa souveraineté. Ce militantisme fait de ce dernier un amoureux des libertés individuelles ou collectives et un activiste subversif contre les mauvais agissements des dirigeants malhonnêtes. Ainsi, après l’accession à l’indépendance de la plupart des pays africains, les sociétés noires sont en pleine euphorie ; elles sont à l’aube d’une ère nouvelle qui laisse miroiter de belles perspectives d’avenir. Mais elles auront vite fait désenchanté du fait des attitudes malsaines des nouveaux chefs d’Etat qui favorisent ainsi la mal gouvernance, le népotisme, l’arrivisme au détriment des valeurs souveraines de la démocratie représentative. Exemple1 : Ce malaise et cette désillusion vont transparaître dans les différentes œuvres post-coloniales comme Les Soleils des indépendances d’Ahmadou Kourouma (1968) ; une œuvre dans laquelle Fama Doumbouya était déçu par les indépendances et il n’a « Rien que la carte d’identité nationale et celle du parti unique ». Il sied de souligner que le narrateur met à nue ici les conséquences, les méfaits des indépendances en Afrique. De par son caractère dérisoire, les indépendances n’apportent que des futilités aux Africains notamment le parti unique caractérisé par la corruption, le despotisme, l’usurpation du pouvoir ; et la carte d’identité, symbole de la modernité incomprise et de la désintégration. Kourouma fait donc une critique acerbe à l’endroit des nouveaux dirigeants. Exemple2 : C’est dans cette même dynamique d’approche que s’inscrit la philosophie d’Albert Camus qui nous dit, dans son essai L’homme révolté (1951), que « Le romanesque n’est que la correction de ce monde ci, suivant le désir profond de l’homme car il s’agit bien du même monde. La souffrance est la même, le mensonge, l’amour. Les héros ont notre langage, nos faiblesses, nos forces. Leur univers n’est ni plus beau ni plus édifiant que le nôtre ». Par conséquent, retenons que l’engagement du romancier devrait se mesurer dans sa capacité à dénoncer, avec tous les risques possibles, les injustices politiques.
Conclusion partielle : Bref, on peut à travers cette analyse que la nature du romancier est étroitement liée à la recherche de la vérité et de la liberté, et ce grâce à ses rapports étroits qu’il entretient avec sa société. Il est le garant de sa cité en dénonçant toutes les injustices d’où qu’elles viennent. Transition : Cependant, il importe de souligner que malgré ces divergences d’opinion, le roman est et restera un genre protéiforme où se côtoient fiction et réalité.
Synthèse : Dans un vrai roman, réalité et fiction sont indissociables. Elles s’imbriquent et se côtoient de manière consubstantielle. L’une ne peut aller sans l’autre. Cette symbiose fait du roman un genre particulier différent des autres genres littéraires. Ainsi tous les romanciers sont unanimes du fait de sa dichotomie fictive et réaliste. Le roman se nourrit donc d’une fiction réaliste. Pourtant, même si la fiction est opposée à la réalité, force est de constater que cette fiction narrative consiste à représenter le réel. Réalité et fiction restent donc des principes intrinsèques qui assurent la survie du roman et de son épanouissement dans l’espace littéraire. D’ailleurs, il urge dans ce sens de convoquer Raymond Queneau qui, dans son œuvre Technique du roman (1937), dit, à propos de l’apparence romanesque et de sa diversité, qu’« Alors que la poésie a été la terre bénie des rhétoriques et des faiseurs de règles, le roman, depuis qu’il existe, a échappé à toute loi. N’importe qui peut pousser devant lui comme un troupeau d’oies, un nombre indéterminé de personnages apparemment réels à travers une lande longue d’un nombre indéterminé de pages ou de chapitres. Le résultat, quel que soit sera toujours le roman ». Cette souplesse du genre romanesque qui admet une diversité de faits vraisemblables fait que beaucoup de lecteurs trouvent leurs épanouissements dans ce genre protéiforme qui allie toujours réalité et fiction. C’est de ces valeurs suprêmes qui poussent certains romanciers à se mesurer à Dieu tout en pensant créer toujours univers comparable à ce bas monde. D’ailleurs Camus le confirme bien en disant que « L’artiste contemporain se donne l’illusion de créer sa propre règle et finit par se croire Dieu ». Cette croyance lui permet de se maintenir en vie tout en répondant toutes les interrogations de son peuple. Donc tels sont les rapports intrinsèques qui régissent le genre romanesque en le présentant comme une œuvre d’imagination en prose qui met en scène des personnages présentés comme réels et qui ont des aventures, des psychologies et des destins.
3. Proposition de conclusion
Au demeurant, cette analyse du roman, en général, et du romancier, en particulier, nous a permis de bien cerner les contours qui fondent sa vraie nature malgré la diversité des positions. Ainsi, pour les romanciers illusionnistes le roman est caractérisé par sa vraisemblance, par son luxe mensonger. Par contre, les réalistes pensent que « le vrai peut quelquefois n’être pas vraisemblable », mais peut présenter plutôt le réel tout en reflétant, ainsi, les aspirations du peuple. Alors, nous pensons que la vraie nature du genre romanesque est surtout de promouvoir des histoires vraisemblables, car le romancier doit toujours s’inspirer de la réalité pour le transformer en un art romanesque plutôt que de vouloir s’attarder sur des questions sociales. Cependant, la vraie nature du romancier n’est-elle pas d’être un concepteur de nouveaux langages comme le souhaiteraient les écrivains du Nouveau Roman ?
NB :« le partage est un appel humain et l’appropriation de ce partage fait naître en soi un égoïsme déraisonnable » M. BADJI
M. BADJI, Professeur de Lettres Modernes
Au Lycée DIOUDE DIABE
IA SAINT-LOUIS
Contacts: WhatsApp: 772570417
Email: badjilanding661@yahoo.fr
Savoir pour mieux servir