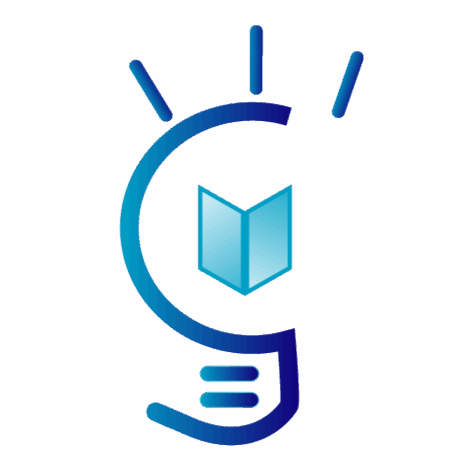LA VÉRITÉ
Problématique : Qu’est-ce que la vérité et comment y accéder ?
Objectif : L’élève doit être capable d’établir que la vérité est construite
non établie une fois pour toute.
I- LES TYPES DE VÉRITÉ
Par définition, la vérité est une connaissance authentique, fondée sur la concordance de la pensée avec la réalité, c’est-à-dire la conformité de ce qu’on dit avec ce qui est. Il existe plusieurs critères selon lesquels on peut qualifier de vraies des propositions : la cohérence et la
correspondance. Ces critères nous permettent de faire la typologie de la vérité. En philosophie on distingue traditionnellement deux types de vérité : la vérité formelle et la vérité matérielle.
1-la vérité formelle
La vérité formelle est l’accord de la pensée avec elle-même. Ce type de vérité on la retrouve en mathématique et en logique notamment où le terme vérité se rapporte à la cohérence des propositions entre elles et avec les prémisses et les axiomes posés préalablement. En mathématique par exemple, une proposition est vraie si elle est en cohérence interne avec les autres propositions du système dans lequel elle est formulée ; elle doit donc être déduite logiquement à partir des prémisses posées arbitrairement par les axiomes.
2-La vérité matérielle
En revanche, dans les sciences expérimentales, une proposition est vraie quand elle permet de rendre compte des phénomènes étudiés. La vérité matérielle qui est l’accord de la pensée avec l’objet s’applique principalement aux énoncés vérifiés expérimentalement. D’une cohérence interne, exigée en mathématiques et en logique, l’on passe à une correspondance externe, requise en physique par exemple ; plus exactement, la vérité expérimentale se définit à la fois par la correspondance de l’hypothèse avec les résultats de l’expérience.
En sciences expérimentales comme en mathématiques, pour des raisons différentes, la vérité d’une proposition est donc relative au système dans lequel elle s’inscrit.
II- LA RELATIVITÉ DE LA VÉRITÉ
1- Pluralité des champs d’investigation de la vérité
Dire que la vérité est relative signifie qu’elle n’a rien d’absolue et peut varier d’un contexte à un autre. D’où le caractère pluriel de la vérité qui se vérifie par une multiplicité de ses champs d’investigation à savoir : la science (vérité scientifique), la religion (vérité religieuse) et la métaphysique (vérité métaphysique).
– La vérité religieuse
Historiquement, les thèses du scepticisme intégral ont été largement exploitées sur le plan religieux. En effet, étant donné que nous sommes des êtres finis, parce qu’essentiellement voués au péché, nous ne pouvons donc pas acquérir la vérité comme le prétendent les
philosophes rationalistes. Si nos sens sont défectueux et notre entendement (raison) limité, il est nécessaire que la foi prenne le pas sur ces deux facultés si nous voulons atteindre la vérité. C’est donc par la foi et non par la raison qu’on peut pénétrer certains mystères. La vérité religieuse proprement dite est acquise par révélation. Les croyants n’ont point besoin d’observation : « heureux ceux qui croient sans avoir vu ». La raison dans cette perspective s’incline pour laisser la place à la foi. Seulement, une attitude qui revendique pour elle-même une vérité qu’elle est incapable de démontrer est propre au dogmatisme. Socrate récuse le dogmatisme qu’il juge à la fois prétentieux, car fondé sur des convictions qui ne peuvent être étayées que partiellement, insensé, car motivé par la faiblesse intellectuelle et morale du sujet, et enfin dangereux, car les dogmatiques glissent facilement vers le fanatisme, donc vers l’acceptation, voire la recherche de la mort, non tant de soi que de l’autre. « Je sais que je ne sais pas », telle est l’une des devises philosophiques de Socrate, qui illustre que la critique du
dogmatisme, comme chez David Hume au xviiie siècle, débouche souvent sur le scepticisme, doctrine selon laquelle l’homme est incapable d’accéder à des connaissance sûres, ou conduit au relativisme, doctrine pour laquelle il n’y a pas de vérité, « tout se vaut, tout peut être affirmé ».
– Vérité scientifique
La vérité scientifique n’est pas absolue au sens où elle serait indispensable, figée, donnée une fois pour toute. La vérité trouvée en science n’est qu’une étape dans les progrès scientifiques, elle est relative et tout savant qui cherche à imposer sa découverte comme un dogme indispensable devient un obstacle, un ennemi de la science. La vérité en science n’est pas une vérité sacrée. Gaston Bachelard dans son œuvre La formation de l’esprit scientifique soutient ce point de vue quant il écrit : « En science, les vérités d’aujourd’hui sont les erreurs de
demain ». Nul ne peut imposer la fin de la science, nul ne peut clôturer la recherche scientifique. Bachelard va plus loin et le fait remarquer en ces termes : « En science, toute vérité naît autour d’une polémique, il n’y a pas de vérité première, il n’y a que des erreurs premières ». Ceci amène l’homme scientifique à avoir un esprit d’humilité envers les autres, à se remettre sans cesse en question, et c’est ce qui fait l’évolution et le progrès des sciences comme le précise encore Gaston Bachelard : « L’esprit scientifique doit se former en se réformant ; la vérité trouvée doit accepter d’être critiquée, d’être réajustée. Découvrir en science c’est rajeunir spirituellement ». C’est dire que la vérité est scientifique si elle peut être remise en question. Si on n’a plus le droit de la remettre en question, cela devient un dogme et relève des religions. On comprend alors pourquoi Karl Popper déclare : « une théorie n’est scientifique que si
elle est réfutable ». En plus, une vérité scientifique ne peut dépendre des diverses conditions. Une expérience refaite dans les conditions identiques, doit donner des résultats identiques.
La science dit récuser tout dogmatisme et toute opinion. Pourtant, elle est elle-même une croyance métaphysique en la vérité, et Nietzsche nous en dit long là-dessus : « on dit avec juste raison que dans le domaine de la science, les convictions n’ont pas droit de citer (…) on voit
par là que la science repose sur une croyance ; il n’est pas de science
sans postulat ».
– Vérité métaphysique
On entend par vérité métaphysique, l’existence réelle des choses conformes aux idées auxquelles nous avons attaché des mots pour désigner ces choses ; ainsi connaître les choses dans le sens métaphysique c’est apercevoir les choses telles qu’elles sont en elles mêmes, et en juger conformément à leur nature. Il s’agit là comme le précise Spinoza, de l’accord d’une idée avec son objet : « la première signification donc de Vrai et de Faux semble avoir tiré son origine des récits ; et l’on a dit vrai un récit quand le fait raconté était réellement arrivé ; faux, quand le fait raconté n’était arrivé nulle part. Plus tard, les philosophes ont employé le mot pour désigner l’accord d’une idée avec son objet ; ainsi, l’on appelle idée vraie celle qui montre une chose comme elle est en elle-même ; fausse celle qui montre une chose autrement
qu’elle n’est en réalité ». Spinoza, Pensées métaphysiques. Une pensée vraie est celle de la conformité de l’idée à la chose : « adequatio rei et intellectus » (adéquation de l’intelligence et du réel) écrit Saint Thomas.
Cette formule a l’avantage de souligner l’écart qui sépare l’idée de la réalité, écart qui leur interdit de se fondre l’une dans l’autre. Ce n’est plus une identité qui est postulée (Cf. Descartes et Malebranche), mais un accord, une correspondance, une adéquation. Cette thèse qui a été
qualifiée de réaliste trouve son origine dans la pensée d’Aristote qui se sépare de la conception platonicienne. Aristote définit la vérité comme la conformité de la proposition, de ce qui est dit, à la réalité. La proposition est vraie si les faits dont elle rend compte sont tels qu’elle les décrit ; elle est fausse si les faits sont autrement qu’elle ne les décrit.
Cette conception de la vérité a traversée toute l’histoire de la philosophie et l’on peut dire que c’est Kant le premier qui l’a profondément contestée. Mais sans vouloir insister sur une telle remise en question, nous voudrions plutôt montrer comment certains philosophes du 20e siècle ont pu continuer à défendre cette position. C’est le cas de Russel pour qui toute proposition douée de sens doit, en droit sinon en fait, pouvoir être vérifiée ou infirmée, être dite vraie ou fausse. C’est la correspondance avec un état de chose qui rend une proposition vraie.
2- Pragmatisme, sensualisme, scepticisme
– Le pragmatisme
Dans le pragmatisme tel que conçu par l’américain William James, la pensée est intimement liée à l’action et la vérité doit se définir par ses conséquences pratiques. C’est donc dire avec William James que le vrai c’est ce qui réussit et ce qui réussit est pragmatique. La vérité se trouve donc assimilée à ce qui est utile et bon : « Est vrai ce qui est avantageux…ce qui nous apporte la plus grande somme de satisfaction y compris celle du goût ». William J. Ce qui veut dire que c’est ce qui répond à nos préoccupations qui peut être considéré comme vrai. Et Saint Exupery de dire : « la vérité c’est ce qui consolide notre caractère d’homme ». C’est-à-dire ce qui fait de nous un homme, ce qui nous permet de nous réaliser, ce qui satisfait nos besoins.
– La perspective sensualiste (le relativisme)
C’est un courant philosophique qui fonde la connaissance sur les sens. Dans ce cas, la connaissance est relative selon les sujets. C’est ce qui a permis à Protagoras d’affirmer que « l’homme est la mesure de toute chose ». C’est-à-dire que la vérité est relative puisque la sensation dépend non seulement de l’objet senti, mais aussi du sujet sentant. Ce qui veut dire également que c’est l’homme qui est la mesure des vérités et des valeurs. En conséquence, la vérité est subjective, elle dépend de chaque sujet car nous ne percevons pas les choses de la même manière. Cependant, si la vérité est relative, qu’est-ce qui rend compte de l’erreur ou du mensonge. En fait, il y a lieu de remarquer que le sensualisme comporte des lacunes parce qu’il donne l’impression que la vérité est subjective car dans le sensualisme c’est tout le monde qui se croit dans le vrai.
– La perspective du scepticisme
Le scepticisme est une doctrine qui nie la possibilité de parvenir à connaître avec certitude la réalité telle qu’elle est en soi, car la perception est la seule source fiable de connaissance. C’est
progressivement que le terme de « scepticisme » en est venu à signifier le doute sur ce qui est communément tenu pour vrai : « Il n’y a pas de vérité du tout…s’il est une vérité, elle est inconnaissable, si elle est connaissable le discours est roi. Ce qui est vrai est ce que je parviens à
persuader comme vrai ». Gorgias (Cf. aussi Pyrrhon).
III- VÉRITÉ ET OBJECTIVITÉ
1- La réalité concrète comme fondement de la vérité
On dit habituellement qu’une proposition est vraie lorsque son énoncé est conforme à la réalité, c’est-à-dire traduit les faits. Elle est fausse lorsqu’il y a clivage entre son énoncé et les faits, c’est-à-dire lorsqu’elle n’énonce pas la réalité. La vérité d’un discours résulte de l’adéquation de ce discours avec la réalité objective.
2- La vérité comme dépassement de l’illusion et de l’apparence
Selon Platon la vérité est la négation systématique de l’apparence sensible ou de l’opinion. Le vrai est l’Idée, l’essence ou l’intelligible, c’est-à-dire ce qui est stable, simple, identique et non ce qui apparaît et disparaît parce que fugace, éphémère, volatil. Le vrai ne procède (découle) donc pas de la sensation ni de l’opinion mais résulte d’une ascèse intellectuelle grâce à laquelle on s’élève progressivement vers ce qui est, par la transcendance de ce qui apparaît. (Cf. Platon La
République VII, Théétète). Il s’en suit que les enjeux de la vérité portent sur la possibilité même de produire des énoncés vrais et de se débarrasser des opinions, des erreurs, des apparences et des idéologies, autrement dit, sur la manière de faire avancer la connaissance et de faire reculer l’ignorance et l’illusion voire le mensonge.
3- Vérité et erreur ; vérité et mensonge
La définition la plus simple de la vérité pourrait être la suivante : ce que nous disons ou pensons est vrai quand ce que nous avons en vue existe vraiment tel que nous le disons ou le pensons. Ainsi, nous sommes dans le vrai quand ce que nous disons est une image fidèle de la réalité, et nous sommes dans l’erreur quand il n’y a rien dans la réalité qui corresponde à nos idées.
Le mensonge est un propos contraire à la vérité dans le but de tromper. Celui qui préfère mentir le fait parce qu’il tire profit de son mensonge. Le menteur est donc celui qui connaît la vérité mais qui la cache pour préserver ses intérêts. L’impératif catégorique d’Emmanuel
Kant interdit en effet à chacun de mentir, car ne pas dire à autrui la vérité, c’est non seulement le tromper, mais aussi se servir de lui pour parvenir à un but, et donc, le réduire à un moyen.