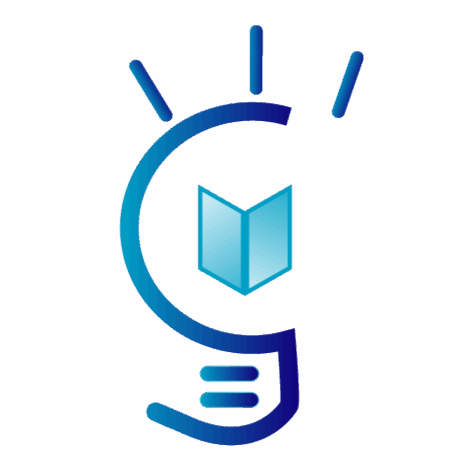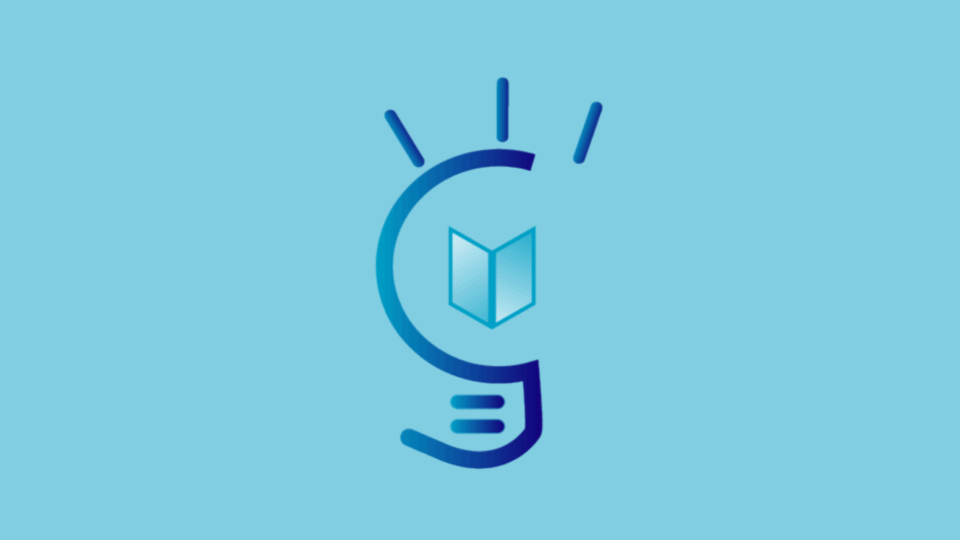La Versification; Le vers: Le poème
La versification est l’ensemble des techniques employées dans l’expression poétique traditionnelle en langue française et des usages qui y règlent la pratique du vers : regroupement en strophes, jeu des rythmes et des sonorités, types formels de poèmes. Terme au contenu purement technique, la versification se distingue des arts poétiques, qui renvoient à des conceptions à la fois techniques et esthétiques de la poésie revendiquées par une personne ou un groupe.
Le poème
Noms et formes
Un poème obéit à des règles plus ou moins complexes et plus ou moins rigides qui concernent les types de vers, la présence d’un refrain, les types de strophes, leur agencement ou leur nombre. Les règles et les modes ont varié au cours de l’histoire.
Parmi les formes du Moyen Âge, il y a :
- la ballade, genre majeur au Moyen Âge, remis partiellement à l’honneur au xixe siècle comme avec Hugo (Odes et Ballades) : elle comporte trois strophes et demie, dont le dernier vers constitue un refrain ; la demi-strophe finale constitue l’envoi (dédicace du poème à Dieu, au roi, à une dame…) ; il y a autant de vers dans la strophe que de syllabes dans le vers (8 ou 10 en général) ;
- le rondeau : 15 vers généralement courts sur deux rimes avec un effet de refrain ; ex. : Charles d’Orléans ;
- les formes de jeu verbal, comme l’acrostiche ;
- l’aube, la complainte, le fabliau, le fatras, la fatrasie, l’odelette, la pastourelle, le lai, le rondel, le rotrouenge, la terza rima, le triolet, le virelai…
Parmi les formes modernes, il y a :
- le haïku : poème japonais sans rimes de 17 mores sur trois segments 5-7-5 ;
- le tanka : poème japonais sans rimes de 31 mores sur cinq lignes (5-7-5-7-7 syllabes);
- l’ode, imitée de l’Antiquité, mais assouplie par Ronsard avec 2 strophes égales + 1 strophe plus courte ;
- le pantoum : d’origine malaise, introduit en France au xixe siècle, codifié par Théodore de Banville dans son Petit traité de Poésie française, est construit par reprises décalées des vers d’une strophe sur l’autre (les vers 2 et 4 de la première strophe deviennent les vers 1 et 3 de la strophe suivante, et ainsi de suite) ;
- la sextine est une forme poétique, composée de six sizains, dont les mots en fin de vers restent les mêmes, mais sont répartis selon un ordre différent ; créée au xiie siècle, cette forme a été revisitée par les poètes de l’Oulipo ;
- le sonnet : hérité de Pétrarque et imposé peu à peu au xvie siècle, très vivant au xixe siècle (Baudelaire, Verlaine, Hérédia…), dont l’une des dispositions les plus classiques se compose de deux quatrains aux rimes embrassées et répétées, et 2 tercets sur 2 ou 3 rimes à disposition variable (les formes les plus courantes en français sont : ABBA ABBA CCD EED ou ABBA ABBA CCD EDE) ; la mise en valeur du dernier vers est appelé la chute du sonnet ;
- les stances, la villanelle…
Enfin, il existe des genres poétiques qui ne relèvent pas à proprement parler de la versification, puisque leur thème, leur ton, et leur aspect technique diffèrent de ce qui vient d’être décrit ; les genres poétiques ont cependant tenu une grande place dans les époques passées : épopée, chanson de geste, poésie didactique et engagée (art poétique, épigramme, satire, fable), expression personnelle (blason, élégie, églogue, épithalame, glose, madrigal, roman courtois, pastorale), etc.
Figures de style
De nombreuses figures de style servent à enrichir l’expression poétique ; elles peuvent fonctionner sur un ou plusieurs vers. En voici quelques-unes.
- Reprise de sonorité
- Assonance : reprise du même son vocalique (cf. le son [an] : « Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant », Paul Verlaine) ;
- Allitération : reprise d’un son consonantique (cf. le son [r] : « Tandis que les crachats rouges de la mitraille », Arthur Rimbaud) ;
- Harmonie imitative : association soulignée du son et du sens (cf. allitération en [s] associée au sifflement du serpent : « Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes ? », Jean Racine dans Andromaque).
- Sens des mots
- Allégorie : représentation concrète d’un élément abstrait ;
- Comparaison : association directe entre deux éléments ou plus ;
- Euphémisme : atténuation, notamment pour réduire l’impact d’un événement ou d’un fait cruel ;
- Image : rapprochement de deux éléments via un élément commun ;
- Métaphore : analogie ou comparaison indirecte basée sur un rapprochement de sens et d’image ;
- Périphrase : mot remplacé par une expression ;
- Personnification : attribution de caractéristiques humaines à une chose ou un animal ;
- Symbole : image de référence.
- Place des mots
- Anaphore : reprise de mots dans des constructions semblables (« Puisque… / Puisque… / Puisque… ») ;
- Accumulation : énumération d’éléments semblables (« Adieu veau, vache, cochon… », Jean de La Fontaine) ;
- Hyperbole : exagération pour mettre en évidence ;
- Oxymore : rapprochement d’élément dissemblable (ex : un soleil noir) ;
- Parallélisme : répétition pour rapprocher deux choses ou deux objets.
Diction
La diction est l’ensemble des règles qui régissent le langage parlé. Cependant, la lecture des vers ne répond à aucune règle absolue ; et si le minimum à respecter parait être le respect des sonorités et du rythme (imposés par les e caducs, les liaisons, les coupes et les césures, les diérèses et synérèses, la ponctuation), les approches varient (règles restrictives, approches « historiques », déclamation, scansion inspirée de la versification latine ou grecque, etc.) : pour Charles Batteux, « les espaces exigés par l’esprit, par les objets, par la respiration, par l’oreille, sont absolument les mêmes dans la prose et dans la poésie » ; pour Michel Bernardy, « le vers français ayant un nombre fixe de syllabes, celles-ci doivent être toutes perceptibles dans l’élon : comme la voyelle est le centre de la syllabe, toutes les voyelles constitutives du vers ont le même droit à l’existence dans le phrasé versifié » ; pour Louis Dubroca, la diction se doit de prononcer toutes les syllabes (voyelles) qui en composent la structure métrique ; pour Georges Le Roy, la ponctuation orale n’est pas toujours en relation directe avec la ponctuation écrite : la ponctuation en vers est soumise au sens, et ne doit jamais être placée après la coupe ou à la fin du vers si elle n’est pas justifiée; pour, la première des césures qu’il importe de pratiquer est celle qui sépare le sujet du verbe : c’est le suspens d’écoute majeur d’une phrase, comme dans « Nabuchodonosor / conquit Jérusalem. » ; pour Henri Meschonnic, l’accent, en français, n’est pas métrique, il est linguistique ; etc.
Les règles de diction présentées ici sont complémentaires à celles évoquées auparavant (basées sur accents toniques, coupes, césures et hémistiches) : elles reposent sur la notion « d’accent de groupe » dépendant du bon positionnement des coupes par rapport aux syntagmes de la phrase. Un syntagme est un ensemble de mots ayant une signification fonctionnelle ; par exemple, comme l’indique Du Marsais dans son encyclopédie, « Alexandre vainquit Darius » est constituée de 3 syntagmes simples : le sujet, le verbe et le complément correspondent à un syntagme nominal (« Alexandre ») et un syntagme verbal (« vainquit Darius) », lui-même constitué d’un verbe (« vainquit ») et d’un autre syntagme nominal objet (« Darius »). Cette phrase transformée en « Alexandre, fils de Philippe et roi de Macédoine, vainquit avec peu de troupe, Darius, roi de Perse, qui était à la tête d’une armée nombreuse. » contient des éléments annexes, qui correspondent à des syntagmes adjectivaux (proposition relative, syntagme prépositionnel, apposition) qui amplifient les syntagmes nominaux, et des syntagmes adverbiaux (proposition circonstancielle, adverbe) qui amplifient le verbe. Lors de la diction, ces éléments adjoints sont tantôt liés, tantôt séparés selon la présence ou l’absence de mots-ligatures (préposition, pronom relatif).
- Coupes entre syntagmes nominaux et verbaux.
Qui veut voyager loin / ménage sa monture.
→ « Qui veut voyager loin » = syntagme nominal
→ « ménage sa monture. » = syntagme verbal
— Jean Racine, Les Plaideurs
L’espoir / changea de camp. / Le combat / changea d’âme.
→ « L’espoir », « Le combat » = syntagmes nominaux
→ « changea de camp », « changea d’âme » = syntagmes verbaux
— Victor Hugo, Les Châtiments, L’Expiation
Que tous ceux qui veulent mourir / lèvent le doigt.
→ « Que tous ceux qui veulent mourir » = syntagme nominal
→ « lèvent le doigt. » = syntagme verbal
— Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac
- Coupes influencées par la position du e caduc (cas où il se place à la jonction de deux syntagmes, juste avant une césure vocale, ce qui allonge la syllabe qui précède et sert à contretemps d’élan de propulsion au syntagme suivant).
Mada_me / voulez-vous que je vous parle net ?
— Molière, Le Misanthrope
- Coupes supplémentaires quand des syntagmes s’ajoutent aux syntagmes nominaux et verbaux.
La valeur / n’attend point le nombre des années.
L’ardeur de vain_cre / cède à la peur de mourir.
— Pierre Corneille, Le Cid
Vous offensez les dieux / auteurs de votre vie ; /
— Jean Racine, Phèdre
- Coupes supplémentaires (obligatoires) en cas de sujets multiples (de pluralisation des termes).
Ses gar_des / son palais / son lit / m’étaient soumis.
— Jean Racine, Britannicus
L’attela_ge / suait / soufflait / était rendu
— Jean de La Fontaine, Fables, Le Coche et la Mouche
Elle trahit mes soins / mes bontés / ma tendresse.
— Molière, L’École des femmes
- Coupes supplémentaires en cas d’ellipse (un élément est sous-entendu ; ceci doit être marqué).
Je l’adorais / vivant, / et je le pleu_re / mort
→ Je l’adorais (quand il était) vivant, et je le pleure (maintenant qu’il est) mort.
— Pierre Corneille, Horace
D’abord / il s’y prit mal, / puis / un peu mieux, / puis / bien.
→ « il s’y prit » est deux fois sous-entendu.
— Jean de La Fontaine, Fables, XII, 9
- Coupes obligatoires en cas de fragmentation d’un syntagme avec déplacement (inversion, ou métaposition21).
De vous faire aucun mal / je n’eus jamais dessein.
— Molière, Tartuffe
Maître corbeau / sur un ar-bre / perché.
→ Le corbeau est perché, et non l’arbre.
— Jean de La Fontaine, Fables, Le Corbeau et le Renard
Source délici_euse / en misè_res / féconde.
→ Les misères ne sont pas fécondes, mais bien la source.
— Pierre Corneille, Polyeucte
Par mes ambassadeurs / mon cœur / vous fut promis.
Ce fils / que / de sa flamme / il me laissa pour gage !
— Jean Racine, Andromaque
- Coupes influencées par l’ordre croissant ou décroissant des syntagmes.
Seigneur / de ce départ / quel est donc le mystère ?
— Jean Racine, Bérénice
La rue assourdissante / autour de moi / hurlait.
— Charles Baudelaire, Les Fleurs du mal, À une passante
- Absence de coupe quand le syntagme a le même nombre de syllabes que le vers ; celui-ci, appelé « vers linéaire », doit être phrasé d’un trait.
Fileur éternel des immobilités bleues
— Arthur Rimbaud, Le Bateau ivre