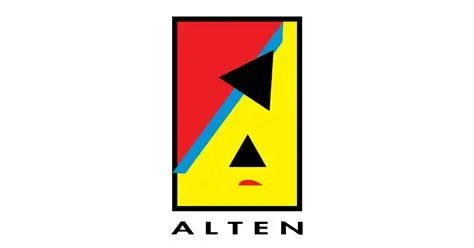L'ONU dans les relations internationales de 1945 à nos jours.
I 1945-1948. la mise en place du système onusien. a) Les objectifs de l'ONU. Dans la Charte de San Francisco sont définis les objectifs suivants : Maintenir la paix. Contribuer au développement économique , social, et sanitaire des Etats. Participer à la protection du patrimoine culturel des nations. Garantir les droits de l'homme et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. b) Ses institutions et ses moyens. L'Assemblée Générale de l'ONU, comprend aujourd'hui 192 ( 2006 - république du Monténégro-51 à l'origine) ) états membres . C'est le principal organe de délibération. Le Conseil de Sécurité est le seul à pouvoir prendre des décisions . Il est chargé du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Il est composé de 15 états membres. Cinq d'entre eux sont membres permanents et ont un droit de veto sur les décisions du conseil : ( Chine , E-U, France Royaume -Uni , Russie). Les autres Etats sont membres non-permanents. Le Conseil de sécurité est le seul organe de l'ONU dont les décisions doivent être respectées par les Etats membres. C'est aussi le seul organe international qui siège en permanence. Ses membres doivent être prêts à tout moment à se réunir en cas de crise. Lorsqu'une situation ou un différend est porté à l'attention du Conseil, celui-ci commence généralement par recommander aux parties de trouver une solution pacifique. Il peut aussi enquêter, servir de médiateur, ou définir les principes d'un règlement. Il peut également nommer des représentants spéciaux ou demander au secrétaire général de prêter ses "bons offices". Si les hostilités ont déjà éclaté, le premier souci du Conseil est d'y mettre fin le plus rapidement possible. Il peut enjoindre aux parties en conflit de déclarer un cessez-le-feu, imposer des sanctions diplomatiques ou économiques ou lancer une action militaire collective. Il peut aussi constituer des opérations de maintien de la paix, c'est-à-dire envoyer dans les zones de troubles des missions multinationales (groupes d'observateurs ou contingents militaires) qui s'emploient à atténuer les tensions et à séparer les forces ennemies pendant que l'on cherche à résoudre le conflit par la diplomatie. Ces "casques bleus" sont placés sous l'autorité du Secrétaire général et les parties en présence doivent consentir à leur intervention. Les casques bleus sont constitués de troupes fournies par les Etats membres. Ils interviennent dans différents pays pour imposer la paix. Le secrétaire général de l'ONU assure les fonctions administratives de l'ONU et peut jouer un rôle diplomatique . Depuis 2007, il s'agit de Ban Ki-Moon ( Corée du Sud) .Il est nommé par l'AG sur recommandation du conseil de sécurité. Le conseil de Tutelle. Il a été créé en vertu du Chapitre XIII de la Charte des Nations Unies afin de surveiller l'administration des territoires sous tutelle et de faire en sorte que les gouvernements chargés de cette administration prennent les mesures qui conviennent pour préparer ces territoires à la réalisation des objectifs énoncés dans la Charte. 11 territoires furent placés sous régime de tutelle. De nos jours, ils ont tous accédé à l'indépendance ou se sont volontairement unis à un Etat pour constituer un pays indépendant. En 1994, le Conseil de sécurité mit un terme à l'accord de tutelle régissant le dernier territoire, Celui des Iles du Pacifique (Palaos), Des organisations spécialisées s'occupent du développement . Exemples : Le PNUD ( programme des nations unies pour le développement) aide les pays du sud à améliorer leur situation économique et sociale. L'ONUSIDA est une agence chargée de la lutte contre le SIDA. L'UNESCO cherche à développer l'éducation , les sciences et à protéger le patrimoine mondial. Par exemple, en 1966, ont débuté les travaux de sauvetage de Venise sous l'égide de l'UNESCO. Pour amener tous les Etats à garantir les droits de l'Homme, en 1948 a été adoptée la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et du Citoyen. Conclusion : Le programme défini pour l'ONU était ambitieux . Des moyens et des institutions spécialisées furent mis en place pour atteindre ces objectifs. L'ONU est-elle parvenue à remplir ses fonctions dans un contexte difficile?
II 1947-1989 : L’ONU enjeu et actrice des relations internationales. a) La contribution onusienne à la décolonisation. L'AG de l'ONU devient la tribune des nouveaux pays indépendants et des peuples souhaitant le devenir. L'impérialisme y est souvent contesté.
Le conseil de tutelle est crée par la charte des nations unies pour permettre à des territoires d’accéder à l’indépendance. En 1958, la France est mise en accusation aux Nations Unies en raison de sa politique algérienne, elle est attaquée par les Etats du Tiers Monde et les Pays communistes sans recevoir, sur ce point, l'appui des Alliés américains et des Britanniques. L'ONU contribue à la gestion des conflits issus de la décolonisation. En 1961 au Congo. En 1965, des observateurs de l'ONU sont placés à la frontière entre l'Inde et le Pakistan. L'ONU favorise également l'e développement du tiers-monde. Ainsi en 1964, fut créée la CNUCED (Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement). b) L'ONU dans la guerre froide. Au début de la période , l'ONU peut apparaître comme l’instrument de la politique d'endiguement menée par les Etats-Unis contre l'URSS. En effet, de 1950 à 1953, les troupes américaines sous pavillon onusien interviennent en Corée. Le droit de veto utilisé par l'URSS est contourné car l'Assemblée Générale se saisit de la question.
C'est aussi le lieu d'affrontements et de joutes verbales entre les deux grands. Le 29 septembre 1960, lors de la quinzième session de l'Assemblée générale des Nations unies, Nikita Khrouchtchev (1894-1971) sort de ses gonds lors d'un discours du Premier ministre britannique Harold MacMillan (1894-1986). Pour se faire entendre , il se déchausse et frappe son pupitre avec sa chaussure. Seulement, dans cette période l'ONU en retrait dans des conflits majeurs : au Vietnam, en Afghanistan. Dans le même temps, à l'ONU s'affirme une troisième puissance. En 1971, la République populaire de Chine est admise à l'ONU où elle remplace Taiwan (la Chine nationaliste) c) Des interventions nombreuses mais une autorité limitée au Moyen-Orient . L'ONU se déclare favorable à la partition de la Palestine, le 29 novembre 1947 et propose une carte où Jérusalem est internationalisée. En 1948, Israël est attaqué par ses voisins. A la fin de la guerre des observateurs sont envoyés pour surveiller le bon déroulement de la trêve. Après l'affaire de Suez : la région du canal est contrôlée par les troupes de l'ONU. Nasser exige le retrait de ces troupes . Le 6 juin 1967, Israël lance une attaque préventive contre l' Egypte . C' est la guerre des 6 jours. Le conseil de sécurité adopte alors à l'unanimité la résolution 242 sur le retrait des forces israéliennes des territoires occupés et l'établissement de la paix durable. Cette résolution n'est toujours pas appliquée par Israël. Au Liban les casques bleus ne parviennent pas à maintenir la paix. En 1988, Perez de Cuellar (secrétaire général) joue un rôle de médiateur dans le conflit Iran-Irak. Conclusion : L'ONU participe au processus de décolonisation, elle est aussi un peu le jouet des deux grands dans le cadre de la guerre froide. Mais déjà s'affirme sont rôle dans le maintien de la paix. Dans ces domaines, l'ONU connaît des échecs et des réussites.
III De 1989 à nos jours : Des interventions mais une autorités limitée face aux conflits de l’après-guerre froide. a) La mise à contribution des forces d’interpositions dans les conflits de l’après guerre froide. Les guerres n'ont pas disparu avec la fin de la guerre froide. En Europe La résurgence des revendications nationales provoque également l'éclatement de certains Etats, comme le prouve la division de la République socialiste fédérative de Yougoslavie mise en place par Tito en 1946, en 5 États (Slovénie, Croatie, Bosnie-Herzégovine, République fédérative de Yougoslavie ( Serbie-Monténégro ), Macédoine). Au cours du premier conflit dans cette région, la FORPRONU (FORCE DE PROTECTION DES NATIONS UNIES ) est mise en place entre 92 et 95 pour tenter de créer les conditions de paix et de sécurité nécessaires à la négociation d'un règlement d'ensemble de la crise yougoslave. En Afrique L'Europe n'est pas le seul terrain d'opérations. Les casques bleus interviennent aussi souvent en Afrique dans le cadre de conflits internes. Par exemple, depuis mai 2003 la Mission des Nations Unies en Côte d'Ivoire (MINUCI) intervient en Côte d'Ivoire. Au Moyen-Orient D'abord des opérations engagées par l'ONU au Proche-Orient sont encore en cours. L' Organisme (ONUST) des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve en Palestine est toujours en place. Depuis mars 1978, la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL) surveille la frontière entre Israël et le Liban. Dans le Golfe persique, l'ONU a condamné l'invasion du Koweït par l' Irak en 1990 et la Résolution 678 autorise le recours à la force contre l'Irak si, le 15 janvier 1991 ce pays n'a pas évacué le Koweït. Par la suite (1991), la Mission d'observation de l'ONU à la Frontière entre le Koweït et l'Irak (MONUIK) fut mise en place. Soumis à l'embargo depuis 1990 (résolution 661 des Nations unies), l'Irak pouvait vendre depuis 1996 une quantité limitée de pétrole par phase de six mois en vertu du programme pétrole contre nourriture instauré par la résolution 986, du 15 avril 1995 afin de " répondre à titre de mesure temporaire aux besoins humanitaires du peuple irakien. " b) un rôle désormais limité dans l'accès à l'indépendance. L'ONU a amené le Timor oriental à l'indépendance . En 1974, le Portugal a essayé de mettre en place un gouvernement provisoire et une assemblée populaire qui détermineraient le statut du Timor oriental. Une guerre civile a éclaté entre les tenants de l'indépendance et les partisans d'une intégration avec l'Indonésie. Devant une situation qu'il ne pouvait maîtriser, le Portugal s'est retiré. L'Indonésie est alors intervenue militairement et a par la suite annexé à son territoire le Timor oriental dont elle a fait sa vingt-septième province. L'Organisation des Nations Unies n'a jamais reconnu cette annexion, et le Conseil de sécurité comme l'Assemblée générale ont demandé le retrait de l'Indonésie. Une mission de paix fut établie au Timor. Le 20 mai 2202, le Timor oriental est devenu une nation indépendante et le 192ème Etat membre de l'ONU.
Le conseil de Tutelle disparaît avec l’accession à l’indépendance des ïles Palaos ( EU) en 1994.
c) La question de l'autorité de l'ONU Au début de la période l'ONU a pu apparaître comme dépendante des Etats-Unis. Ces derniers sont en principe les principaux contributeurs et Kofi Annan , secrétaire général des nations unies, élu en 1997 puis réélu en 2001 fut d'abord le candidat des Etats-Unis contre Boutros Boutros Ghali candidat des français. Mais les Etats-Unis ont pris leurs distances vis à vis d'une institution qui s'est révélée peu servile. Déjà au Kosovo, en 1999, L'OTAN interviennent au Kosovo sans mandat de l'ONU. L'Union européenne a tenté de jouer un rôle moteur dans la gestion de la crise. Très vite cependant, les Etats-Unis via l'OTAN ont repris le contrôle du processus diplomatique et militaire. Le contrôle des opérations par le Commandement suprême allié en Europe, placé sous direction américaine et la confidentialité du choix des cibles lorsque le Pentagone mit en œuvre ses armes les plus stratégiques (bombardiers B1, B2 et missiles de croisière Tomahawk) illustrent cette suprématie des E-U dans l'OTAN. L'ONU a dû se contenter de fournir une force internationale de maintien de la paix (KFOR) Cette défiance des Etats-Unis vis à vis de l'ONU fut confirmée par le refus des E-U d'attendre la fin de la mission des inspecteurs de l'ONU en Irak sur l'élimination des armes de destruction massive et par l'entrée en guerre sans mandat voté par les 15 membres du Conseil de Sécurité. Les Etats-Unis semblent bafouer le droit international en menant une guerre dite préventive et refusent à l'ONU un rôle dan le contrôle de l'après-guerre.
Aujourd’hui, le nouveau secrétaire général, le coréen Ban Ki-Moon a beau exporter les puissances du Proche-Orient à la paix. On sent actuellement les moyen de l’ONU plutôt limités.
Conclusion : Il apparaît que l'ONU est une organisation, qui reste nécessaire dans le contexte actuel en particulier pour la maintien de la paix. Cependant son autorité est remise en cause compte tenu de la faiblesse de ses moyens et de la défiance de la plus grande des puissances mondiales. Conclusion générale : L'ONU a participé activement au processus de décolonisation. Elle a rempli et continue à remplir son rôle dans le maintien de la paix. Cependant aujourd'hui, on peut dire que l'institution connaît une crise. Certains contestent son utilité , d'autres discutent de son efficacité , les derniers se sont interrogés sur son indépendance.
Moyen-Orient : Egypte , Turquie, Israël, Syrie, Jordanie, Liban, EAU, Iran , Irak, Koweït, EAU, Yémen , Qatar, Oman , Bahrein. Proche-Orient : Egypte , Turquie, Israël, Syrie, Jordanie, Liban.
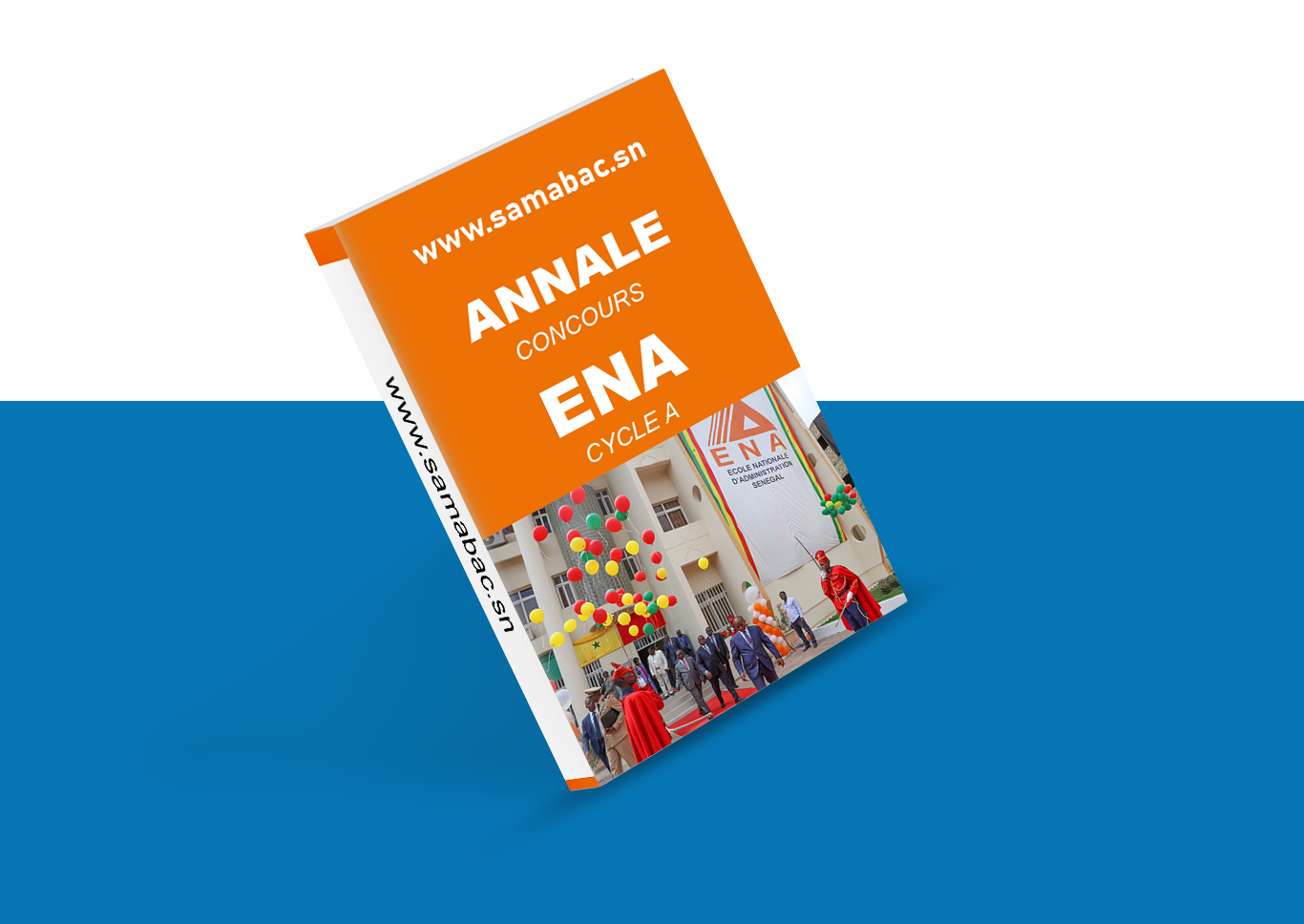

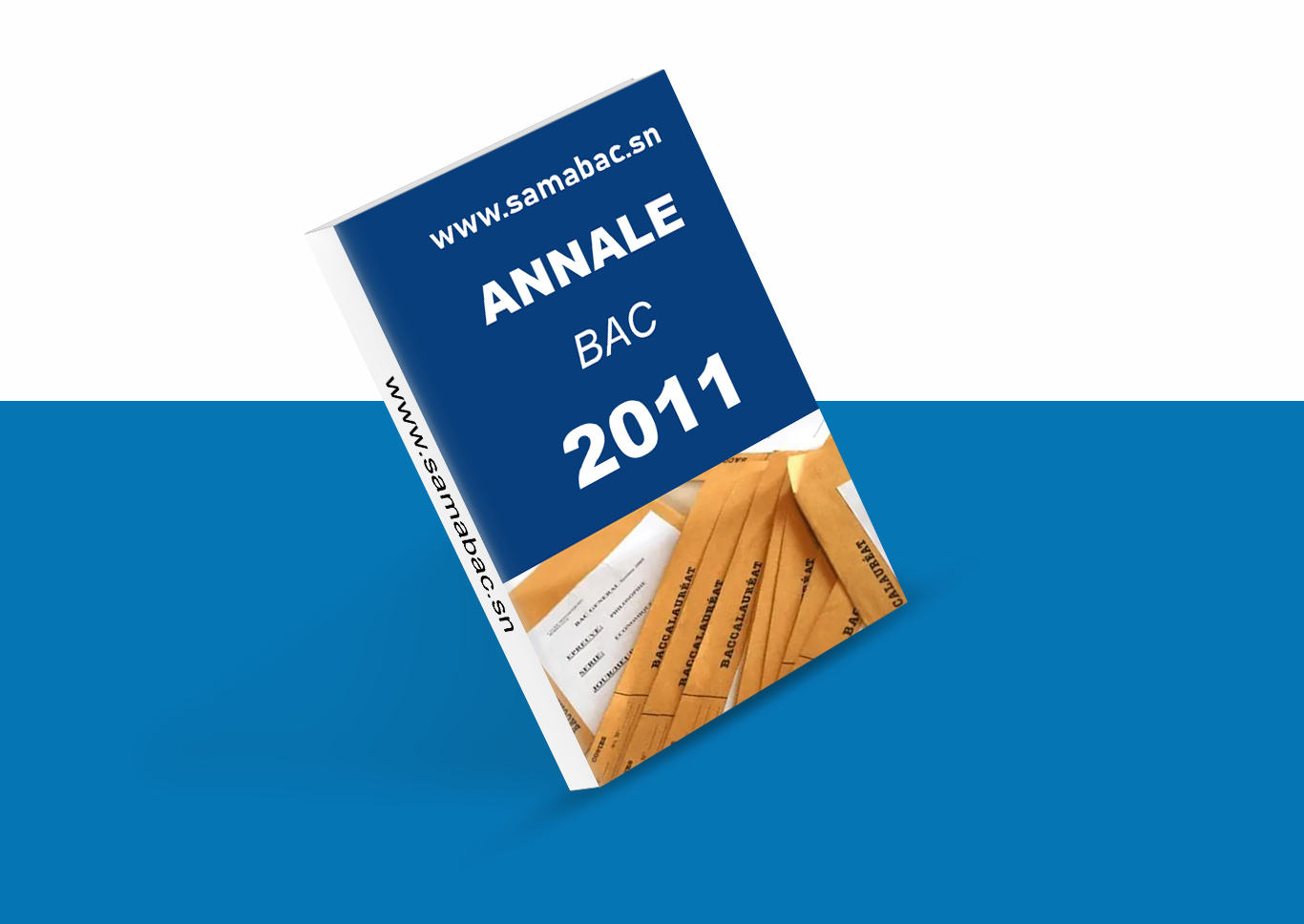
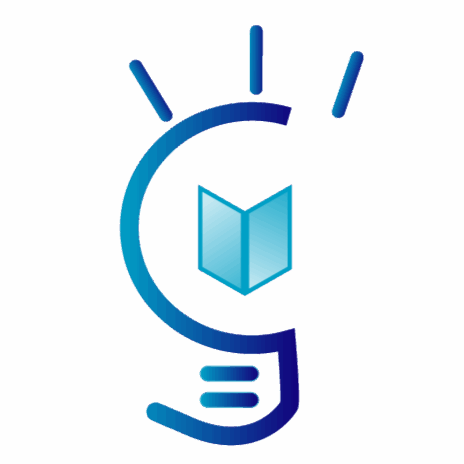




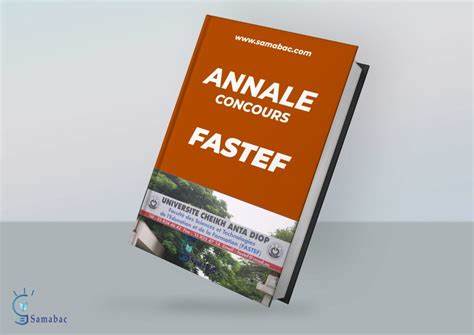




.jpeg)