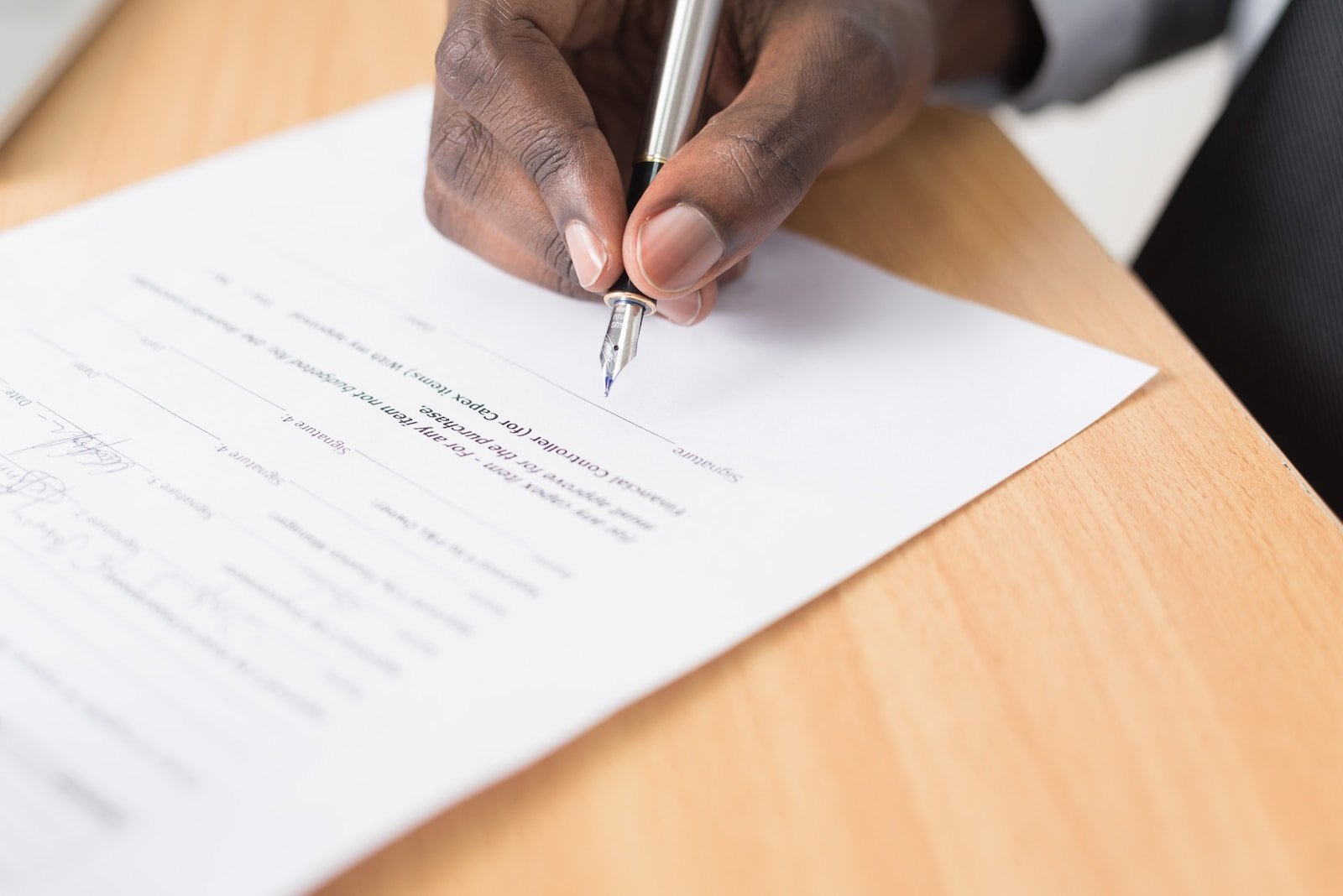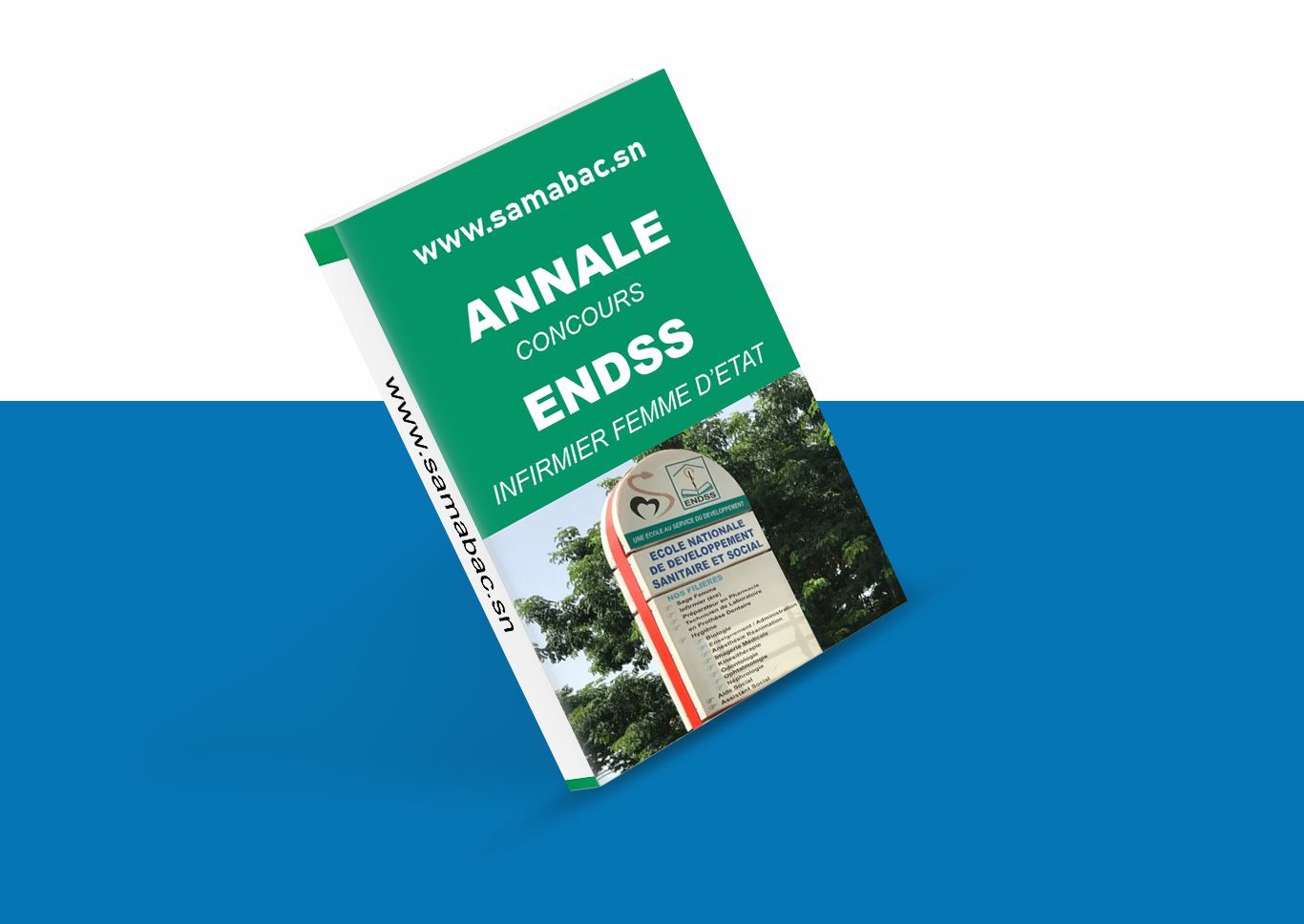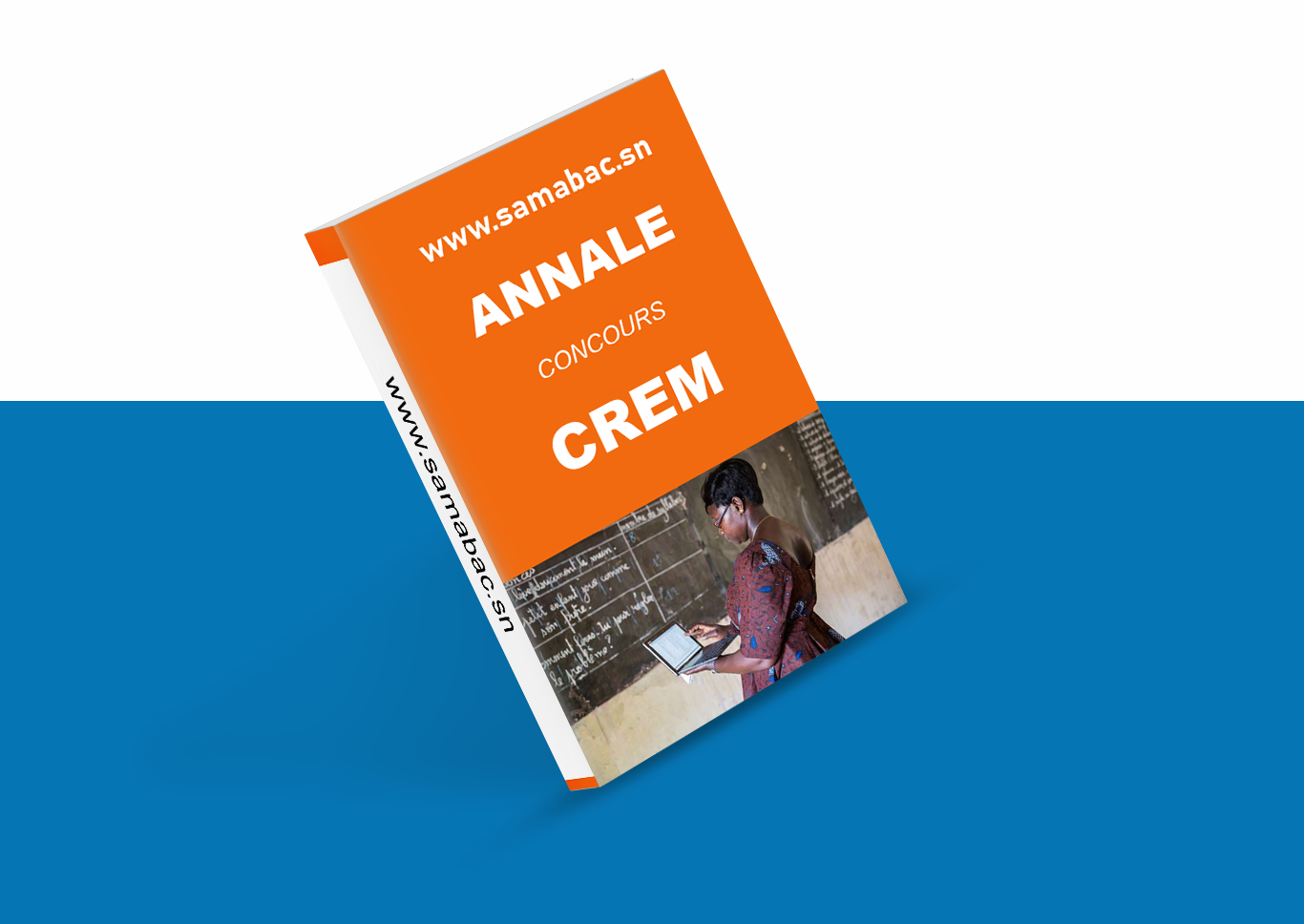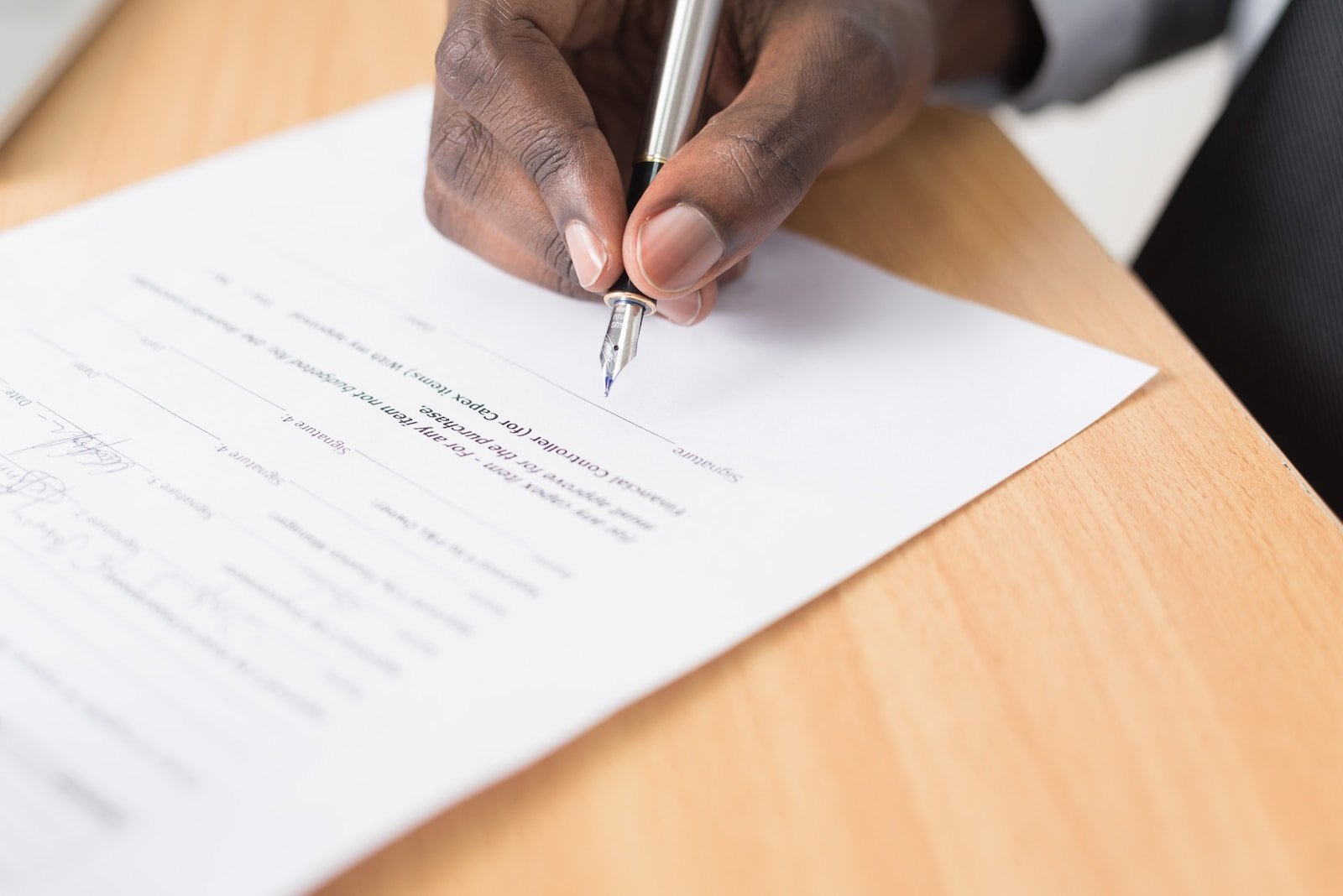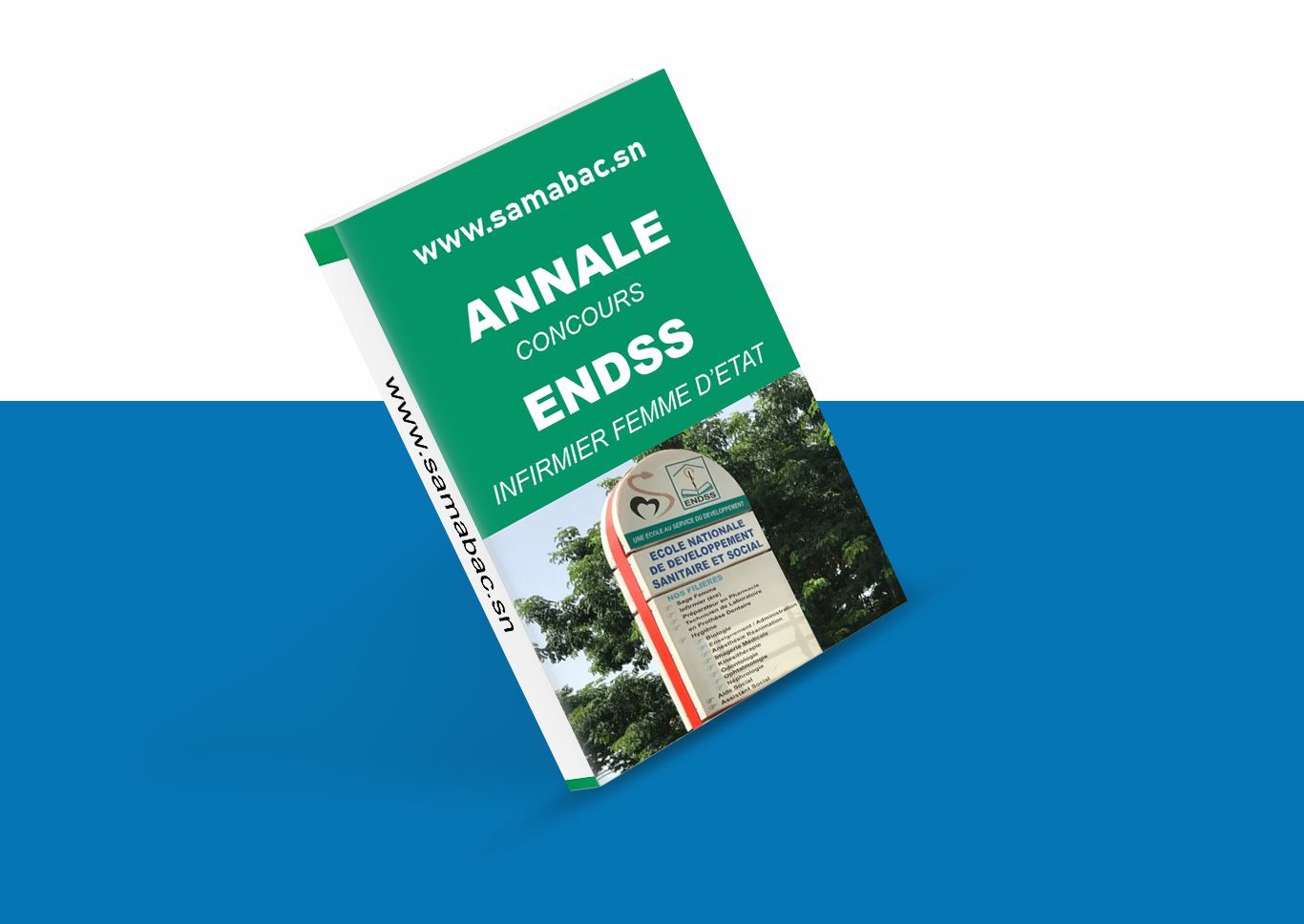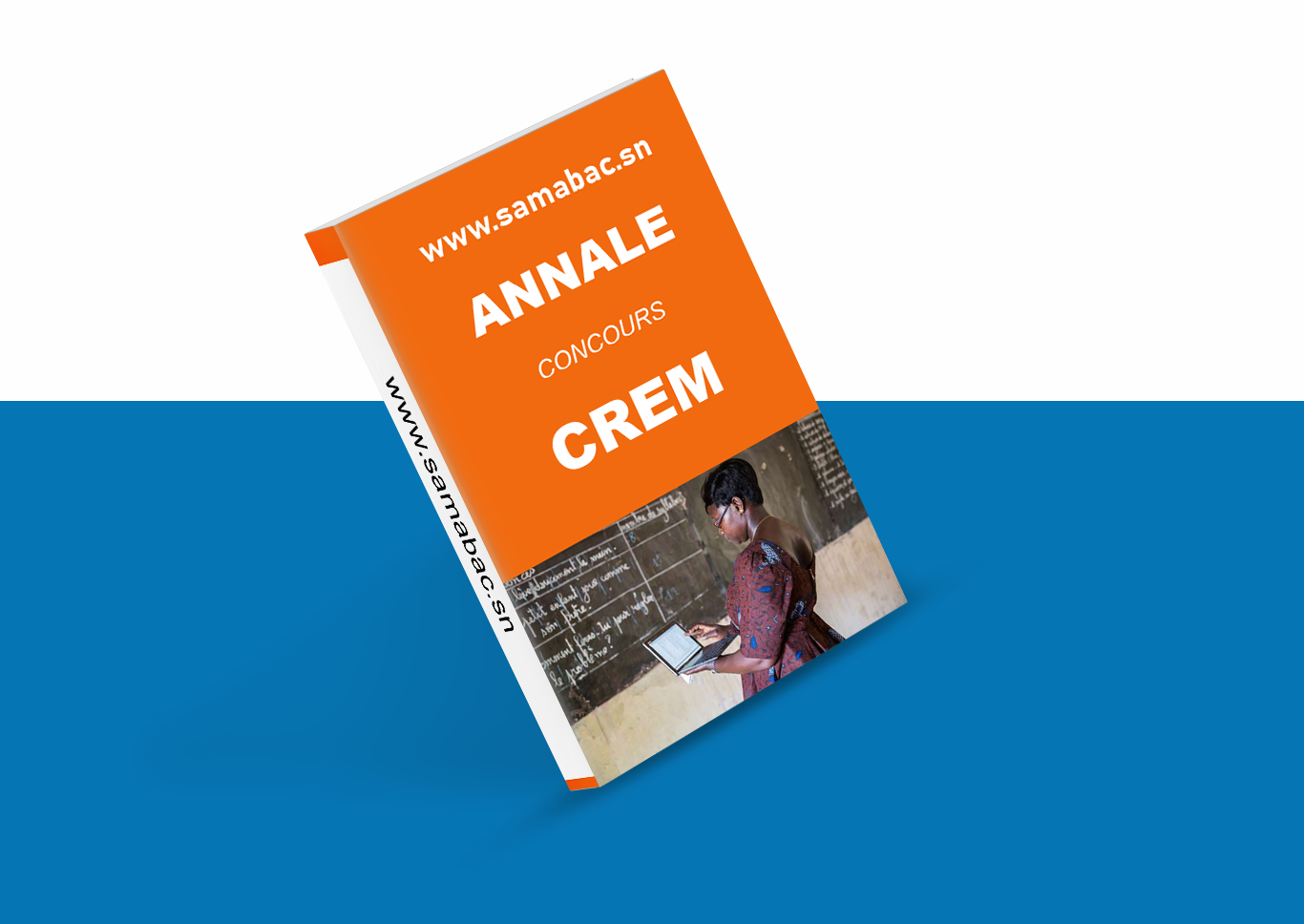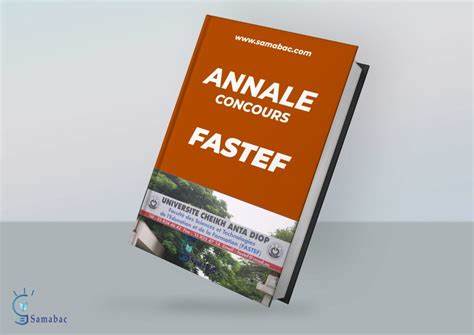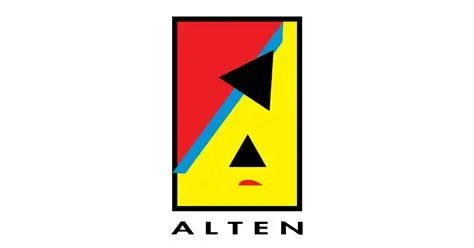CORRECTION DE L'EXERCICE DE Q.C.M.
sur LE REALISME et LE NATURALISME
1. VOICI LE BON ORDRE D’APPARITION DE CES COURANTS LITTÉRAIRES :
- Romantisme – Réalisme – Naturalisme.
Des écrivains appelés « romantiques » furent les premiers à s’illustrer jusqu’aux frontières des années 1850. Il ne serait donc pas prétentieux de penser que toute la première moitié du XIXème siècle est romantique, c’est-à-dire principalement dévouée à l’expression du moi.
Toutefois, désireux de se détourner de cet égocentrisme qui ne disait pas son nom, surnommés « réalistes », des artistes ont décidé de faire du réel leur principale source d’investigation. Désormais, cette frange de la classe prolétaire et apparemment méprisée par la plupart des écrivains devient la source d’inspiration privilégiée.
Plus tard apparaissent d’autres écrivains, les « naturalistes » en l’occurrence, qui iront non seulement dans la même mouvance mais, mieux encore, essayeront de donner à l’activité créatrice littéraire une dimension plus scientifique par l’observation d’abord, l’analyse ensuite et la déduction enfin ; pour ce faire, le déterminisme du milieu et la loi de l’hérédité seront investis. Comme preuve, pour ce qui s’agit par exemple de la loi de l’hérédité, dans L’Assommoir (1877), Gervaise, une lingère, est condamnée à l’alcoolisme et à la misère, tout comme l’était son père, Antoine Macquart dans La Fortune des Rougon (1871).
2. L’AUTEUR AYANT PRODUIT LE PLUS GRAND NOMBRE D’ŒUVRES EST :
- Balzac.
De son vivant, on se demande souvent : combien d’œuvres cet auteur a-t-il fait paraître ? En référence à La Divine Comédie de Dante, cet auteur crée un ensemble de livres qui se tiennent entre eux, un peu comme des épisodes, pour former ce qu’il appelle La Comédie Humaine. Cet auteur est une bête au travail, désireux qu’il ‘était de vouloir « concurrencer l’état civil » : nulla dies sine linea !
Sa célèbre cafetière conservée à la Maison de Balzac à Paris lui faisait infuser près de 50 tasses (il travaillait seize heures par jour !) afin de stimuler son imagination et sa concentration. Sans parler de ses nouvelles (près de 90), ses 95 romans concentrent 2500 personnages aux conditions sociales et aux statuts professionnels divers, abstraction faite sur ceux qui n’influencent ni l’organisation ni la progression du récit. Endetté à cause de son train de vie dispendieux et peu recommandable, il s’échina sur ses œuvres qu’il écrivait à vitesse folle, afin de rembourser ses dettes et vivre de sa plume avec ses droits d’auteur. Une autre anecdote raconte même que, pour dédommager son couturier M. Buisson auprès de qui il avait contracté des dettes, il faisait la publicité de son local dans ses romans et vantait ses coutures dont il affublait ses personnages pour attirer la clientèle. Enfin, pour échapper à ses créanciers, il s’est établi à Paris sous une fausse identité : Monsieur de Breugnol.
Raconter tout ceci, c’est laisser entrevoir l’activité cérébrale intense à laquelle s’adonnait cette figure imposante du réalisme.
3. LE CHEF DE FILE INCONTESTABLE DU NATURALISME EST :
- Emile Zola.
Déja dans la préface de Thérèse Raquin (1867), Zola théorisait ce qu’il entend restructurer dans ce qui s’appelait communément « le réalisme ». Plus tard, lorsque l'idée prenait mieux forme, cet auteur expose cette pensée dans deux textes fondateurs pouvant être considérés comme de véritables manifestes du naturalisme : Le roman expérimental (1880) et Les Romanciers naturalistes (1881). Il s’y donne pour objectif de faire la description exacte et scientifique des milieux sociaux, l’étude des mécanismes de la société, tels qu’ils influencent les individus et la restitution de toute la vérité, indépendamment du souci esthétique et moral. Son œuvre gigantesque est une saga de vingt romans où tout se tient et dont les arcanes entretiennent des combinaisons savamment organisées mieux que n’importe quel autre auteur de sa génération.
4. « Le roman est un miroir qui se promène sur une grande route ».
L’AUTEUR DE CES PROPOS EST :
- Stendhal.
Voici la suite de sa citation : « tantôt il reflète à vos yeux l’azur des cieux, tantôt la fange des bourbiers de la route. Et l’homme qui porte le miroir dans sa hotte sera par vous accusé d’être immoral ! Son miroir montre la fange et vous accusez le miroir ! Accusez bien plutôt le grand chemin où est le bourbier, et plus encore l’inspecteur des routes qui laisse l’eau croupir et le bourbier se former ».
Si je poursuis ces propos, c’est pour faire comprendre qu’il s’agit d’une métaphore filée qui assimile d’abord le roman et le miroir que porte un homme dans sa hotte ; cet homme qui porte le miroir, c’est l’écrivain réaliste préoccupé par le voeu pieux de reproduire la réalité avec exactitude (le miroir). L’azur des cieux, c’est l’idéal (bonnes mœurs, esthétique). Et la fange des bourbiers ? Eh bien c’est le mal, l’injustice, la laideur qui répugne. La suite est comme une sorte de réponse à tous ceux qui se trompent de cible en critiquant l’écrivain réaliste dans ses sujets de prédilection (les inégalités sociales) plutôt que le sujet lui-même alimenté, entretenu par ceux qui y trouvent leur compte (les capitalistes bourgeois).
5. CES DEUX COURANTS LITTÉRAIRES SONT NÉS EN RÉACTION CONTRE LE ROMANTISME À CAUSE DE :
- son excès de lyrisme.
C’est le principal reproche fait aux romantiques, sans oublier ce goût démesuré voué à l’imagination. Réalistes et naturalistes se sont rendu compte qu’il y a une littérature moins égoïste, plus urgente et qui consiste à s’appesantir sur le vécu quotidien de désœuvrés victimes du machinisme et du capitalisme appelés prolétaires. Ces déshérités de la Révolution industrielle avaient donc droit au chapitre au détriment de l’expression d’une individualité.
Pour répondre à cette critique que les réalistes adressent aux romantiques, afin de démontrer que ce moi est autant individuel qu’universel, Victor Hugo écrit une partie de sa vibrante préface des Contemplations (1856) en leur direction par ces mots : « ma vie est la vôtre ; votre vie est la mienne […]. On se plaint quelques fois des écrivains qui disent moi. Parlez-nous de nous, leur crie-t-on. Hélas ! quand je vous parle de moi, je vous parle de vous. Comment ne le sentez-vous pas ? Ah ! insensé qui crois que je ne suis pas toi ».
6. RÉALISME ET NATURALISME S’INSPIRENT :
- de la misère du peuple.
Nous sommes au XIXème siècle, la Révolution industrielle bat son plein. Malheureusement, les découvertes qui en ont découlé créent des inégalités sociales plus béantes. Victimes du machinisme, c’est-à-dire le remplacement du travail de l’homme par la machine, surtout dans le milieu agraire, plusieurs ouvriers se retrouvent dans le chômage et exposés à tous les maux sociaux tels que la misère et son corollaire (exploitation ouvrière, prostitution, drogue, alcoolisme, banditisme…).
Il y a donc urgence de peindre « ce monde sous un monde » pour parler comme les frères Goncourt, de faire sentir cette « odeur du peuple » pour emprunter l’expression à Emile Zola. Ces écrivains focalisent ainsi toute leur attention sur cette source d’inspiration qui semblait jusque-là aviir été méprisée par les écrivains. Les naturalistes, comme on le sait, iront beaucoup plus loin en donnant à leur activité créatrice des contours quasi scientifiques.
7. LE GENRE LITTÉRAIRE PRIVILÉGIÉ PAR CES DEUX COURANTS LITTÉRAIRES EST :
- le roman.
C'est devenu comme un pléonasme (une répétition inutile) quand on emploie l'expression « romancier réaliste » parce que l'écrasante majorité des réalistes et naturalistes est constituée de romanciers. De Balzac (Le Père Goriot) à Stendhal (Le Rouge et le Noir), en passant par Flaubert (Madame Bovary), les frères Goncourt (Germinie Lacerteux), Maupassant (Une Vie), Zola (Germinal),… tous sont des romanciers.
Pourquoi donc le choix de ce genre littéraire proprement dit au détriment des autres ? C'est parce que la poésie est trop réglementaire et ceux qui l'emploient l'utilisent généralement pour la description. C'est parce que le théâtre se consacre essentiellement à la représentation des scènes de dialogue.
C'est plutôt le roman qui permet le mieux, et plus aisément, de restituer fidèlement le réel sous tous ses angles, de narrativiser une opinion, selon les nécessités esthétiques. Là, l'écrivain est capable de produire des passages descriptifs, des séquences narratives, des scènes de dialogue, selon l'exigence stylistique qui s'impose dans l'œuvre et surtout son lien avec le projet de départ : la réalité, rien que la réalité, toute la réalité.
8. CES AUTEURS SUSCITENT HORREUR, INDIGNATION ET SOLIDARITÉ DANS LA PEINTURE QU’ILS FONT DE LA CLASSE SOCIALE DITE :
- des prolétaires.
Ce que vit cette classe désœuvrée, défavorisée par le sort, ces écrivains le mettent complètement à nu, si complètement que cet acte d’écrire choque, heurte les sensibilités qui ne sont pas habituées à entendre un vocabulaire ordurier ni à voir de façon si détaillée la précarité troublante où croupissent ces misérables et reproduite avec une fidélité sans ménagement de la bienséance et vécue par cette frange de la société. L’horreur, c’est ce qu’elle vit ; l’indignation, c’est la critique adressée à l’encontre de ces écrivains qualifiés à la limite de « dégueulasses » ; la solidarité, c’est pourtant tout ce que ces derniers espèrent des âmes sensibles indignées.
9. VOICI UNE ŒUVRE D’UN AUTEUR RÉALISTE :
- Madame Bovary.
Inspirée d’un fait divers, l’histoire est celle d’une femme qui a commis l’erreur de prendre la réalité comme une illusion et l’illusion comme la réalité. Ayant grandi dans un couvent, elle passait le plus clair de son temps à lire dans la bibliothèque de cet établissement religieux des romans à l’eau de rose. En contact avec ce monde imaginaire, elle fit la connaissance de l’amant idéal, des milieux merveilleux, du goût du luxe et de l'exotisme…
Malheureusement, sortie du couvent et se retrouvant nez à nez devant le monde réel, elle est désabusée mais reste convaincue qu’il est possible de transposer ses rêves dans le réel ô combien cruel avec sa face hideuse : primo, le mari que le destin lui a choisi est balourd même si celui-ci l’aime passionnément et fait de son mieux ; secundo, l’endroit où elle se trouve, pourtant calme et peuplé de gens paisibles, n’a rien à voir avec ces milieux féériques où elle avait pris place dans son imagination ; tertio, le temps qui s’écoule, lent à faire mourir d’ennui et si long à supporter, n’offre aucune perspective de changement. Pire, les quelques évènements auxquels elle assiste l’écœurent davantage car dévoilant sa situation sociale et le peu de hauteur d’esprit de son entourage familier.
C’est alors que commence la descente aux enfers ; elle commet l’adultère avec des amants qui, l’un après l’autre, ne répondent toujours pas à ses rêves. Elle s’endette pour leur faire plaisir (toilette, meubles, décorations…) sans que ni l’un ni l’autre ne mesurent ou ne comprennent toute la circonférence de son élan passionné. Elle fait des dépressions puis finit par capituler : elle boira du poison pour enfin avoir la paix dans ce monde où les rêves ne sont que rarement destinés à suivre la trajectoire qu’on leur avait tracée.
Vous l’aurez remarqué quand bien même vous pourriez ne pas partager ma perception des choses : mon analyse de ce récit glaçant tente de faire d’Emma une héroïne victime, une folle furieuse qui se bat pour croire en ses rêves de félicité jusqu’à ses derniers instants de vie sur terre, plutôt qu’une simple amatrice de romans qui l’ont perdue en lui rendant la tête farcie d’illusions.
10. VOICI UNE ŒUVRE D’UN AUTEUR NATURALISTE :
- Germinal.
C’est le treizième roman de Zola ; bien qu’il ait écrit près d’une vingtaine réunie autour d’une saga : histoire naturelle et sociale d’une famille sous le Second Empire, cette œuvre est incontournable.
Publié en 1885, l’œuvre raconte les mésaventures d’un chômeur, Etienne Lantier en l’occurrence, venu chercher du travail dans la mine de Montsou. Il fait connaissance avec une famille de mineurs, les Maheu, et tombe amoureux de leur fille Catherine, maîtresse d’un ouvrier brutal nommé Chaval. C’est l’occasion pour l’auteur de démontrer l’exploitation ouvrière et la vie misérable dont est victime cette classe à l’image de Bonnemort, le doyen de la mine. Non content de s'adonner à une véritable exploitation, l’entreprise décide de baisser les salaires. Écœuré, Etienne organise une grève qui sera matée dans le sang. Affamés, les ouvriers se résignent et reprennent le travail malgré le sabotage de la mine par Souvarine, un ouvrier anarchiste. Craignant pour sa vie car activement recherché par les gendarmes, il quitte la ville de Monstou comme il y était venu : sans le sou !
L’objectif de l’auteur des Rougon-Macquart est donc clair : dévoiler la lente germination d’un nouveau monde sous le vacillement de l’ancien. D’ailleurs, dès les premières pages et dans toute la première partie du roman, apparait un monde souterrain, une réalité cachée qui, petit à petit, envahit les lieux extérieurs et protégés. Il s’agit d’un combat à la fois individuel et collectif, celui de la vérité contre l’ignorance, celui de la justice contre l’incompréhension. Ainsi, l’œuvre est à la fois celle d’une sombre beauté, d’une force inquiétante et d’une cruelle actualité.
Issa Laye Diaw
Donneur universel
WhatsApp : +221782321749
Page Facebook :
https://www.facebook.com/profile.php?id=100044574573212