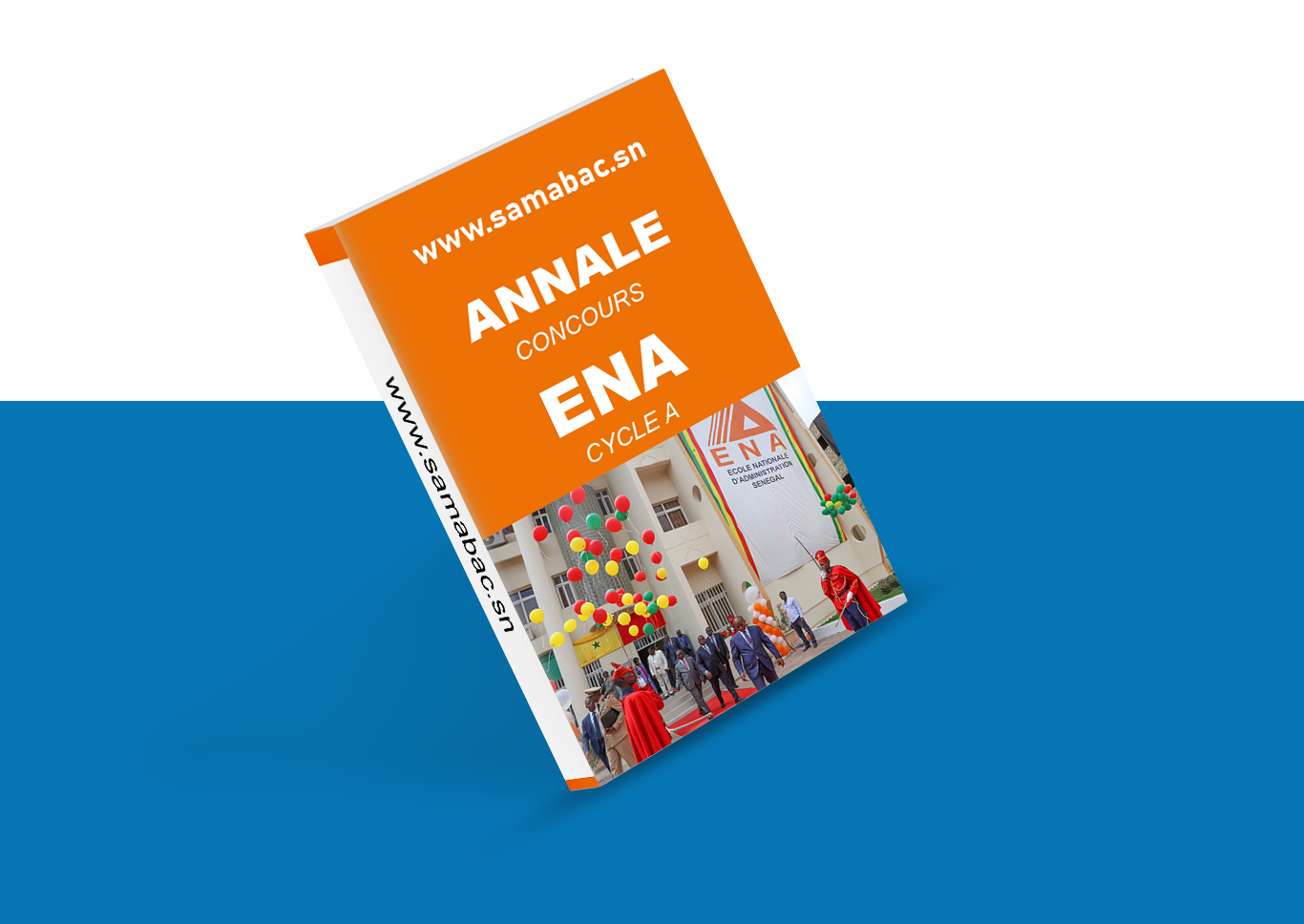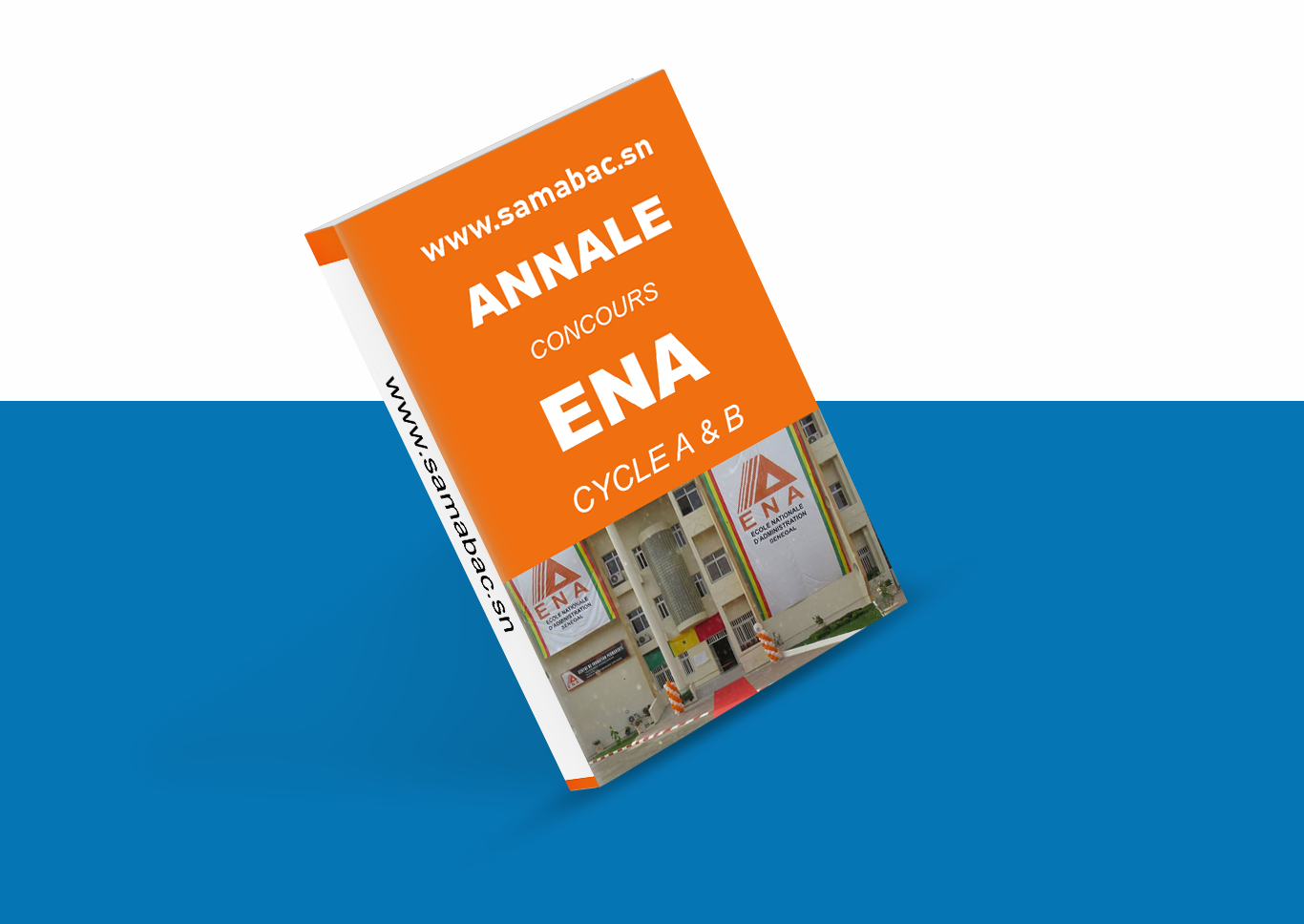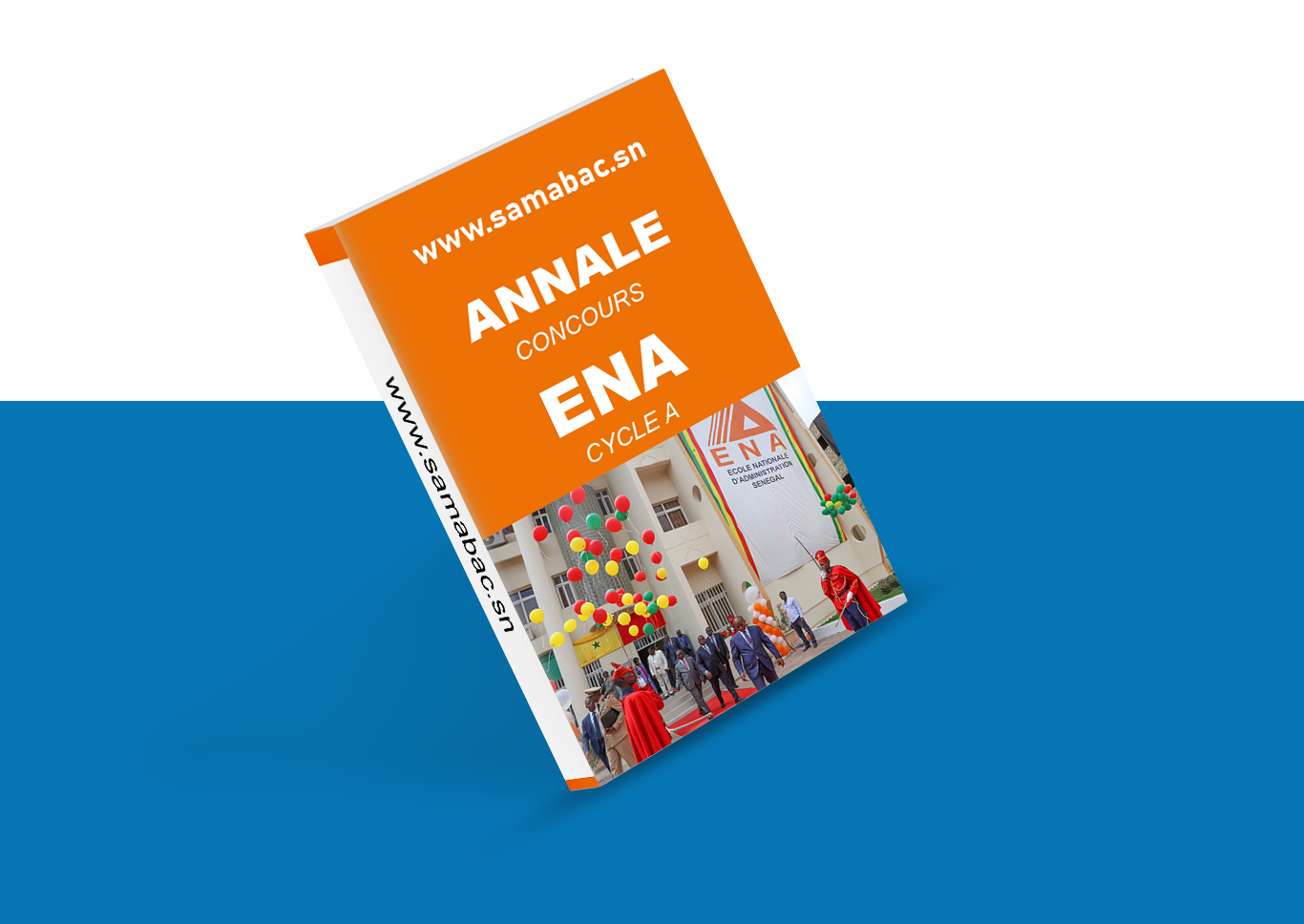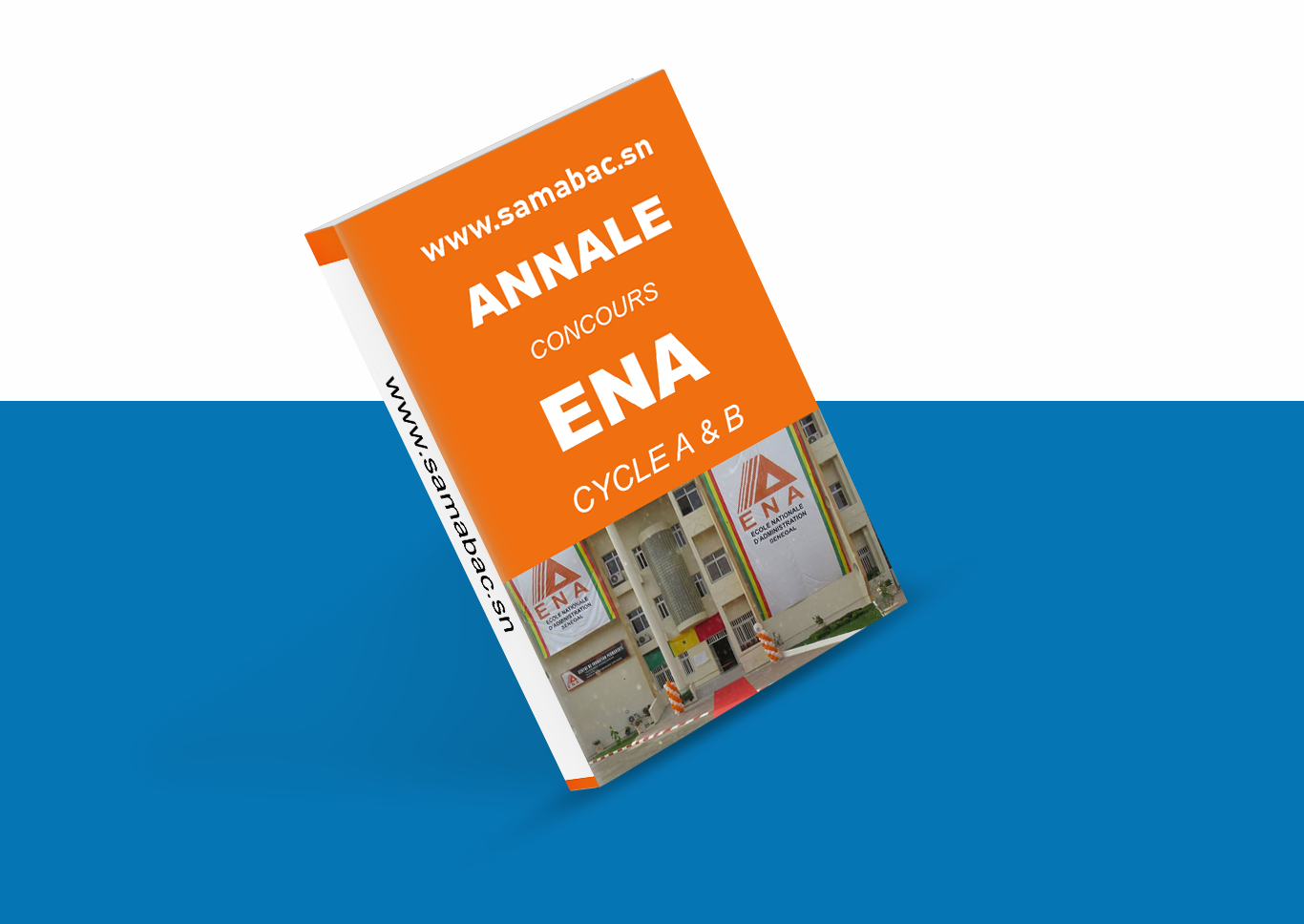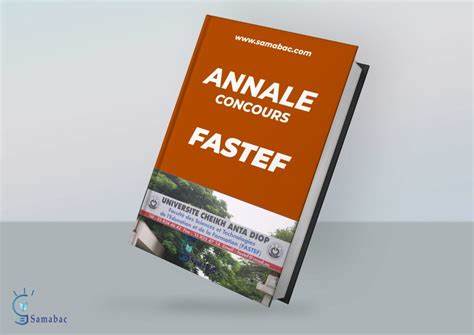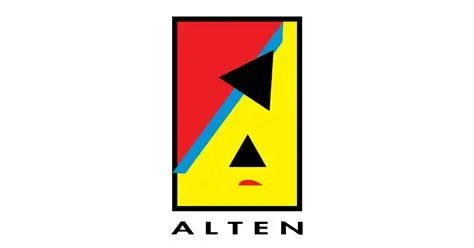1. CE COURANT LITTÉRAIRE EST APPARU
☆ au XVIème siècle.
D’abord une chose importante : les chiffres romains ! Il faut toujours s'en servir quand on parle de siècle. Ce sont les dates et les années qu'on écrit en chiffres arabes.
Autre chose : c'est donc durant les années 1500 que, emporté par cette impulsion boulimique du savoir reconnue au vaste mouvement de la Renaissance, l'humanisme a vu le jour.
2. L'HUMANISME A MIS FIN
☆ à l'époque médiévale.
En effet, ”médiéval” est l'adjectif qualificatif relatif au nom ”moyen-âge” (moine médiéval, églises médiévales, instrument de musique médiéval, etc.). On n'oublie pas non plus l'adjectif ”moyenâgeux”, surtout pour préciser son emploi souvent péjoratif (habits moyenâgeux, pensée moyenâgeuse, chemin moyenâgeux, etc.).
Dans l'échelle du temps, cette époque précède l'humanisme et concerne les années qui se situent entre l’Antiquité et la Renaissance, c'est-à-dire de la chute de l’empire romain d’Occident (476) à la chute de l’empire romain d’Orient (1453).
Ces précisions permettent d'éviter les anachronismes et de pouvoir inscrire dans le temps et lespa cette période faste. Mieux encore, cette rupture est d'autant plus idéologique que temporelle car les connaissances dogmatiques sont désormais de plus en plus contestées.
3. LE ROI QUI RÉGNAIT EN FRANCE À CETTE ÉPOQUE S'APPELLE
☆ François I.
Il serait bien maladroit de parler de cette période de bouillonnement culturel et technoscientifique sans mentionner ce monarque dont le règne s'étend de 1515 à 1547, ô combien épris de tout ce qui a trait à l'élégance culturelle et à la civilisation moderne. Mécène de première heure, c'est lui qui encouragea, d’Italie en France, le convoiement inspirant des productions artistiques et techniques. Si, après ses obsèques, son cercueil fut descendu dans la crypte de l’abbaye royale de Saint-Denis, c’est parce qu’il incarne véritablement le symbole de la Renaissance française.
4. C'EST À CETTE ÉPOQUE QU'ON A DÉCOUVERT
☆ l’imprimerie.
L’imprimerie aussi mérite d'être évoquée. Désormais, les pensées critiques et innovantes peuvent être mises à l'écrit et plus vite diffusées en grand nombre. Le public y a désormais accès avec plus d’aisance (même la Bible est accessible à tout lettré et pas uniquement au clergé) au point que même les analphabètes s'inscrivent plus abondamment dans les écoles pour apprendre à lire et écrire. Quant aux intellectuels en général, aux littéraires en particulier, ils s’investissent dans cette dynamique pour produire des œuvres et enfin vivre de leur plume.
5. ÉTAIT AU CENTRE DES PRÉOCCUPATIONS HUMANISTES
☆ l'homme.
Toutes ces découvertes avaient pour objectif d’assurer à l'être humain une vie meilleure où les limites de l'ignorance seront repoussées encore plus loin. Pour ce faire, externe comme inhérent à l'homme, aucun domaine ne sera négligé, ni son anatomie ni son environnement. Ainsi, l'homme découvre qu'il reste énormément de choses à découvrir, à remettre en question, à maîtriser par conséquent, pour mieux vivre dans son milieu. Cette seule raison nouvelle suffirait à faire de l'espèce humaine un vaste champ d'investigation. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles cette période historique fut dénommée la ”Renaissance”.
6. L’AUTEUR FRANÇOIS RABELAIS EST
☆ un conteur.
Le conte ressemble au roman par le caractère linéaire du récit et la présence d'un narrateur. Néanmoins, la distance entre eux deux soulignée révèle bien des différences.
Récit d’aventures imaginaires, soit qu’elles aient de la vraisemblance ou que s’y mêle du merveilleux, du féerique, l'objectif du conte a souvent été d’enseigner, même si l'histoire est plaisante, vraie ou fausse, que l’on dit pour amuser, railler, médire, etc.
Le conte a donc tout l'air d'une fable même si la longueur de l'histoire en fait un récit merveilleux, étiologique, satirique... Justement, il faut d'abord lire Pantagruel, Gargantua, le Tiers livre, le Quart livre et même le cinquième livre pour remarquer ces scènes quasi invraisemblables qui relèvent donc du merveilleux. Toutefois, au-delà de cet imaginaire, il faut distinguer l'objectif de Rabelais. Il se moque des excès constatés chez les hommes d'Église au point de voir ses œuvres censurées. Il poursuit de plus belle en se cachant derrière des pseudonymes tels que Alcofribas Nasier (anagramme de son prénom et nom) pour produire d'autres récits d'aventures où il s'attaque à des courtisans, des gens influents, des ignorantins, etc. En un mot, son projet d'écriture dépasse de très loin le cadre du conte dans lequel il inscrit ces fables philosophiques mais c’était surtout pour ne pas trop s'exposer à la vindicte.
7. VOICI UN AUTEUR HUMANISTE
☆ Ronsard.
Il a deux dénominations : poète des princes et prince des poètes. Pour l'une, il le doit à ses écrits dans lesquels, sur un ton dithyrambique, il s'adonne à un de ses penchants favorits : les louanges adressées à des rois, des princes, des princesses. Pour l'autre, il le doit à son talent dans l'écriture poétique démontré à travers ses recueils dédiés à des créatures chèrement aimées telles que Cassandre, Marie, Hélène.
Mieux encore, ce poète est une figure emblématique, imposante, voire incontournable, de la Pléiade. Son inspiration qu'il doit à Pindare, à Horace, à Plutarque et même à Pétrarque nous a valu des poèmes immortels où le lyrisme amoureux côtoie de très près une passion qui séduit par la force du style ayant permis de l'exprimer.
8. LA PLÉIADE AVAIT POUR AMBITION
☆ de valoriser la langue française.
Autour d'un professeur spécialiste de la litter gréco-romaine (Jean Dorat) au collège de Coqueret, était réuni par un curieux hasard un groupe d’élèves épris de mythologie et de la langue grecque. Ces derniers au nombre de sept formeront un mouvement littéraire qu'ils surnomment ”Pléiade”. Encouragés par l'ordonnance de Villers-Cotterêts, ce groupe fait paraître dix ans plus tard (1549) un manifeste intitulé Défense et illustration de la langue française. Du Bellay y exprime l'intention de redorer le blason de cette langue non seulement en écrivant en français mais en s'inspirant, pour rester immortel, de l’inépuisable source antique, latine, grecque et mythologique.
9. À CETTE ÉPOQUE, LES GUERRES DE RELIGION OPPOSAIENT
☆ catholiques et protestants.
Deux moines (l’Allemand Martin Luther puis le Français Jean Calvin) soutiennent l'idée selon laquelle il faut réformer l'Église ; la pratique du culte ainsi que le rôle du clergé sont alors presque intégralement remis en question. Et cette tendance fractionniste s'étend jusqu'au palais ; jusque devant la porte même de la chambre à coucher du roi François I, on placarde des affiches pour que ces réformes soient mises à jour (l'affaire des placards). Finalement, un conflit s'ensuivit, de 1562 à 1598, opposant deux ennemis : catholiques (conservateurs) et protestants (révolutionnaires).
10. VOICI UN AUTEUR EMBLÉMATIQUEMENT ENGAGÉ CONTRE DE TELLES ATROCITÉS INHUMAINES :
☆ Agrippa d’Aubigné.
Il est l'auteur d'un recueil ayant pour titre Les Tragiques (1577) réédité en 1616 et composé de sept livres. Déjà, dans Discours des Misères de ce temps (1562), Pierre de Ronsard pourtant catholique conjurait les atrocités à venir si le peuple n'y met pas un terme :
"Ô toi historien qui, d'encre non menteuse,
Écris de notre temps l'histoire monstrueuse,
Raconte à nos enfants tout ce malheur fatal
Afin qu'en te lisant ils pleurent notre mal
Et qu'ils prennent exemple aux péchés de leurs pères,
De peur de ne tomber en de pareilles misères".
Quant à d’Aubigné pourtant protestant, surtout dans ”Misères”, il s'offusque plus rageusement contre cette guerre fratricide (36 longues années) opposant deux grands enfants appartenant pourtant à la même mère patrie (la France) et à la même religion (le christianisme). S’inspirant de la fable dans la forme et d'épisode biblique dans le fond, il écrit :
”Je veux peindre la France une mère affligée
Qui est, entre ses bras, de deux enfants chargée”.
Issa Laye Diaw
Donneur universel
WhatsApp : +221782321749
Lien de la page Facebook :