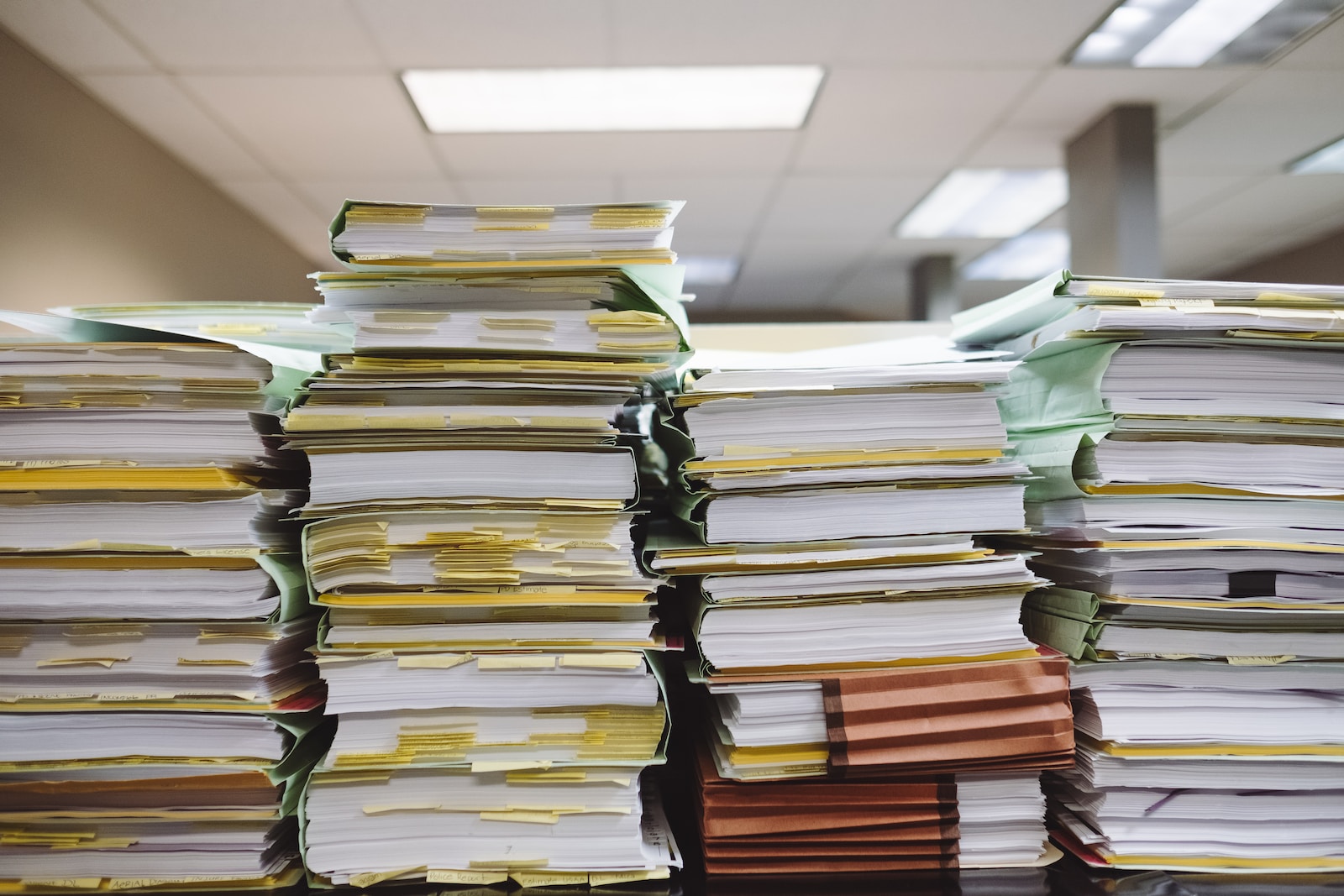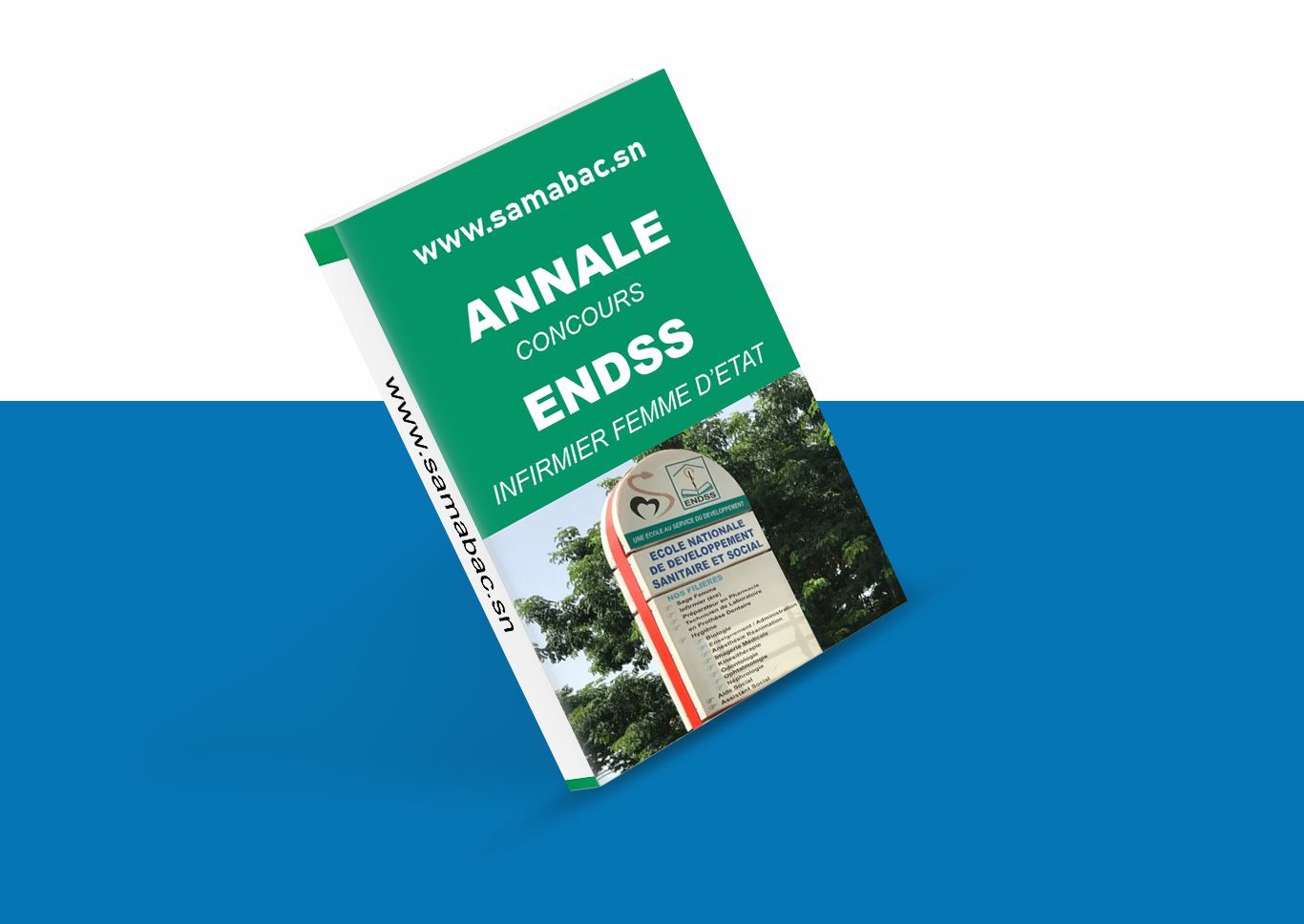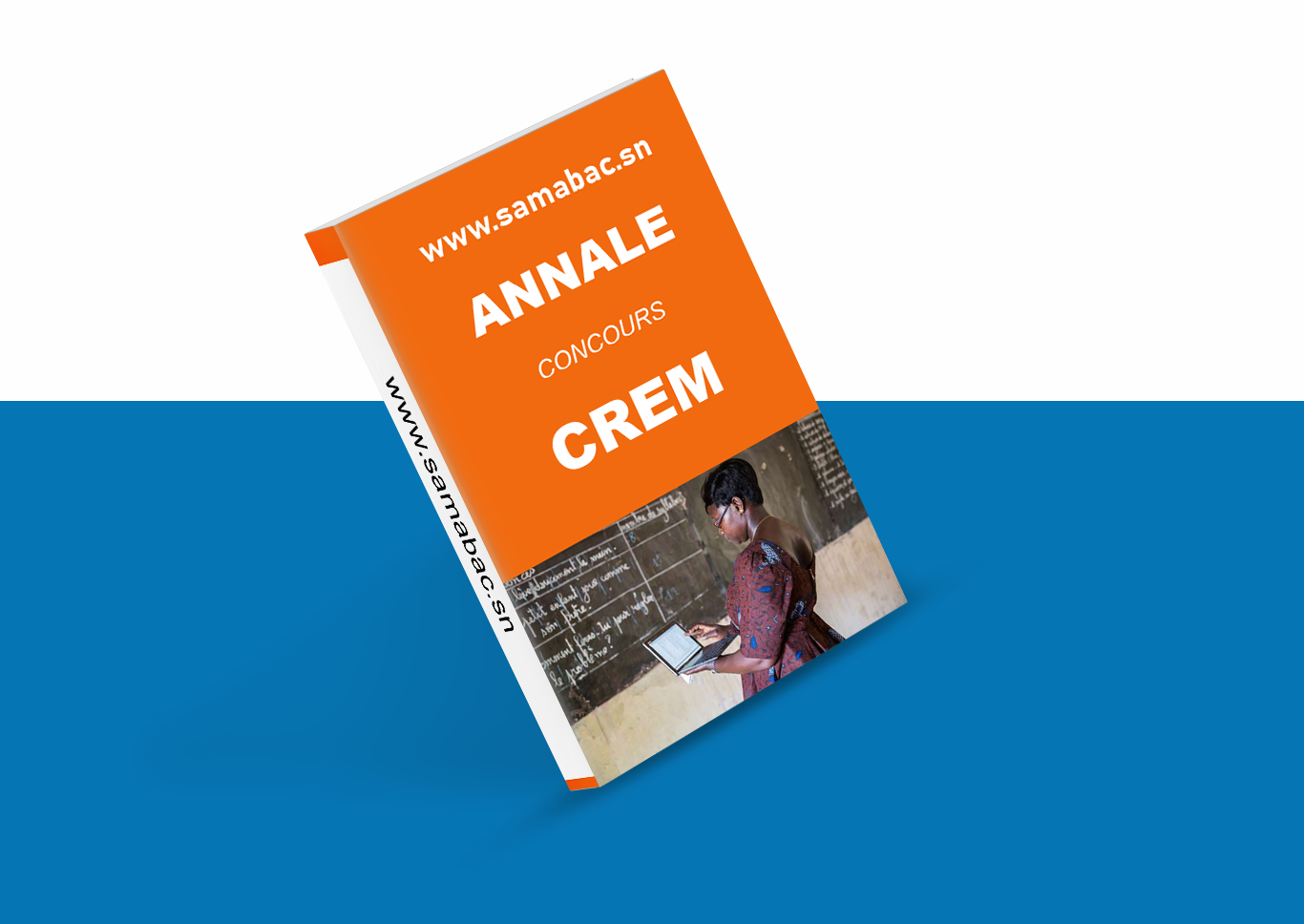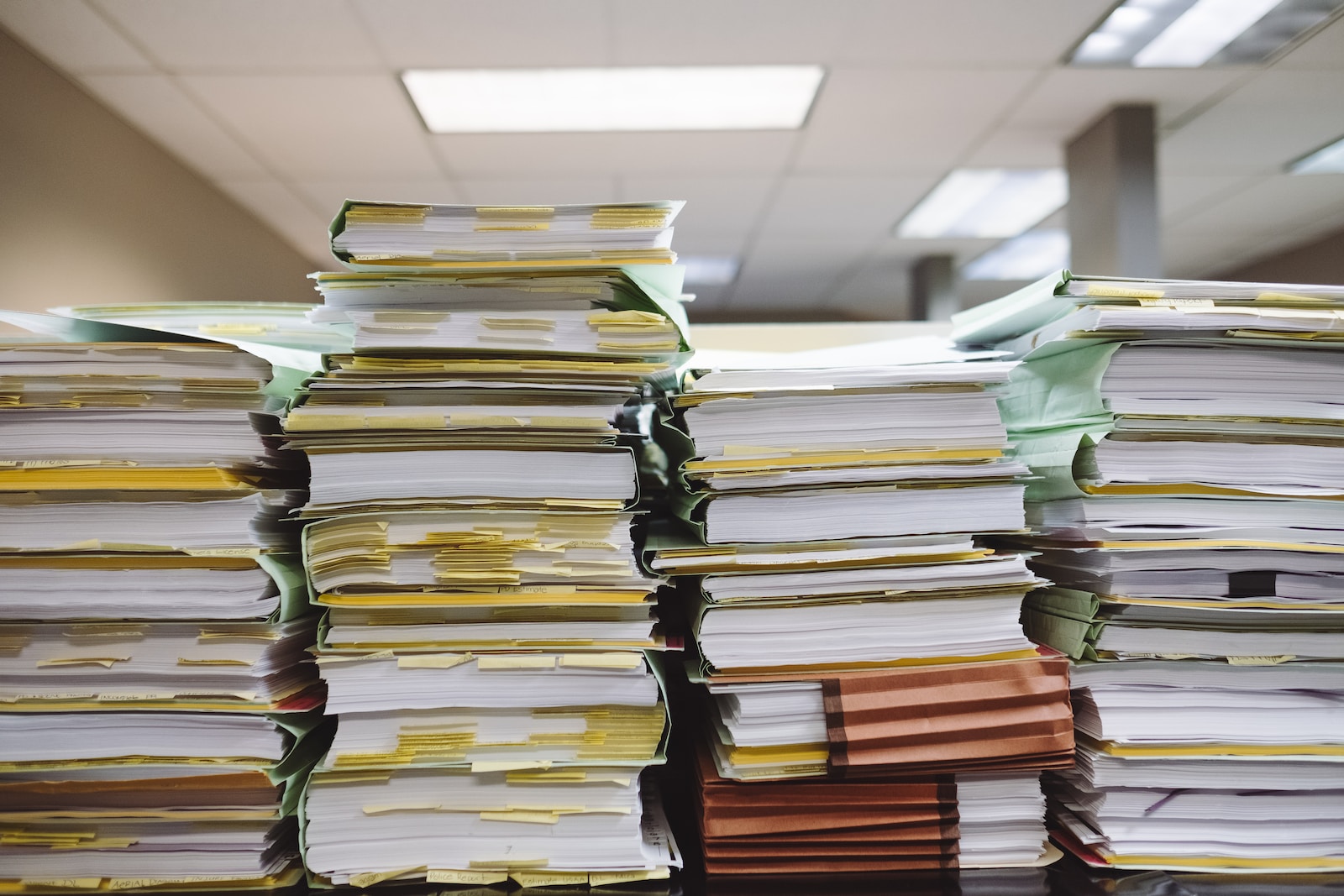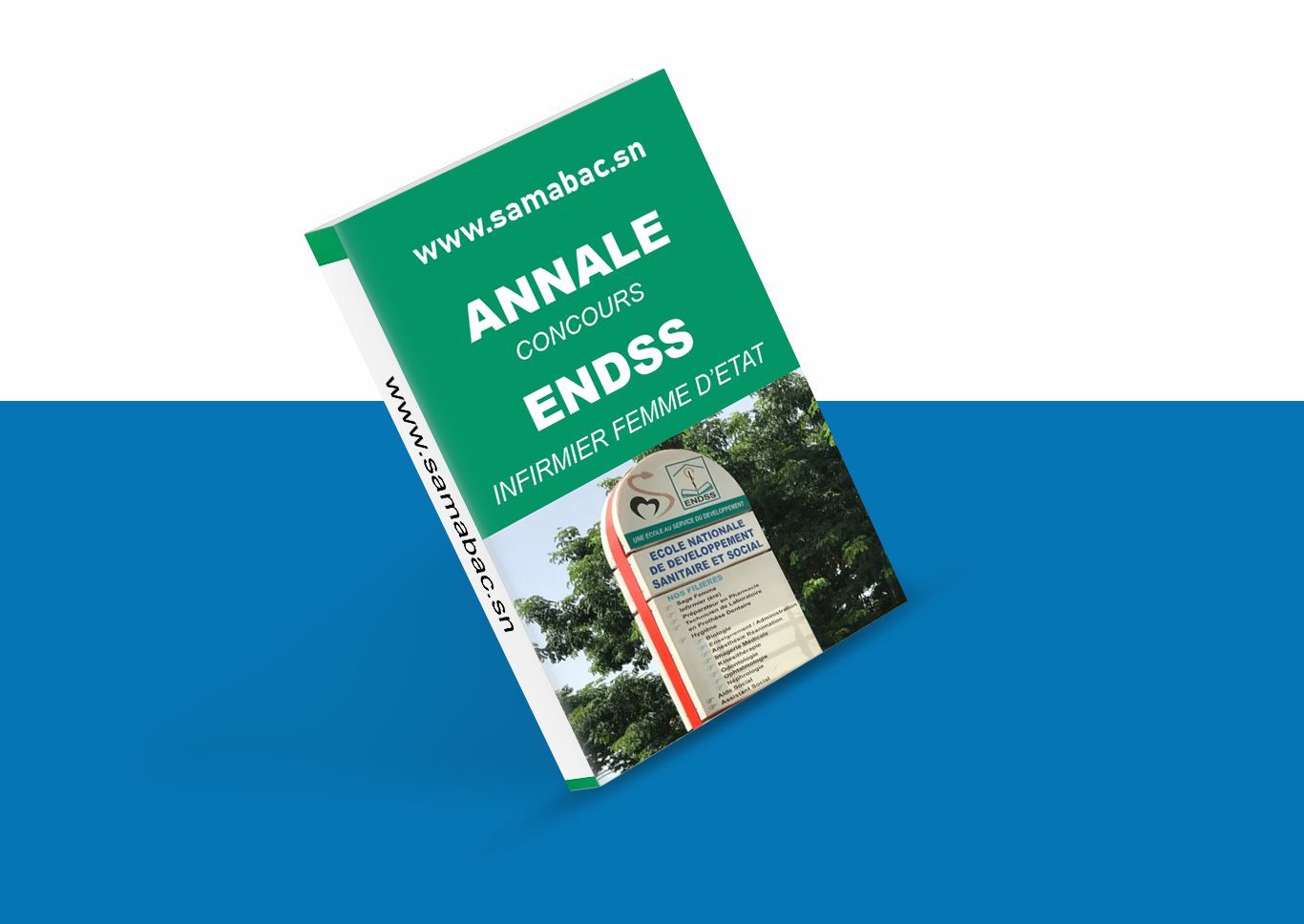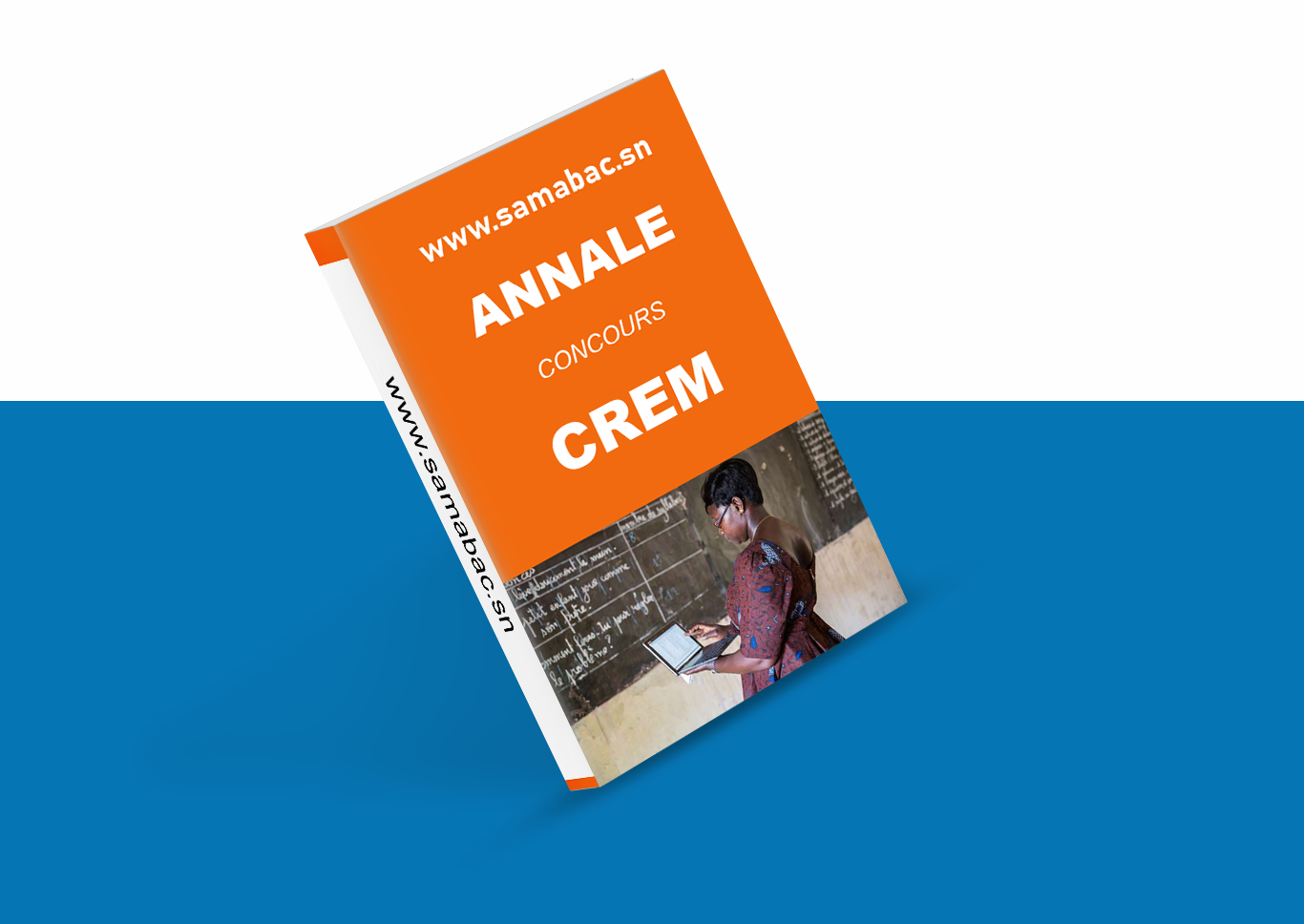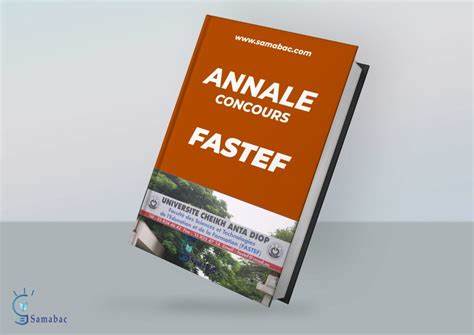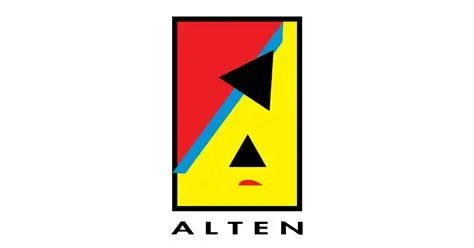LA POÉSIE ET SES PRINCIPALES FONCTIONS
4. LA FONCTION DIDACTIQUE : ”UNE AUTRE ARME”
INTRODUCTION
Il existe une dimension de la poésie que, à raison ou à tort, beaucoup confondent à la fonction engagée : c’est la fonction didactique. Cette confusion se comprend dans la mesure où toutes les deux ambitionnent d’éloigner l’homme du mal (injustice et ignorance). Néanmoins le mal combattu par les poètes engagés est surtout l’expression d’une révolte contre une oppression sociale ou politique alors que la fonction didactique est surtout liée à l’enseignement, à l’éducation, à l’apprentissage de la vie, à la connaissance du monde. Au fil des siècles, au regard de l’objectif que se fixent des poètes réunis autour de courants littéraires, nous nous rendons compte que cette fonction didactique est si imposante, si récurrente, si éminente, qu’on devrait s’y appesantir car il s’agit d’une arme redoutablement efficace contre l’ignorance.
L’HUMANISME. C’est fort de cette considération que nous ne pouvons pas omettre l’humanisme de la liste des courants littéraires qui ont fait de ce projet d’écriture un point d’orgue. Comme son nom l’indique, ce mouvement artistique place l’homme au centre de toutes les préoccupations. Il a fait de la littérature en général et de la poésie en particulier un endroit privilégié des lettrés pour apprendre aux hommes à bien se comporter, à rester humain ; les auteurs y prodiguent de la connaissance afin de s’éviter les conséquences désastreuses de l’ignorance. La lecture de la poésie devient ainsi un loisir dont l’utilité consiste à repousser les limites de cette ignorance. Dans la poésie de Pierre de Ronsard par exemple, le lecteur tire très souvent de la parole lyrique l’essence même de l’inspiration ronsardienne : une leçon.
À ce sujet, une des illustrations métaphoriques les plus incontournables est sans doute contenue dans ce poème dédié à Cassandre et commençant par le vers suivant : « Mignonne, allons voir si la rose… ». Dans la première strophe de cette ode, en même temps qu’il établit la relation de ressemblance entre cette femme aimée et la fleur aperçue lors de leur promenade matinale, le poète invite sa dame à retourner voir le soir si cette rose avait gardé toute sa splendeur. Dans la deuxième strophe, un constat bien amer les attend : la fleur a fané ! l’auteur s’en désole et se met presque à blasphémer en regrettant le temps qui passe et ne laisse rien à la même place. C’est dans la dernière strophe que se dégage la leçon à en tirer, le fameux carpe diem, c’est-à-dire le fait de savoir profiter de l’instant présent en pleine jeunesse puisque jamais celle-ci ne se renouvellera pas quand nous atteindrons la vieillesse.
LE CLASSICISME. Toutefois, si on s’amusait à identifier, à répertorier et à classer ces productions didactiques poétiques selon les courants littéraires, on se rendrait compte que le classicisme réunirait plus d’œuvres à ce sujet. Que ce fut dans le monde de la poésie que des autres genres, ce courant littéraire est réputé pour sa littérature foncièrement moraliste car le XVIIème siècle est placé, l’Académie française aidant, sous le sceau du « placere » et « docere » (« plaire » et « instruire »). Voilà pourquoi cette époque était fortement marquée par la réglé des trois B : le Beau, le Bon et le Bien, par la promotion du modèle humain de perfection baptisé « l’honnête homme ». C’est ce projet d’écriture poétique bien en phase avec l’intention de plaire à l’opinion qui permettait à l’écrivain en général, au poète en particulier, de satisfaire les exigences de l’Académie française et de remporter les suffrages du public ; en un mot, cet artiste était tenu de produire des œuvres qui répondent à l’instruction.
Pour preuve, même dans un genre poétique pourtant considéré comme mineur, voir puéril, frivole, c’est-à-dire la fable, Jean de La Fontaine abreuve son lecteur de règles de conduite à tirer de chacune de ses pièces. D’ailleurs, c’est dès la préface que le fabuliste déclare : « Je me sers d’animaux pour instruire les hommes », comme pour faire comprendre que cette fonction moraliste est au cœur dudit projet.
LE SYMBOLISME. Il ne faut point oublier cette intention d’enseigner qu’on retrouve également chez les poètes visionnaires, les symbolistes, eux qui observent les objets familiers et en offrent la signification au commun des mortels. C’est le cas d’Arthur Rimbaud (1854 – 1891) dans son célèbre poème intitulé « Le dormeur du val » ; il y décrit une atmosphère paradisiaque d’abord baignée de sons et lumières, de verdure aussi, et au milieu de laquelle est étalé un soldat.
« C’est un trou de verdure où chante une rivière ».
Ce cadre spatio-temporel aidant, le portrait que le poète fait de ce dernier laisse croire qu’il est en train de dormir. C’est seulement à la fin du texte, lorsque le dernier vers retentit que le lecteur qui n’avait rien vu venir du premier coup se rend compte que ce soldat qui gisait dans l’herbe verte était bien mort :
« Tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit ».
L’enseignement symbolique qu’on en tire et qui semble couler de source, c’est que le sommeil et la mort que le poète égalise ici sont si proches, si voisins, qu’un fil ultra mince les sépare. D’ailleurs, cet enseignement se dégage rien qu’à partir du choix du titre de ce poème : « le dormeur » (il dort ou il meurt ?) ; en tout cas, ce poème a commencé par un trou (de verdure) et s’est achevé par des trous (de balles) qui mettront ce soldat au trou (de la tombe). Il en est ainsi dans la plupart des poèmes d’auteurs symbolistes dont la prouesse se résume à une poétique entreprise de significations ; c’est de ce projet que voient le jour l’enseignement, la connaissance, l’apprentissage, cette partie rose de la vie à cueillir de chaque fleur de poèmes.
CONCLUSION.
En définitive, puisque « didactique » est l’adjectif relatif à tout ce qui se rattache à l’enseignement, nous avions pu en identifier la particularité telle que s’y sont adonnés plusieurs poètes. C’est ainsi que nous avons remarqué que cette fonction didactique de la poésie est orientée vers l’enseignement de règles de bonne conduite du côté des humanistes, vers les leçons à tirer de chaque expérience et que prodiguent généreusement les classiques, mais aussi vers une vision plus claire à offrir aux objets familiers comme en témoigne l’entreprise de signification qui est le propre des poètes symbolistes.
Issa Laye DIAW
Donneur universel
Professeur de français
Lycée d’excellence de Diourbel
WhatsApp : +221782321749
Lien de la page Facebook :
https://www.facebook.com/profile.php?id=100044574573212...