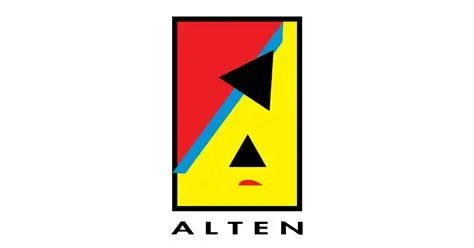La Versification; Le vers: Métrique-Rime-Rythme
La
versification est l'ensemble des techniques employées dans l'expression poétique traditionnelle en langue française et des usages qui y règlent la pratique du vers : regroupement en strophes, jeu des rythmes et des sonorités, types formels de poèmes. Terme au contenu purement technique, la versification se distingue des arts poétiques, qui renvoient à des conceptions à la fois techniques et esthétiques de la poésie revendiquées par une personne ou un groupe.
Le vers
1-Métrique
Décompte des syllabes
L'unité de mesure du vers français est la
syllabe. Parler de «
pied », par analogie avec le latin ou le grec, est incorrect, comme le relève déjà Joachim du Bellay dans la
Défense et illustration de la langue française, et comme l'écrit encore en 1974
Jean Mazaleyrat :
« appliquer le terme pied à la syllabe, comme on l'a fait, comme on le fait souvent encore dans notre tradition pédagogique, lexicographique et critique, ce n'est pas seulement mêler les techniques et confondre les notions. C'est méconnaître le caractère accentuel et rythmique du vers français. C'est plus qu'une inadvertance terminologique, c'est une erreur de conception. C'est confondre la structure combinée des mesures rythmiques et la somme pure des syllabes, la fin et les moyens. »
Le mètre est le nombre de syllabes comptées dans un vers. La versification française, qui repose sur le décompte des syllabes, est dite syllabique ; comme il faut et il suffit d'une voyelle pour composer une syllabe, elle est aussi dite
vocalique. Le vers suivant contient douze mots d'une syllabe :
Je sais ce que je suis et ce que je me dois.
—
Pierre Corneille,
Don Sanche d’Aragon
Règle du e caduc
Le
e caduc désigne la voyelle e dont la prononciation « e » varie en fonction de
l'environnement syntaxique. Souvent le e caduc est improprement appelé e muet, car la modification de prononciation consiste souvent en une atténuation, voire une disparition, du son « e » (
amuïssement).
Le e caduc est associé aux
graphies « e », « es » et « ent ». Attention cependant : les terminaisons « -es » et « -ent » n'indiquent pas obligatoirement la présence d'un e caduc (cf. « Miguel de Cervantes », « le couvent », « qu'ils soient », ou tous les verbes à la
troisième personne du pluriel de l'imparfait et du conditionnel : « ils voulaient » et « il voulait », tout comme « il voudrait » et « ils voudraient », diffèrent uniquement à l'écrit, par un « -ent » grammatical non prononcé).
En fin de vers, un e caduc associé aux terminaisons « -e », « -es », « -ent » ne compte pas comme une syllabe (
apocope).
Que je ne puis la voir sans voir ce qui me tue.
→ Que·je·ne·puis·la·voir·sans·voir·ce·qui·me·tu
→ apocope du « e » en fin de vers (« tu(e) »).
—
Pierre Corneille,
Don Sanche d’Aragon
Merci. Je n’ai plus peur. Je vais parler moi-même.
→ Mer·ci·Je·n'ai·plus·peur·Je·vais·par·ler·moi·mêm
→ apocope du « e » en fin de vers (« moi-mêm(e) »).
—
Edmond Rostand,
Cyrano de Bergerac
J'aperçois tout à coup deux yeux qui flamboyaient,
→ J'a·per·çois·tout·à·coup·deux·yeux·qui·flam·boy·aient
→ « -ent » ne signale pas un e caduc et le verbe ne subit pas l'apocope
(« flamboyaient » = imparfait,
3e personne du pluriel).
—
Alfred de Vigny, Les Destinées, La Mort du loup
À l'intérieur du vers, le e caduc en fin de mot ne compte pas toujours comme une syllabe
(élision non systématique du e caduc final d'un mot) : il y a élision, et la dernière syllabe ne compte pas, quand le son « e » écrit « -e » est suivi par une voyelle ou un
h muet ; il n'y a pas élision, et la dernière syllabe compte, quand le son « e » écrit « -e » est suivi par une consonne, ou quand le son « e » est orthographié « -es » ou « -ent ».
J'ai rêvé dans la grotte où nage la sirène.
→ J'ai·rê·vé·dans·la·gro·ttoù·na·ge·la·si·rèn
→ « e » élidé devant une voyelle (« grott(e) où »),
« e » prononcé devant une consonne (« na·ge la »),
apocope du « e » en fin de vers (« sirèn(e) »).
—
Gérard de Nerval, El Desdichado
Jamais mensonge heureux n’eut un effet si prompt
→ Jam·ais·men·son·geu·reux·n’eut·un·e·ffet·si·prompt
→ « e » élidé devant h muet (« mensong(e) heureux »).
—
Jean Racine, Athalie
Ses houles où le ciel met d'éclatants îlots
→ Ses·hou·les·où·le·ciel·met·d'é·cla·tants·î·lots
→ « e » prononcé dans la terminaison « -es » (« houles où »).
—
Leconte de Lisle, Poèmes tragiques
Où tendent tous les fronts qui pensent et qui rêvent
→ Où·ten·dent·tous·les·fronts·qui·pen·sent·et·qui·rêv
→ « e » prononcés à l'intérieur du vers (« ten·dent », « pen·sent »),
apocope du « e » en fin de vers (« rêv(ent) »).
—
Sully Prudhomme, Le Zénith — aux victimes de l'ascension du
ballon le Zénith —
Quelque chose approchant comme une tragédie,
→ Quel·que·cho·sa·ppro·chant·co·mmu·ne-tra·gé·di
→ « e » élidés devant voyelles (« chos(e) approchant », « comm(e) une »),
apocope du « e » en fin de vers (« tragédi(e) »).
—
Alfred de Musset,
Premières Poésies, La Coupe et les Lèvres
Et les cieux rayonnaient sous l'écharpe d'Isis
→ Et·les·cieux·ra·yo·nnaient·sous·l'é·char·pe·d'I·sis
→ « e » prononcé devant une consonne (« échar·pe d'Isis ») ;
« -ent » ne signale pas un e caduc et le verbe n'est pas élidable
(« rayonnaient » = imparfait,
3e personne du pluriel).
—
Gérard de Nerval, À Louise d'Or, reine — ou sa variante : Horus —
Enfin, le « e » à l'intérieur d'un mot est parfois élidé entre une voyelle et une consonne
(syncope) : par exemple, il y a syncope dans « il avouera » (→ a·vou·ra), mais pas dans « avouer » (→ a·vou·er).
Je ne t'envierai pas ce beau titre d'honneur.
→ Je·ne·t'en·vi·rai·pas·ce·beau·ti·tre·d'ho·nneur
→ syncope du « e » entre voyelle et consonne (« envi(e)rai »).
—
Pierre Corneille, Le Cid
Ces règles peuvent provoquer la confusion lors du décompte du e tonique (c'est-à-dire prononcé) et les auteurs cherchent à l'éviter : par exemple, « Dites-le à… » serait remplacé par « Dites-lui de… »
De plus, au
Moyen Âge et au
xvie siècle, ces règles étaient différentes : la prononciation était différente et, au Moyen Âge, le « e » s'élidait souvent à l'hémistiche de l'alexandrin (« césure épique »).
La vi-e que j'avais m'est de douleur ravie.
→ La·vi·e·que·j'a·vais·m'est·de·dou·leur·ra·vi
→ « vie » se prononçait en deux syllabes (« vi-euh ») ;
par contre, il y a une apocope finale.
—
Robert Garnier, Hippolyte
Les pierres précïeus(es) valent mieus d'un chastel.
→ Les·pier·res·pré·cï·eus(es)·va·lent·mieus·d'un·chas·tel
→ élision à l'hémistiche, et diérèse de « précïeuses » indiquée par un tréma.
—
Le Roman d'Alexandre
Diérèse et synérèse
Certains sons uniques en prose sont dédoublés dans l'élocution versifiée : « pas·sion » devient « pas·si·on », « dia·mant » devient « di·a·mant ». C'est la
diérèse, qui transforme une consonne en voyelle juxtaposée à la voyelle habituelle du mot ; la diction ainsi abrégée parait adoucie.
La nation chérie a violé sa foi.
→ La·na·ti·on·ché·rie·a·vi·o·lé·sa·foi.
→ Diérèse de « na·ti·on ».
—
Jean Racine, Esther
Deux syllabes en prose peuvent aussi être contractées en une seule dans l'élocution versifiée. « hi·er » devient « hier », « li·on » devient « lion ». C'est la
synérèse, qui transforme une voyelle en consonne intégrée à la voyelle majeure du mot ; la diction ainsi abrégée parait plus dure.
Hier, j'étais chez des gens de vertu singulière
→ Hier·j'é·tais·chez·des·gens·de·ver·tu·sin·gu·lièr
→ Synérèse de « hier »
—
Molière, Le Misanthrope
Historiquement, diérèse et synérèse suivaient des règles strictes (pleines d'exceptions) basées sur
l'étymologie. On trouve, avant Corneille, certains mots de trois syllabes dont les deux dernières sont en synérèse :
meur·trier, san·glier, bou·clier, peu·plier. Les poètes modernes s'affranchissent des origines des mots et utilisent diérèse et synérèse en fonction de considérations métriques, rythmiques, ou esthétiques : la diérèse peut donc servir à favoriser l'articulation du vers et à ralentir la diction, et peut donner une touche archaïque quand elle est utilisée là où elle n'existe plus en français moderne ; la synérèse permet au contraire d'accélérer la diction.
Sinon, des dictionnaires, comme
le Littré, aideront les plus scrupuleux à se conformer aux règles étymologiques. On trouve sur internet un
tableau récapitulatif de l'usage poétique .
Hiatus
L'
hiatus désigne la rencontre de deux voyelles, soit dans le même mot (hiatus interne ; exemple : « maïs »), soit dans deux mots successifs (hiatus externe).
L'hiatus (externe) abonde au Moyen Âge, mais, comme le retrace
Georges Lote, il est, au cours même de cette période, progressivement éliminé et Ronsard, en 1565, dans son
Art Poëtique françois, formule une quasi-prohibition
que
Malherbe et Boileau
rendront absolue.
Cette intransigeance est critiquée, par exemple par
Paul Valéry, qui parlait de
« la règle incompréhensible de l'hiatus », ou par Alexandre-Xavier Harduin qui, en 1757, écrivait
« Il semble que, loin d'éviter les hiatus dans le corps d'un mot, les poètes français aient cherché à les multiplier, quand ils ont séparé en deux syllabes quantité de voyelles qui font diphtongue dans la conversation. De tuer, ils ont fait tu-er, et ont allongé de même la prononciation de ru-ine, vi-olence, pi-eux, étudi-er, passi-on, di-adème, jou-er, avou-er, etc. On ne juge cependant pas que cela rende les vers moins coulants; on n'y fait aucune attention ; et l'on ne s'aperçoit pas non plus que l'élision de l'e féminin n'empêche point la rencontre de deux voyelles, comme quand on dit année-entière, plaie-effroyable, joie-extrême, vue-agréable, vue-égarée, bleue-et blanche, boue-épaisse »
2-Rime
Une
rime est un retour de sonorités identiques à la fin d'au moins deux vers, avec pour base la dernière voyelle tonique. Différente de l'assonance médiévale, la rime impose l'homophonie des sons consonantiques qui suivent la dernière voyelle prononcée. Elle peut être enrichie par la reprise de sons complémentaires qui précèdent la voyelle.
Noms
Le nom des rimes dépend principalement de leur disposition et des successions de sonorités qui en résultent :
- AAAA dans les rimes continues ;
- AABB dans les rimes suivies ou plates ou jumelles (… chanté /… été/… dépourvue /… venue) ;
- ABAB pour les rimes croisées ou alternées (… pensées /… bruit /… croisées /… nuit) ;
- ABBA dans les rimes embrassées (… chandelle /… filant /… s'émerveillant /… belle) ;
- sans ordre dans les rimes mêlées ;
- ABCABC, voire ABCDABCD, dans les rimes alternées (rares, et surtout au Moyen Âge) ;
- AABCCBDDB pour les rimes en rhythmus tripertitus (ou rythme tripartite : même rime tous les trois vers) ;
- AAABCCCBDDDB pour les rimes en rhythmus quadripertitus (ou rythme quadripartite : même rime tous les quatre vers).
Il existe aussi certains jeux de reprise, certains plus ou moins abandonnés, comme :
- la rime annexée, avec la dernière syllabe de la rime reprise au vers suivant (… agile / Il…) ;
- la rime batelée, avec la dernière syllabe du vers rimant à la césure du vers suivant ;
- la rime brisée, avec rime supplémentaire à la césure ;
- la rime couronnée, avec répétition de syllabe (… priant, criant) ;
- la rime dérivative, basée sur des mots de même racine (… apparaît /… disparaît) ;
- la rime emperière ou impératrice, avec triplement de la syllabe (… morose rose Rose) ;
- la rime enchainée, avec retour de la rime durant tout le vers ou la strophe (ce qui crée une assonance : Je m’étonne que tu chantes, / Et chantonnes…) ;
- la rime équivoquée, qui joue sur plusieurs mots (… la rose /… l'arrose) ;
- la rime fraternisée ou fratisée, à la fois annexée et équivoquée, avec la dernière syllabe de la rime ressemblant au début au vers suivant (… admettons / Et ton…) ;
- la rime grammaticale, qui reprend deux formes fléchies d'un même mot ;
- la rime léonine, sur deux syllabes (… souris /… pourris) ;
- les rimes redoublées, avec reprise des mêmes rimes ne respectant que l'alternance « rime masculine - rime féminine » ;
- la rime senée, avec tous les mots du vers commençant par la même lettre ;
- la double couronne, semblable à la rime couronnée avec en plus un écho à l'hémistiche du deuxième vers ;
- l'holorime, qui crée un parallélisme entre deux vers entiers ;
- le vers léonin, avec rime entre deux hémistiches (… arrive, //… nos rives) ;
- etc.
Enfin, la «
rime pour l'œil » désigne une fin de vers où une apparence de singulier « rime » avec une apparence de singulier, et une apparence de pluriel avec une apparence de pluriel ; par exemple, Baudelaire fait rimer «… hiver » et «… enlever », qui se ressemblent graphiquement mais se prononcent de façons différentes.
Féminin et masculin
Un vers finit par une rime féminine quand il se termine par un e caduc ; autrement dit, une rime féminine se termine par un son « e », écrit au singulier (« -e ») ou au pluriel (« -es », « -ent »). Les autres cas désignent des rimes masculines.
Pour les 3
es personnes du pluriel dans lesquelles la terminaison -ent suit une consonne, la rime est considérée comme féminine : ils surent, ils lurent. Pour les verbes au subjonctif, lorsque la terminaison -ent est placée après une voyelle, la rime est considérée comme féminine si la terminaison est prononcée de la même manière au pluriel et au singulier : qu’ils prient et qu’il prie.
La rime est masculine dans tous les autres cas. Pour les 3
es personnes du pluriel dans lesquelles la terminaison -ent suit une voyelle avec laquelle elle forme une seule syllabe, la rime est considérée comme masculine : plantaient, chantaient. Dans ce cas, la terminaison -ent ne peut rimer qu’avec elle-même.
Le genre de la rime ne correspond pas obligatoirement au
genre grammatical du mot final : «… un sourire », «… ils pensent », «… la fée » seront considérés comme des rimes féminines ; et «… la mort », «… le mouvement », «… ils volaient », «… qu'ils soient », «… la beauté » seront considérés comme des rimes masculines.
Une
rime masculine doit rimer avec une autre rime masculine et une rime féminine avec une autre rime féminine ; par exemple, la rime entre «… chant choral » et «… la chorale » n'est pas permise. L'alternance entre rimes féminines et masculines est d'usage depuis le
xvie siècle et de règle depuis Malherbe : par exemple, dans ABBA CCD, si A est masculine, alors B est féminine, C masculine, D féminine.
Phonétiquement parlant, la rime masculine est souvent vocalique et la rime féminine consonantique. Il arrive néanmoins, plus rarement, que ce soit le contraire ; cela crée la diversité orale des rimes. Ces considérations phonétiques peuvent être privilégiées par les poètes modernes par rapport aux règles classiques d'alternance « féminin - masculin ».
Singulier et pluriel
Un vers finit par une rime au pluriel quand il se termine par s, x, z ; dans les autres cas, la rime est au singulier. Singulier et pluriel ne correspondent pas obligatoirement au
nombre grammatical : «… le gaz », «… jamais », « les enfants », «… une fois » seront considérés comme des rimes au pluriel.
Une rime au pluriel doit rimer avec une autre rime au pluriel, et une rime au singulier avec une autre rime au singulier. Par contre, il n'y a pas de règle obligeant à alterner rimes au pluriel et au singulier (un poème peut ne contenir que des rimes au singulier).
En conclusion : un féminin singulier doit rimer avec un féminin singulier, un féminin pluriel avec un féminin pluriel, un masculin singulier avec un masculin singulier, et un masculin pluriel avec un masculin pluriel. Les rimes au féminin et au masculin doivent être alternées.
Richesse
La richesse des rimes (parfois désignée comme la « qualité ») est déterminée par le nombre de sons communs :
- les rimes pauvres ont un son en commun, la dernière voyelle tonique seule (… aussi /… lit, ... vie /… remplie) ;
- les rimes suffisantes possèdent deux phonèmes communs, la dernière voyelle tonique (V) + une consonne prononcée (C) derrière ou devant, soit deux combinaisons possibles : V + C ou C + V (… animal /… chacal, ... nuées /… huées) ;
- les rimes riches présentent trois homophonies entre voyelles toniques et consonnes, avec quatre combinaisons fréquentes : V + C + V (rime léonine), ou C + V + C, ou C + C + V, ou V + C + C (… prêteuse /… emprunteuse) ;
- au-delà, on parle de rimes très riches.
3-Rythme
Si, en français, la structure du vers se fonde sur un nombre déterminé de syllabes, le
rythme en est donné par la syntaxe. Dans la diction d'un énoncé versifié, il s'agit de trouver l'équilibre entre le rythme et le nombre.
Le rythme est modulé par les accents toniques des mots et les pauses marquées aux coupes et aux césures du vers. Les sensations produites dépendent du découpage du texte (rythme haché, rapide, ou ralenti), des effets de rupture (contrastes), ou des variations rythmiques (accélérations, décélérations).
Accent tonique
L'
accent tonique représente une augmentation de l'intensité de la voix sur une syllabe. En français, l’accent tonique est fixe sur la dernière syllabe prononcée, d'où l'importance des notions de e caduc.
En français parlé, l'accent tonique, souvent peu marqué, ne doit être confondu ni avec l'
intonation, qui désigne le ton de la voix (cf. « Dégagez ! » : accent tonique sur « -gez », intonation autoritaire), ni avec l'accent propre à chaque locuteur dû à son vécu, ni avec l'accent oratoire, ou accent d'insistance, qui découle de la volonté de marquer ses propos à certains passages clés (cf. « BIENvenue, mesdames et messieurs, pour cette IN-CROY-able… »).
Coupe
La
coupe résulte d'une analyse rythmique du vers ; le rythme repose sur des coupes secondaires ou principales (notées /) qui suivent les accents toniques placés sur la dernière syllabe accentuée d'un mot, ou d'un groupe de mots formant une unité grammaticale, et donc un groupe rythmique.
Un rythme binaire comporte généralement un nombre pair de mesures ; exemple : alexandrin divisé en
hexamètres (6 mesures) ou en
tétramètres (4 mesures).
C'est Vénus / tout entière / à sa proie / attachée.
—
Jean Racine, Phèdre
Un rythme ternaire est généralement divisé en trois mesures ; exemple : alexandrin divisé en
trimètres (3 mesures ; de 4 syllabes, avec effacement de l'hémistiche, dans le cas de l'alexandrin romantique).
J'ai vu le jour / j'ai vu la foi / j'ai vu l'honneur.
—
Victor Hugo, Le petit roi de Galice
Césure et hémistiche
La
césure résulte d'une analyse métrique du vers, et se traduit par un repos dans l'énoncé ; un vers qui présente une césure est appelé « vers composé ». Dans les vers de plus de huit syllabes, une césure (notée //) sépare le vers en deux
hémistiches :
- les vers de treize syllabes, rares, peuvent se diviser en cinq et huit syllabes (5//8, par exemple chez Paul Scarron) ou en six et sept syllabes (6//7, chez Paul Verlaine) ;
Jetons nos chapeaux // et nous coiffons de nos serviettes,
Et tambourinons // de nos couteaux sur nos assiettes.
—
Paul Scarron, Chansons à boire
- l'alexandrin classique est traditionnellement divisé en deux hémistiches de six syllabes chacun (6//6) ; un hémistiche peut présenter des coupes secondaires 1/5, 2/4, 3/3, 4/2, 5/1 ;
Dans la nuit éternelle // emportés sans retour
—
Alphonse de Lamartine
- l'hendécasyllabe peut être divisé en deux hémistiches de cinq et six syllabes (5//6) ou de huit et trois syllabes (8//3) ;
- le décasyllabe est traditionnellement divisé en deux hémistiches de quatre et six syllabes (4//6) ou en deux de cinq syllabes (5//5, produisant un effet de balancement) ; il est parfois divisé en hémistiches de six et quatre syllabes (6//4) ;
Frères humains // qui après nous vivez
—
François Villon, Ballade des pendus
Nous aurons des lits // pleins d'odeurs légères
—
Charles Baudelaire
- l'ennéasyllabe peut être découpée en deux hémistiches de trois et de six syllabes (3//6), ou de quatre et de cinq syllabes (4//5) ;
- l'octosyllabe a parfois été découpé en hémistiches de quatre syllabes (4//4) ;
- pour tous ces types de vers, l'hémistiche peut certaines fois disparaitre et le vers composé redevenir vers simple.
Il agonise entre le mensonge et la fable
—
Jean Cocteau, Le casque de Lohengrin
Par une bonne lune de brouillard et d'ambre,
—
Patrice de La Tour du Pin, Enfants de septembre
Au bout du compte, ce sont les poètes qui ont le dernier mot. Selon
Stéphane Mallarmé, dans
Crise de vers,
« Les fidèles à l’alexandrin, notre hexamètre, desserrent intérieurement ce mécanisme rigide et puéril de sa mesure ; l’oreille, affranchie d’un compteur factice, connaît une jouissance à discerner, seule, toutes les combinaisons possibles, entre eux, de douze timbres. »
Enjambement, rejet et contre-rejet
L'enjambement apparaît quand il y a discordance entre la structure grammaticale et la structure rythmique des vers (= débordement), c'est-à-dire quand le sens du premier vers ne se précise qu'au suivant. Exemple avec séparation du sujet et du verbe :
Ma seule étoile est morte, - et mon luth constellé
Porte le soleil noir de la Mélancolie
—
Gérard de Nerval, Les Filles du feu,
El Desdichado
Le
rejet désigne un bref élément au début d'un vers qui termine le sens du vers précédent.
L'empereur se tourna vers Dieu ; l'homme de gloire
Trembla
—
Victor Hugo, L'Expiation
Le
contre-rejet désigne un élément en fin de vers qui donne déjà un sens au vers suivant.
Un enfant accroupi, plein de tristesse, lâche
Un bateau frêle comme un papillon de mai
—
Arthur Rimbaud,
Le Bateau ivre
Enjambement, rejet, contre-rejet peuvent se combiner.
Et, l’Amour comblant tout, hormis
La faim, sorbets et confitures
Nous préservent des courbatures.
—
Paul Verlaine, Les Fêtes galantes, Cythère, vers 10-12
Coupes et césures « spéciales »
En versification :
- une coupe épique désigne une coupe après un e caduc théoriquement non élidable, néanmoins élidé.
- une coupe lyrique, qui procède souvent d'un choix de lecture, désigne une coupe en décalage avec l'accent tonique ;
- une coupe enjambante se fait dans un mot, devant un e caduc compté ;
- une césure épique désigne une césure sur un e caduc non élidable, néanmoins élidé (le e caduc de l'hémistiche est traité comme le e caduc en fin de vers) ;
- une césure lyrique se fait après un e caduc compté ;
- une césure enjambante se fait dans un mot, devant un e caduc compté.
La coupe épique et ces césures spéciales sont absentes de la versification classique, mais présentes au Moyen Âge ou dans la poésie moderne.


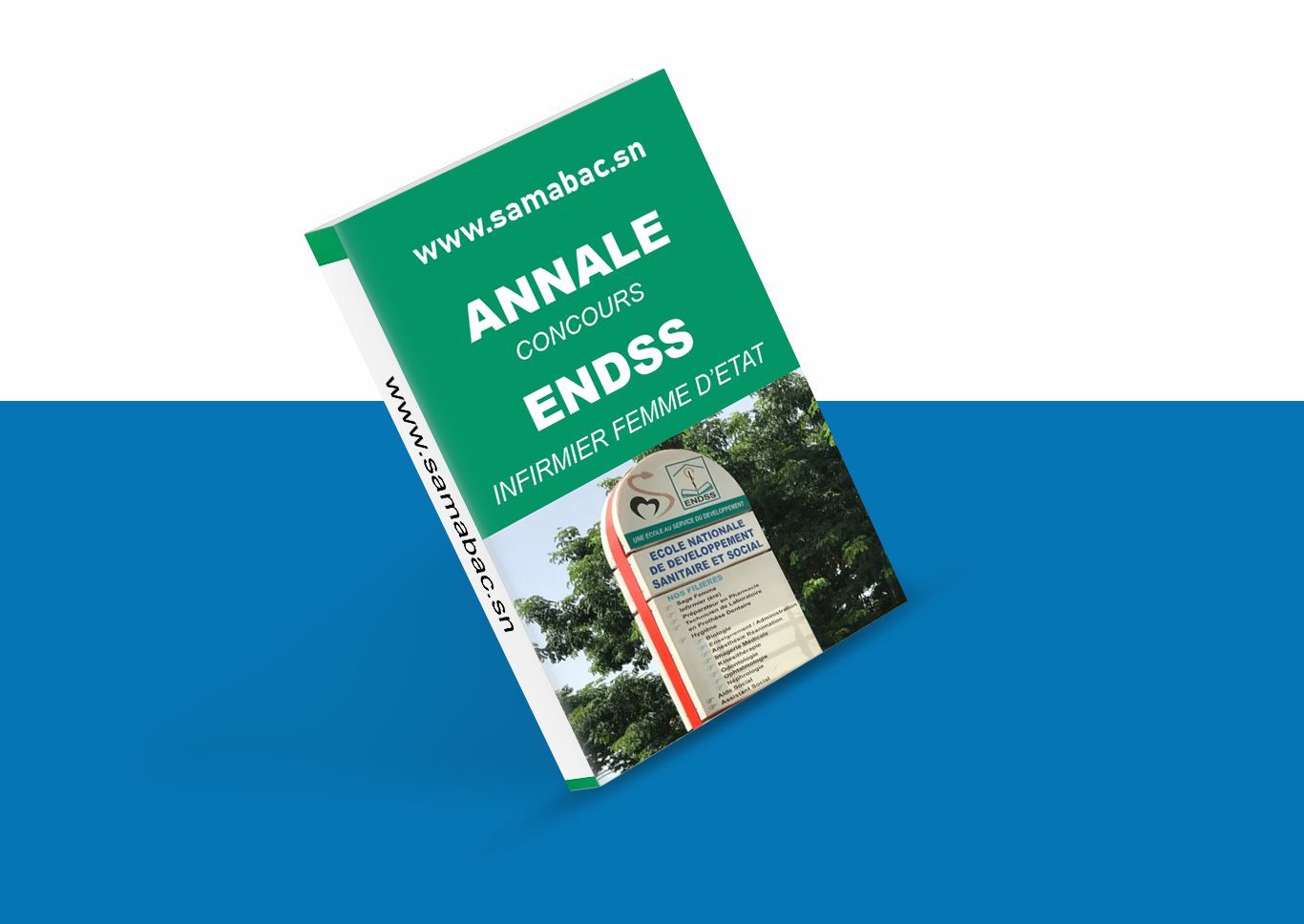
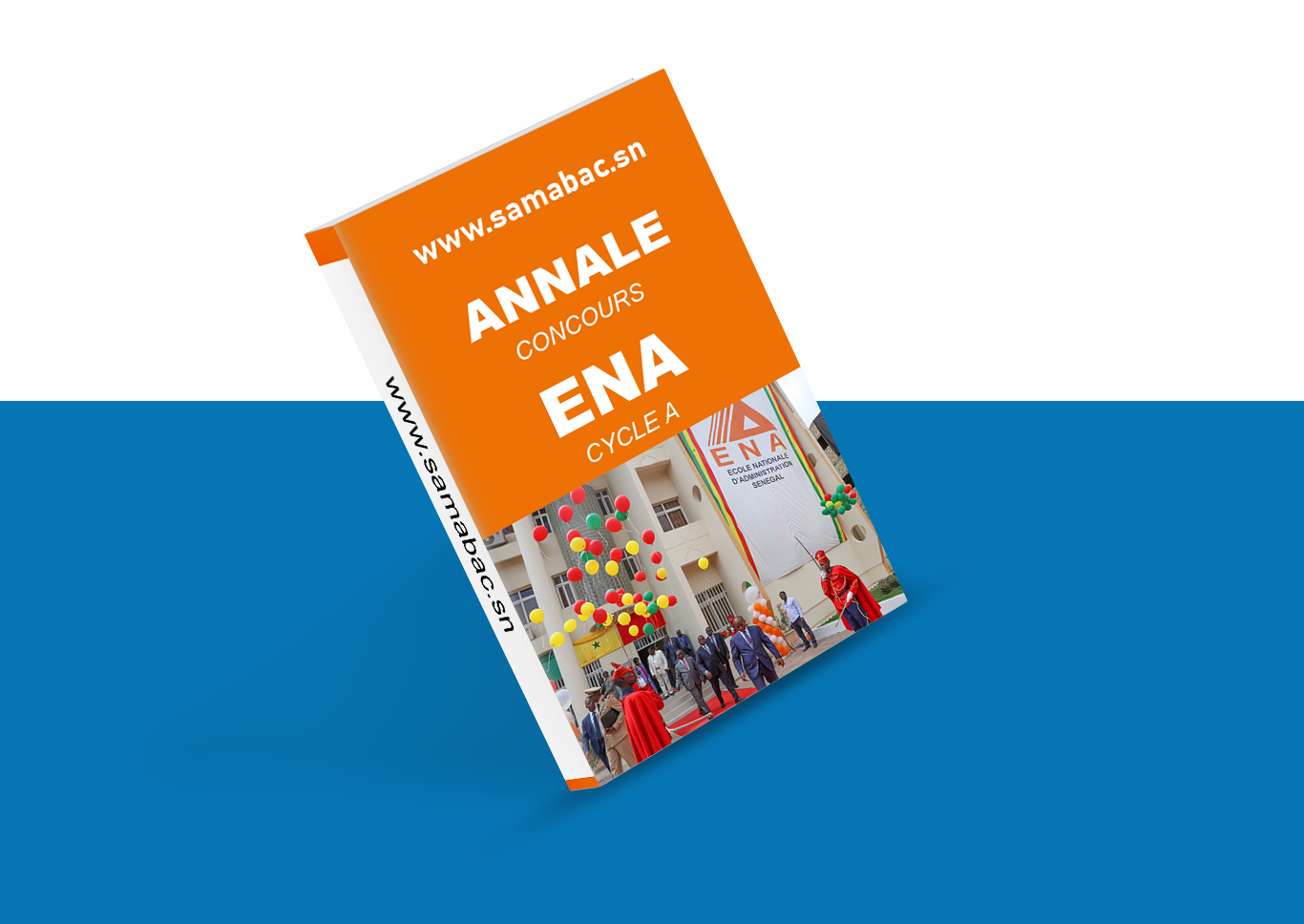
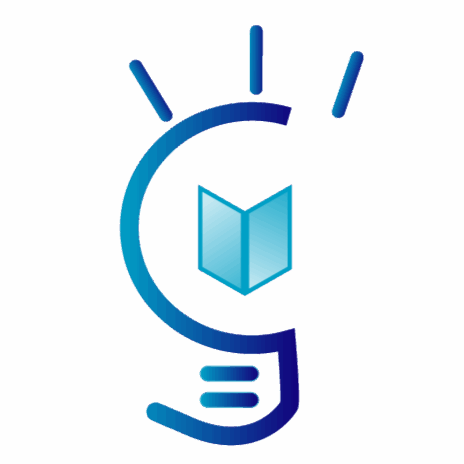




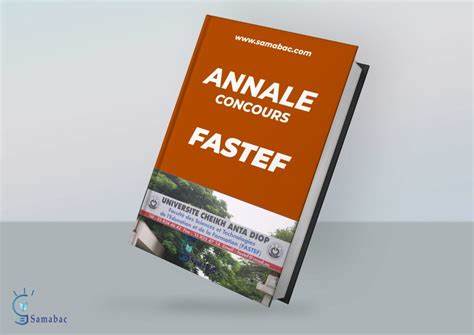




.jpeg)