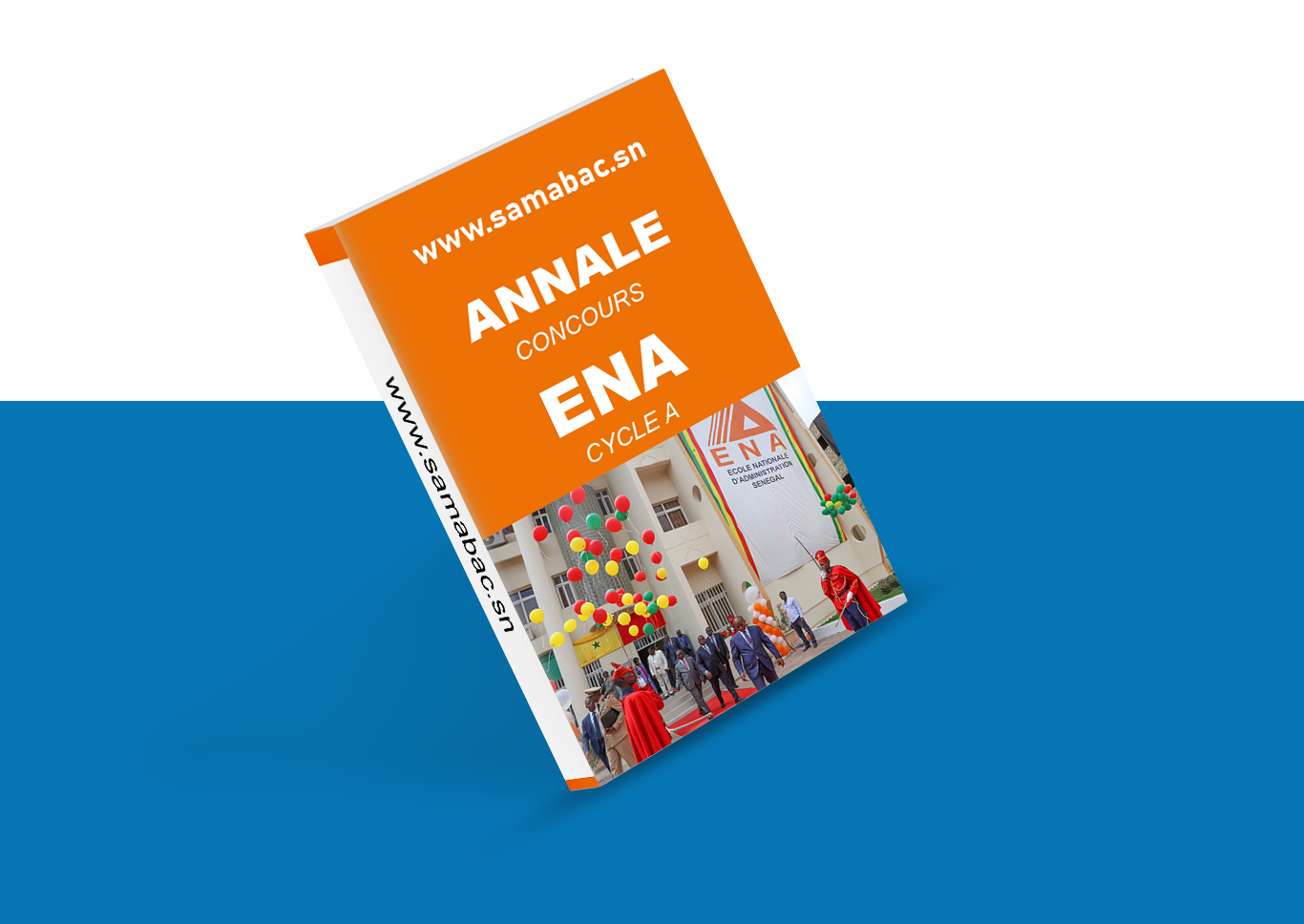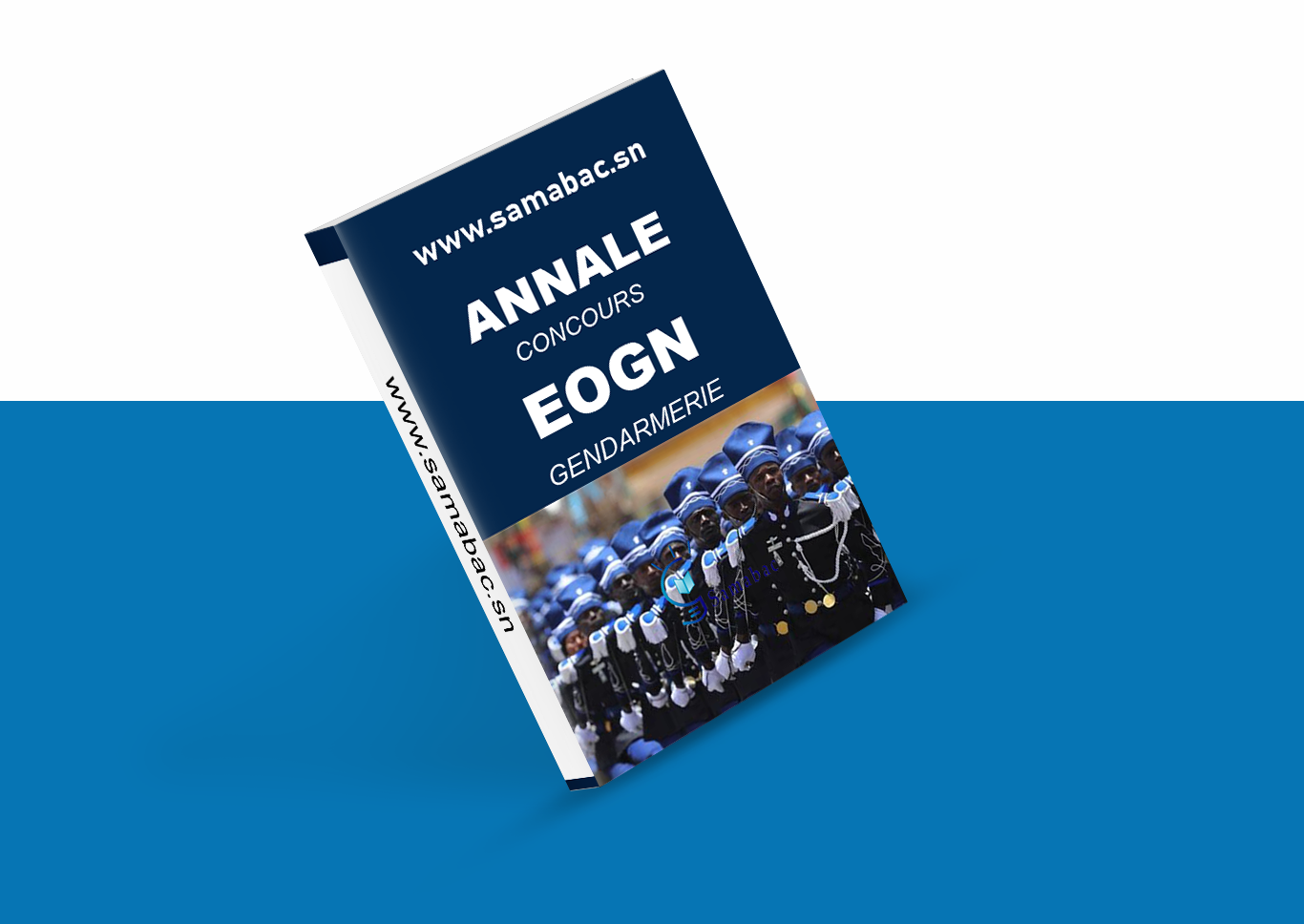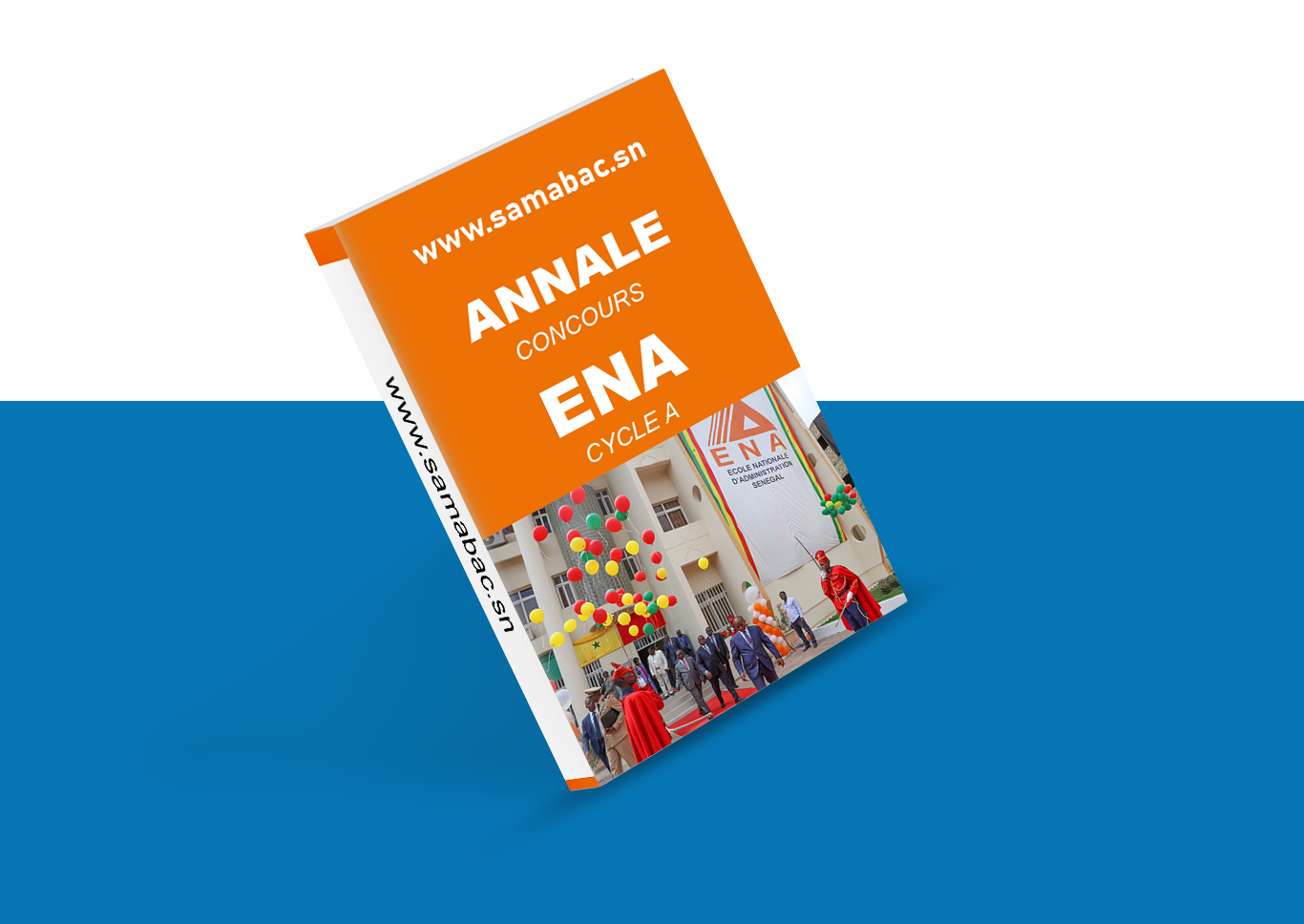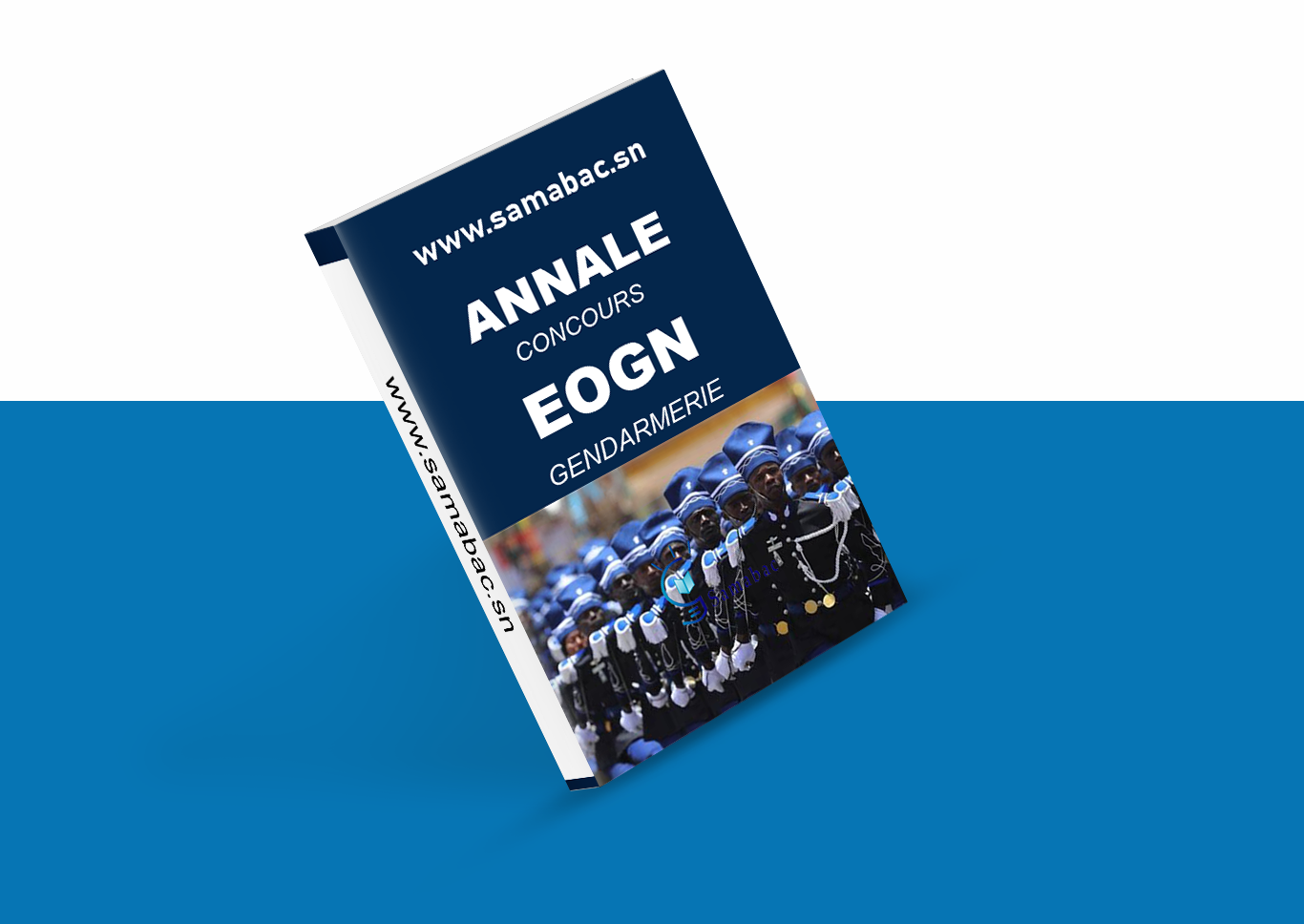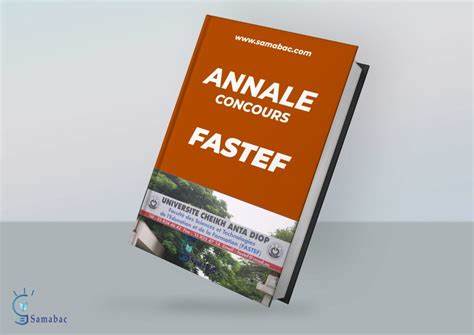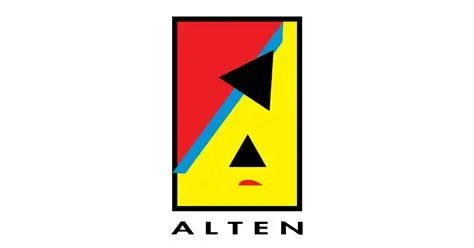CORRECTION DE L’EXERCICE DE
Q.C.M. sur LE PARNASSE
1. LE MOT ”PARNASSE” ÉTAIT, À L’ORIGINE, LE NOM
- D’UNE MONTAGNE.
Elle se trouve en Phocide. Il s’agit du lieu de résidence des muses, filles de Zeus et de Mnémosine. Au nombre de neuf et autour d’Apollon au sommet du mont dont une fontaine sortait des flancs, ces médiatrices entre les dieux et les humains célébraient la beauté dans toute sa splendeur et selon ses diverses provenances Ainsi, on disait des hommes qui avaient du génie qu’ils étaient inspirés par les muses réunies dans cette phrase mnémotechnique : Clame, Eugénie, ta mélodie, terrible et polonaise, uphonie calculée (Clio, Eutherpe, Thalie, Melpomène, Terpsichore, Polymnie, Uranus et Calliope).
Si des écrivains ont choisi ce mot pour dénommer le courant artistique dont ils se réclament, c’est donc pour élever l’art (la montagne) jusqu’à son office premier : l’exécution ou la célébration exclusive de la beauté.
2. PARMI CES COUPLES D’AUTEURS, SEUL UN FIGURE DANS LE CERCLE RESTREINT DES PARNASSIENS :
- GAUTIER / HEREDIA.
Ces deux auteurs sont incontournables quand on parle du parnasse.
L’un est le précurseur du mouvement ; ses écrits retentissent comme un manifeste pour consolider l’idée selon laquelle l’œuvre est avant tout artistique dans le sens propre du terme.
L’autre est l’auteur du recueil intitulé Les Trophées (1893). Il y fait la froide peinture des civilisations très reculées dans le temps et dans l’espace.
3. LE TITRE DU POÈME OÙ SON AUTEUR COMPARE L’ACTIVITÉ CRÉATRICE ARTISTIQUE À LA SCULPTURE EST :
- L’ART.
Voici un poème de Émaux et Camées (1852, titre suffisamment évocateur d'ailleurs) dont la lecture laisse penser qu’il incarne, structure, traduit ce à quoi est destinée l’activité créatrice des parnassiens. L’auteur y décrit le travail esthétique acharné semblable à celui d’un sculpteur. D’ailleurs, dans la dernière strophe, le poète ordonne : « Sculpte, lime, cisèle ; / Que ton rêve flottant / Se scelle / Dans le bloc résistant ! ». L’objectif est donc clair : faire naître par un travail acharné la forme d’une œuvre impérissable, immortelle, défiant les lois de l’usure du temps pour avoir frisé la perfection. C’est pourquoi Gautier y affirme : « Les dieux eux-mêmes meurent / Mais les vers souverains / Demeurent / Plus forts que les airains ». Même si comparaison n’est pas raison, ce travail ressemble à celui exercé par des membres de l’ethnie Laobé du Sénégal (des sculpteurs : hommage à eux au passage), à la différence que la matière que eux ils travaillent fait naître des objets utiles destinés à la commercialisation : mortier, siège, pilon, œuvres d’art…
4. TOUT LE PROJET ARTISTIQUE DES PARNASSIENS REPOSE SUR :
- LE BEAU.
Le bien est l’opposé du mal, donc en rapport avec la fonction moraliste. Le bon est en rapport avec le mauvais et donc en lien avec l’engagement. C’est le beau, sous le rapport avec la forme qui offre un plaisir aux sens, qui intéresse particulièrement les parnassiens. Cette beauté, elle se définit en mode 3 D : il s’agit d’abord de la beauté de la forme ou du style en harmonie avec la versification ; il s’agit ensuite de la beauté des thèmes ou des objets qui peuplent le décor représenté ; il s’agit enfin d’une beauté complètement détournée de toute fonction utilitaire (soulagement, engagement, enseignement). Voici donc des écrivains exclusivement dévoués à la reproduction du beau. C’est d’ailleurs toute la raison pour laquelle Gautier affirmait : « tout artiste qui se propose autre chose que le beau n’est pas artiste à nos yeux ».
5. L’ÉCRIVAIN PARNASSIEN REJETTE TOUS CES TROIS :
Ni L’UTILITÉ, ni L’ENGAGEMENT, ni LA MORALE n’intéressent l’auteur parnassien. La seule utilité autorisée à une œuvre d’art, c’est sa beauté. Toute autre orientation, qu’elle soit d’utilité personnelle ou collective, lui nuit. Seule la conception mérite tous les suffrages, toute l’attention, la seule préoccupation. C’est pourquoi Gautier affirmait : « j’aimerais mieux avoir mon soulier mal cousu que de faire des vers mal rimés » ; il veut dire par là qu’il pourrait tout négliger sauf le style à perfectionner.
En un mot et en toute logique, un écrivain qui s’adonne à l’effusion de ses sentiments (lyrisme), à la dénonciation d’une injustice, à l’enseignement de leçons de morale, n’est pas parnassien.
6. PARMI CES THÈMES, CELUI PRÉFÉRÉ DES PARNASSIENS EST
- L’EXOTISME.
L’exotisme est ce goût prononcé pour les contrées lointaines dans l’espace ou enfouies dans le passé. D’ailleurs, Gautier (il est incontournable !) disait à ce sujet : « ce qui nous distingue, c’est l’exotisme. Moi, rien ne m’exciterait comme une momie » (cité par Jules et Edmond Goncourt, Journal, page 133). Justement, c’est pour davantage éloigner l’activité créatrice de toute orientation utilitariste que ces écrivains y puisent l’inspiration. C’est d’ailleurs non seulement toute la raison pour laquelle ces écrivains prônent l’impersonnalité mais aussi optent pour la représentation de temps éloignés ou de lieux reculés de la civilisation dite moderne.
Pour s’en convaincre, on peut se focaliser par exemple sur deux textes célèbres. Le premier, c’est « Antoine et Cléopâtre », un poème du recueil Les Trophées (1862) écrit par Jose Maria-Heredia ; le poète s’inspire de l’histoire égyptienne sous le règne de Cléopâtre dont le romain Antoine est amoureux. Le deuxième, c’est Le « sommeil du condor », une pièce du recueil écrit par Leconte de Lisle et au titre suffisamment évocateur : Poèmes barbares (1868) ; en vrai peintre animalier, l’auteur se plaît à décrire cet oiseau nébuleux pendant qu’il s’endort du haut des chaines rocheuses des Andes.
Ce qu’il y a de commun à ces deux textes phares, c’est ce recul absolu dans le choix de la source d’inspiration, ce goût prononcé pour l’exotisme, cette allégeance vouée à un style épuré jusque dans le choix des décors représentés rien que pour éloigner l’art de toute vocation moraliste, personnelle ou militante que la plupart des auteurs attachent à leurs productions si enclines à la civilisation dite moderne.
7. PAR QUELLE FORMULE LES PARNASSIENS ONT-ILS THÉORISÉ LEUR REJET DE TOUT CE QUI ÉLOIGNE L’ART DE CE POURQUOI L’HOMME S’Y ADONNE ?
- L’ART POUR L’ART.
Les classiques employaient la littérature pour dispenser des leçons de morale ; les lyriques s'y appuyaient pour s'épancher ; les romantiques engagés s'en servaient pour se révolter ; les réalistes l'utilisaient pour représenter la réalité, rien que la réalité et toute la réalité (même les choses qui répugnent). Les Parnassiens, eux, pensent que tout ceci éloigne l'art de son office premier : la peinture du beau.
Pour eux, l'art (la littérature) ne doit servir qu'à l'art (l’expression de la beauté). C’est ce qui justifie cette célèbre formule qui leur est attribuée : « l’art pour l’art ». Quand on avait demandé à Gautier pour quelle raison il rejetait l’engagement, voilà ce qu’il avait répondu : « la politique dans une œuvre d’art, c’est comme un coup de pistolet au milieu d’un concert », pour dire qu’il gâte toute la beauté du texte artistique.
Si le Parnassien devait choisir de représenter, entre une fleur et des toilettes, il chercherait d'abord l'objet ou le sujet le plus inutile (ou en tout cas le moins utile) comme source d'inspiration idéale. À coup sûr, la fleur mériterait tous ses suffrages, au lieu des toilettes.
8. QUI A DIT : « IL N’Y A DE VRAIMENT BEAU QUE CE QUI NE PEUT SERVIR À RIEN ; TOUT CE QUI EST UTILE EST LAID » ?
- THÉOPHILE GAUTIER.
Ces propos entretiennent un rapport étroit avec l’art pour l’art sauf qu’ici il faut préciser un détail important : la beauté dont parle Gautier. Il s’agit de la beauté formelle, thématique et qui n’est d’aucune utilité publique.
9. LE GENRE LITTÉRAIRE PRIVILÉGIÉ PAR LES PARNASSIENS EST :
- LA POÉSIE.
Si la plupart des écrivains parnassiens sont des poètes, nous ne devrons pas trop en être surpris, vu tout ce que nous venons de savoir sur le beau. Qu'est-ce qui peut bien justifier cette prédilection pour ce genre littéraire majeur ? Deux arguments fondamentaux peuvent donner des raisons de le comprendre et de le croire.
D'une part, il suffit de se rappeler la définition que Paul Verlaine donnait à la poésie : « de la musique avant toute chose » ; en effet, c'est la poésie avec ses strophes scandées, ses vers ciselés, ses rimes sonorisées, ses rythmes harmonisés, qui s'apparente le plus à la musique, qui traduit le mieux la beauté qui séduit le regard, et avant même une lecture approfondie, comparée aux autres genres littéraires. C'est bien par elle que, par le biais des descriptions rondement accomplies, l’artiste atteint le plus la fibre sensorielle des lecteurs, grâce à la conjugaison de deux arts (musique et littérature) dans un même champ de perception.
D'autre part, le poète, à l'image du prophète (deux mots qui riment bien), regrettent la désacralisation de l'art pour des besoins purement personnels ou utilitaristes. Pour lui faire conserver son caractère sacré, ces écrivains choisissent la poésie (écrite en vers), genre littéraire qui ressemble le plus à l'écriture des textes sacrés (présentés sous forme de versets). En un mot, c'est pour la musicalité et la sacralité de l'art que les parnassiens ont jeté leur dévolu sur la poésie.
10. CE POÈTE QUI AIME BIEN LE STYLE PARNASSIEN, MÊME S’IL NE PARTAGE PAS TOTALEMENT LEUR IDÉAL, EST :
- CHARLES BAUDELAIRE.
Cet écrivain acclame la pureté du style prônée par les parnassiens ; en revanche, il leur reproche le fait d’avoir voulu réduire l’art à sa plus simple expression : la représentation du beau. Pour lui et les symbolistes en général, le réel qui environne l'humanité est peuplé de signes qui nous parlent dans un langage codé mais, hélas, inaudible, imperceptible pour le commun des mortels. Seul un œil averti, un esprit observateur, une attention particulière portée sur les objets, en un mot un illuminé comme l'artiste, le poète, est capable d'en comprendre le sens profond sous la structure de surface.
Les symbolistes sont alors absolument convaincus que le rôle de l'artiste consiste à découvrir littéralement et littérairement, au grand bonheur des hommes, le sens caché des objets qui nous entourent. Voilà pourquoi ils utilisent les figures de substitution telles que la comparaison, la métaphore, la périphrase, l'allégorie... et démontrent que le rôle de l'artiste devrait être de représenter ces lignes arrière, de montrer les arbres que cache la forêt. C'est aussi pour toutes ces raisons que, dans un réseau de sonorités complexes et de sensations diverses, dans « Correspondances », un de ses poèmes des Fleurs du Mal (1857), Baudelaire disait :
La nature est un temple où de vivants piliers
Laissent parfois sortir de confuses paroles ;
L'homme y passe à travers des forêts de symboles
Qui l'observent avec des regards familiers.
Cet auteur a donc inauguré une nouvelle poésie : celle de la suggestion de l’existence d’un monde invisible et spirituel. Comme l’a écrit Jean Morreas dans Le Manifeste du symbolisme (1886), c’est une activité créatrice qui consiste à « vêtir l’idée d’une forme sensible ». Ce ”poète maudit” s’exposera à des critiques, des sanctions, car certains qualifiaient les écrivains qui s'adonnaient à cette forme de littérature comme des gens qui encouragent la jeunesse au vice (drogue, sexualité, fugue, déviances, alcoolisme dont les mérites sont souvent vantés). Pourtant, ces écrivains restent persuadés qu'ils promettent au monde une délivrance prométhéenne à la limite, en sortant l'humanité des ténèbres pour la mener vers la lumière. D'ailleurs, des écrivains du siècle suivant porteront encore plus loin ce flambeau : les surréalistes.
Issa Laye DIAW
Donneur universel
WhatsApp : +221782321749
Lien de la page Facebook :
https://www.facebook.com/profile.php?id=100044574573212