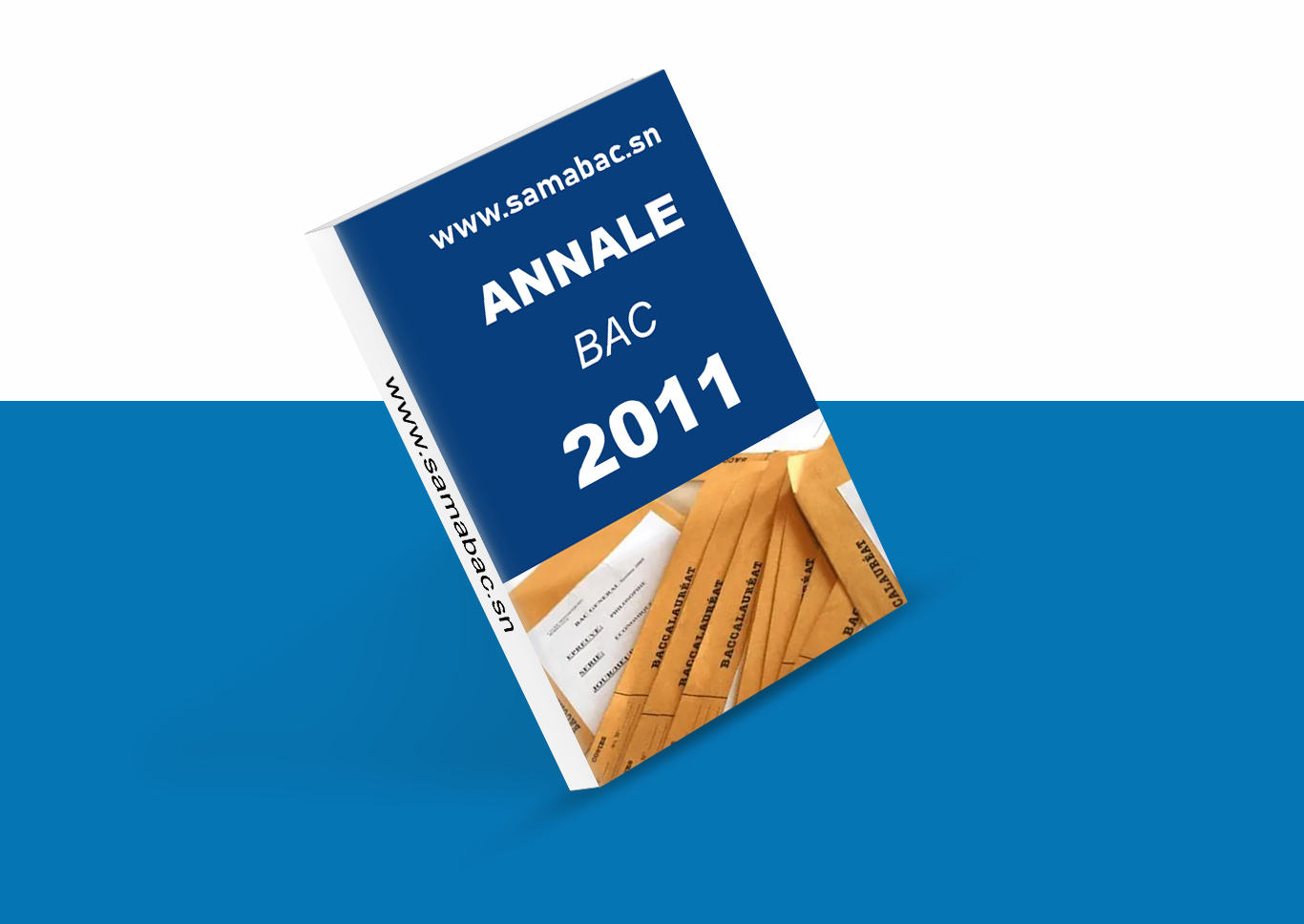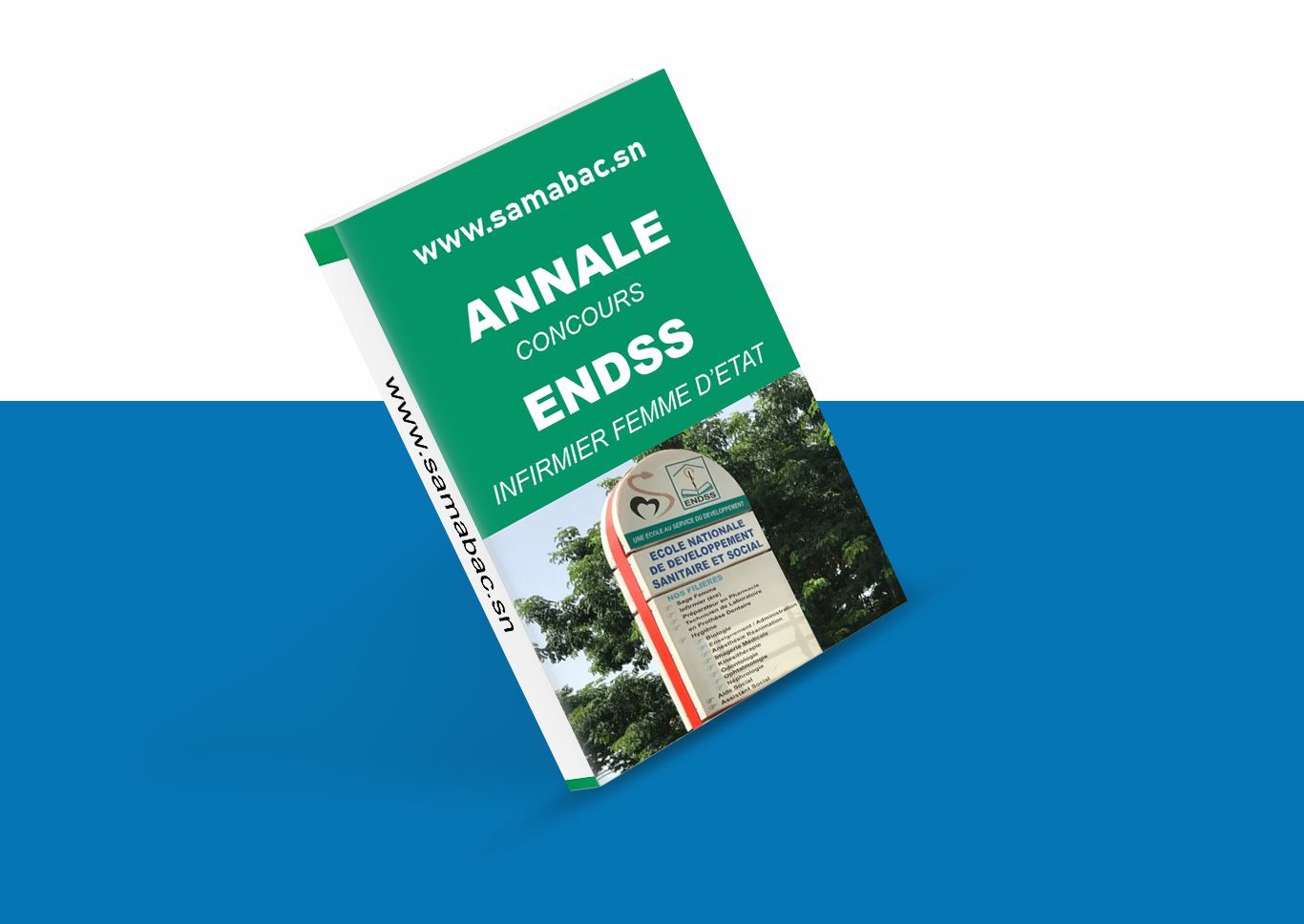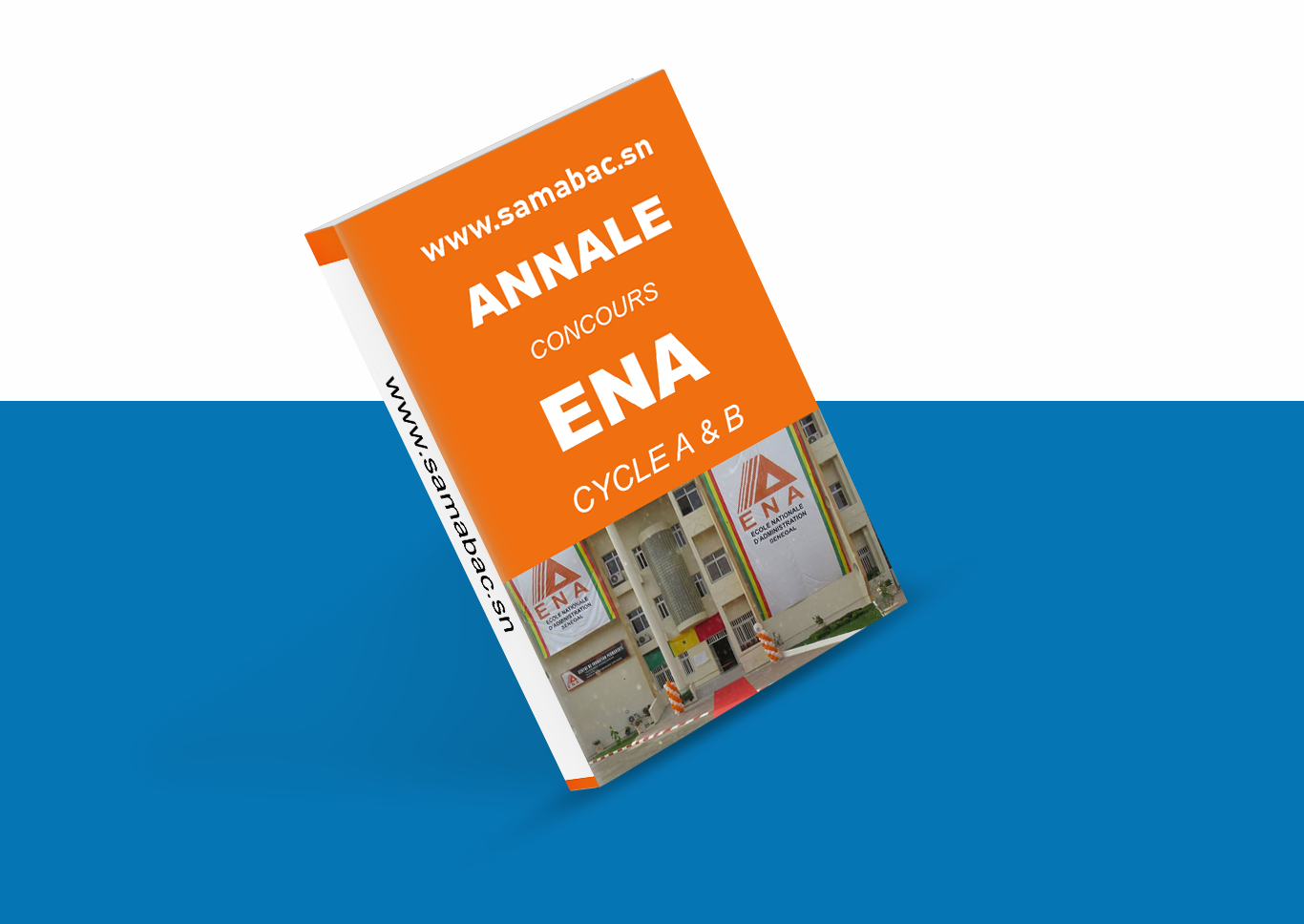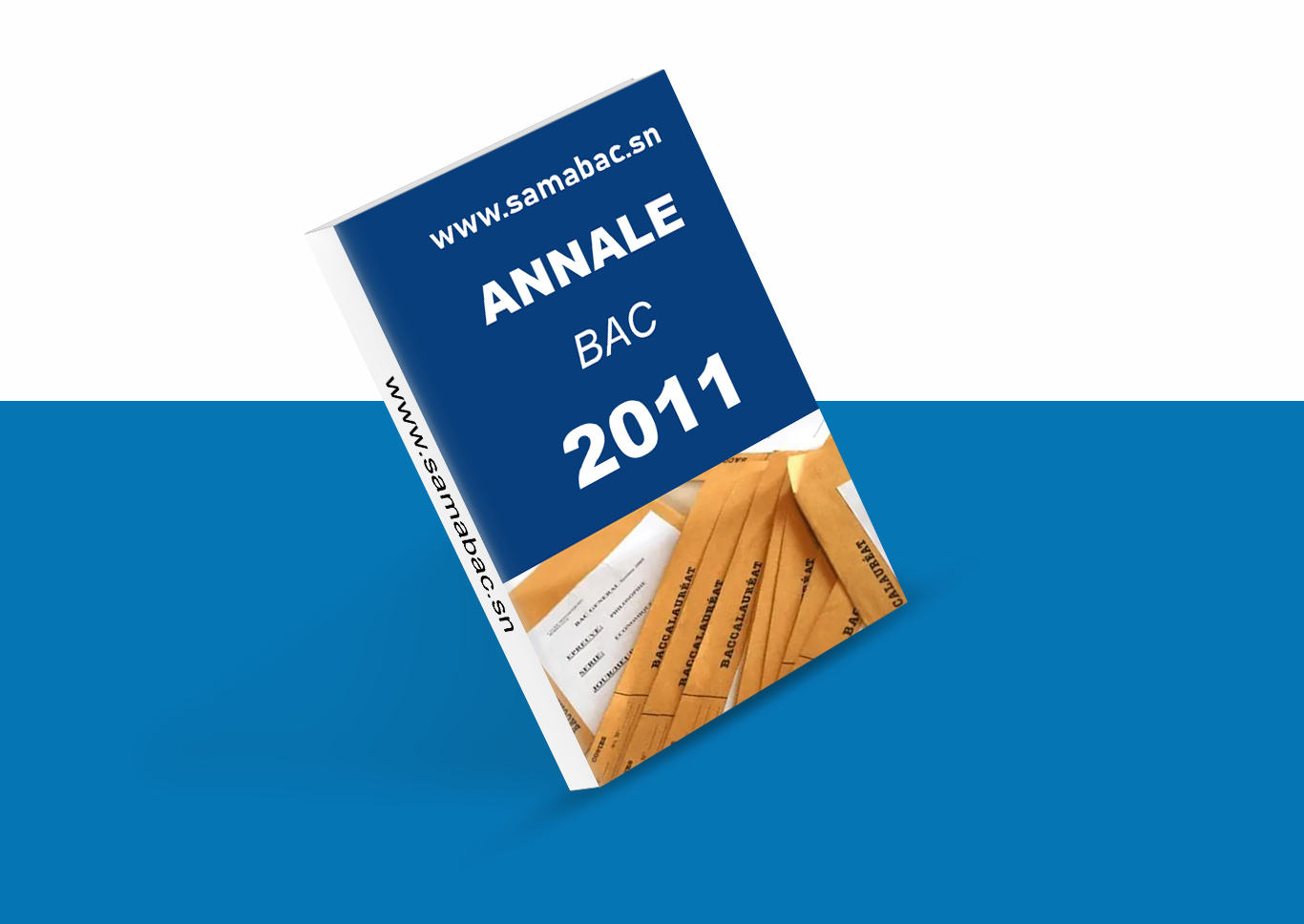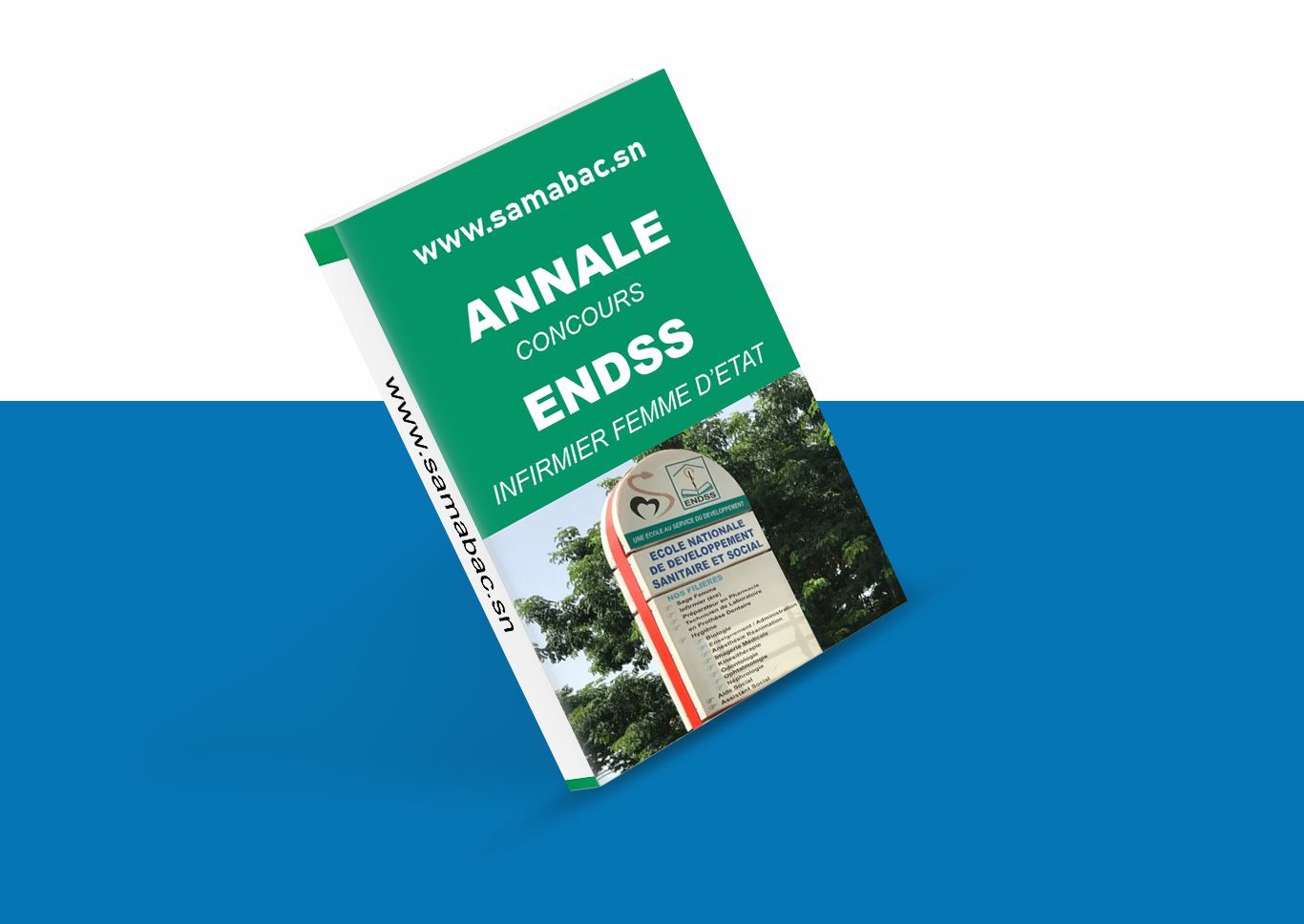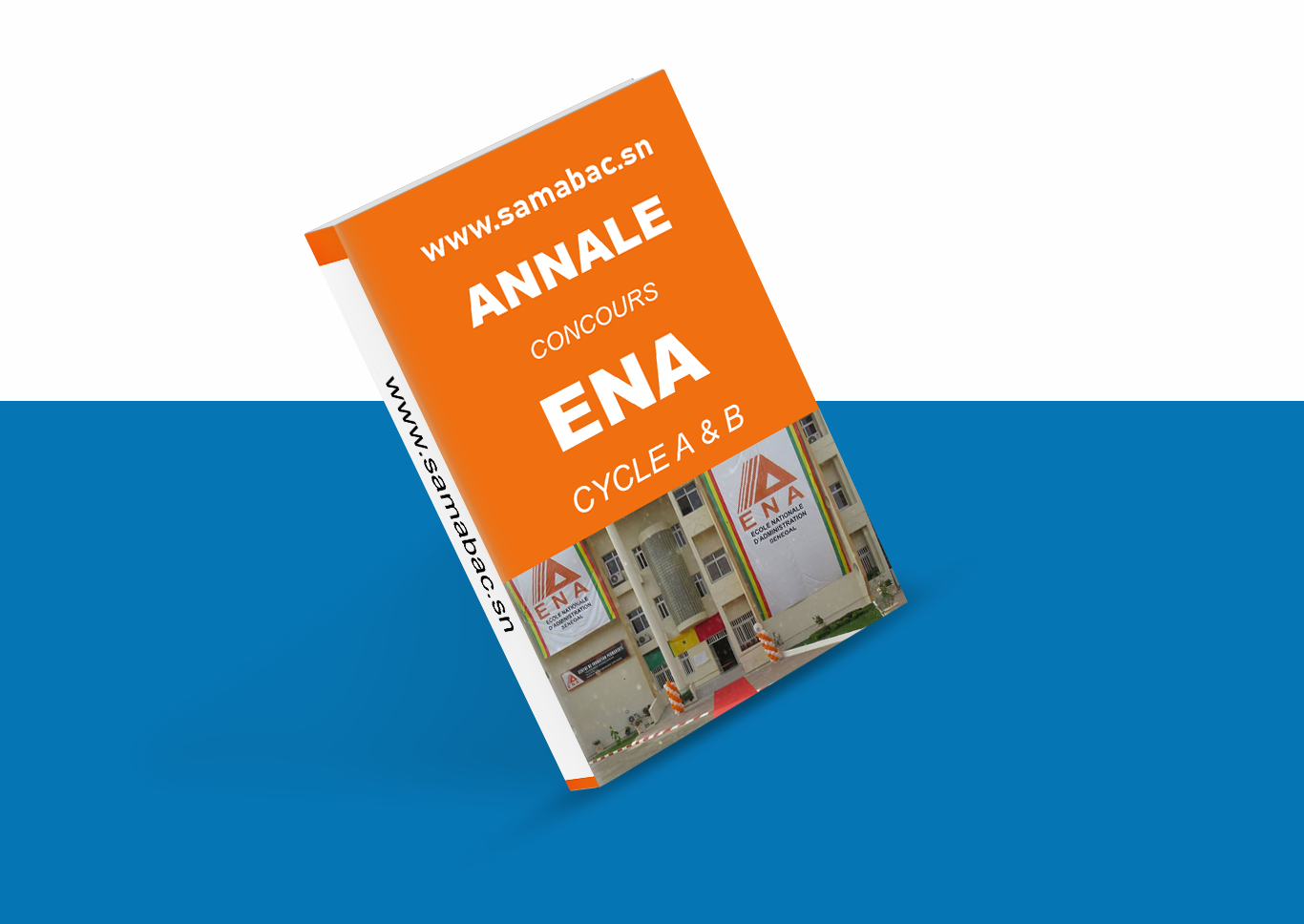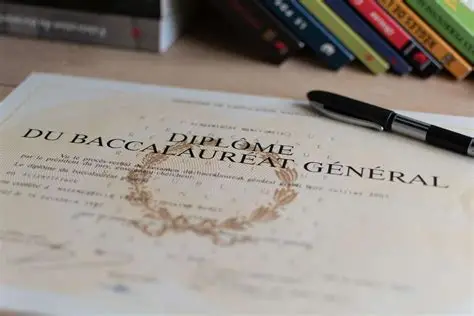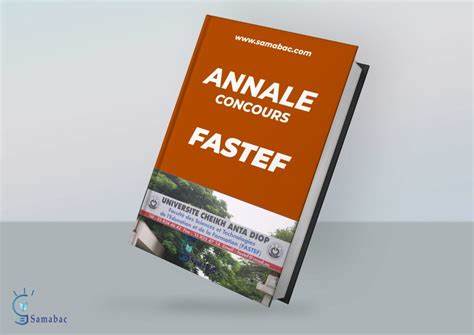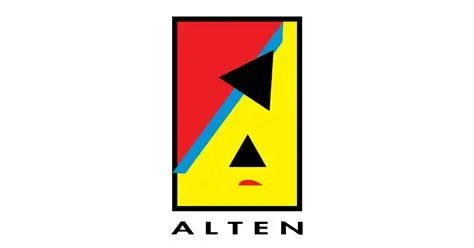Chants d’ombres(1945) de Léopold Sédar SENGHOR
I /Vie et œuvre de SENGHOR :
SENGHOR voit le jour à Joal en 1906 « quand le siècle avait six ans ».On lui donna le nom de Sédar qui signifie « celui qui ne connaîtra jamais la honte » .Son père Diogaye Basile Senghor est un riche commerçant et sa mère Gnilane Bakhoum est issue d’une famille qui possède quelques champs et quelques têtes de bétail. SENGHOR passera les sept premières années de sa vie à Djilor, village de sa mère où son oncle maternel (Tockô’ waly) lui fera découvrir la nature et ses mystères. Cette période de sa vie marquera profondément le futur poète car il évoquera souvent dans ses poèmes ce « royaume d’enfance ».
Ensuite, il poursuivra son éducation chez les pères de Ngazobil. Après son certificat d’études primaires, comme il envisage de devenir prêtre, il est envoyé au collège –Séminaire Libermann de Dakar .C’est à cette époque que Senghor commencera déjà à prendre conscience de certains préjugés dont la race noire était victime. Le Père directeur, jugeant son esprit frondeur incompatible avec la vocation de prêtre, l’oblige à aller au cours secondaire Laïque.
Quand il obtient son Baccalauréat, il renonça définitivement à sa vocation et va poursuivre ses études en France. SENGHOR évoquera plus tard son angoisse lors de ce départ dans son poème « C’est le temps de partir » tiré de Chants d’ombre (c’est le temps de partir, d’affronter, l’angoisse des gares) ; il y évoquera aussi ce « Paris froid » qui manque de chaleur climatique et humaine (le vent qui rase les trottoirs dans les gares de province ouvertes / L’angoisse des départs sans main chaude dans la main …). SENGHOR est venu en France pour dira-t-il « se servir des armes de l’Europe, de la raison discursive pour acquérir les sciences de l’Europe qui nous permettraient d’avancer matériellement dans la voie de civilisation négro-africaine ». C’est ainsi à Paris que va se concevoir en 1934 le mouvement de la Négritude avec CÉSAIRE, DAMAS, SENGHOR. Ces années parisiennes sont pour le poète des années de maturation qui forgeront sa pensée et transformeront ses écritures.
En 1935, Senghor est reçu à l’agrégation de grammaire, ensuite il est nommé professeur et il « enseigne le français aux français de France ». En 1939, SENGHOR qui a la nationalité française participe à la deuxième guerre mondiale et sera fait prisonnier. Le recueil Hosties noires évoque ses sentiments et les sacrifices des tirailleurs.
Après la guerre, de retour au pays pour étudier le rythme sérère, il sera persuadé par Lamine Guèye (Maire de Dakar) pour s’engager dans la politique (« je voyais la misère des paysans […] et j’ai accepté […] mon but était de mener le Sénégal à l’indépendance, après quoi je prendrai ma retraite politique ». Partagé entre son intérêt pour la littérature et le devoir de s’impliquer dans la politique, le poète qui se voulait le djali, le griot de son peuple, va en devenir le porte-parole car il sera successivement Député, Secrétaire d’Etat et premier Président du Sénégal indépendant. Il occupera ce dernier poste pendant 20 ans avant de quitter volontairement le pouvoir .Sa politique était basée sur l’éducation qui, selon lui, est la base de l’évolution des peuples car « le progrès repose sur les hommes ».
Après sa retraite politique, il entre à l’Académie Française en 1984. Sa vie privée est endeuillée par la mort accidentelle de deux de ses enfants nés de son second mariage avec Colette. Après avoir connu les honneurs d’une destinée internationale, SENGHOR se retire à Verson où il finira ses jours le 20 décembre 2001 .Il sera enterré à Bel Air à Dakar à côté de son fils malgré les réticences de certains qui affirmaient que Senghor voulait être enterré à Joal.
Ce poète-président qui préférait modestement les joies de l’esprit aux griseries du pouvoir s’est immortalisé à jamais à travers sa production littéraire ; c’est lui-même qui, parlant de la mort, disait « je suis plein d’angoisse et je me demande ce qu’est la mort […] En tant qu’écrivain, en tant que poète, je pense que le but ultime de la vie d’un homme ,c’est de créer des œuvres de beauté, et c’est à travers ces créations qu’on participe à l’ éternité de la vie . »
II/ Structure et Thèmes du recueil Chants d’ombre :
Le titre semble revêtir une double signification : pour Senghor le chant exprime une spécificité culturelle en Afrique où la création littéraire reste essentiellement orale et se transmet souvent par le chant. Le chant, pour SENGHOR, est synonyme de poésie, de moyen de communication avec l’autre. L’ombre, quant à elle, peut aussi bien suggérer l’inquiétude, le mystère, que la sagesse, le sacré, la couleur noire, en un mot l’Afrique. En effet, la plupart des titres de poèmes ou de recueils de poèmes de SENGHOR renvoient soit à la couleur noire (Nuit de Sine, Femme noire, Hosties noires, Nocturnes …) soit à des réalités typiquement africaines (Masque nègre, Au Guélowâr, Que m’accompagnent kôras et balafong, Lettres d’Hivernage …)
2 / Composition et thèmes :
Chants d’ombre, publié en 1945, est composé de poèmes écrits vers les années 1930 et pour la plupart ayant pour cadre la France. Ce recueil est structuré en sous parties ou sections qui sont les suivantes :
Elle est composée de 17 poèmes dont 2 sont dédiés à Aimé Césaire et à Pablo Picasso. Cette section traduit le mal du poète et sa nostalgie pour l’Afrique.Elle exprime aussi l’esthétique nègre, l’affirmation d’une culture noire, la reconnaissance du poète.
-Deuxième section(« Que m’accompagnent kôras et Balafong »)
Le poète y fait un va-et-vient entre le passé (son enfance, sa formation intellectuelle et religieuse) et le présent marqué par son écartèlement entre deux cultures symbolisées par deux jeunes filles et le choix à faire. Pour l’action future, le poète veut rétablir l’ordre ancien et traditionnel que l’Europe avait bouleversé en falsifiant l’histoire réelle. Enfin, le poète fait une synthèse entre hier et aujourd’hui en mettant en relief l’esthétique nègre.
- Troisième section (« Par-delà Eros »)
Comme l’indique le titre, on retrouve dans cette partie des poèmes d’amour. Il s’agit de l’amour pour différentes femmes de races variées. Le poète s’amuse à brouiller ses souvenirs en utilisant souvent la métonymie.
-Quatrième section (« Le retour de l’enfant prodigue »)
Après une longue absence, le poète rentre à la maison paternelle. Pour se défaire de l’influence de la civilisation européenne, il fait appel aux « Anciens ». Ambassadeur de sa race, le poète veut libérer son peuple asservi et exploité en sollicitant le soutien des « Anciens » et en ressuscitant le passé lointain. Il fait alterner le passé (fait de bonheur) et le présent (synonyme de négation des valeurs humaines) qui s’éclairent mutuellement par contraste.
Dans Chants d’ombre SENGHOR développe plusieurs thèmes parmi lesquels on pourrait retenir le royaume d’enfance, la femme, le syncrétisme religieux, la civilisation de l’universel, la fonction du poète, la mort …
Le poète fait souvent référence au Royaume d’enfance qui représente pour lui l’Afrique, le passé idéalisé. Ce thème permet de retourner à la pureté première qui est aussi source d’inspiration pour SENGHOR qui déclarera : « Et puisqu’ il faut m’expliquer sur mes poèmes, je confesserai encore que presque tous les êtres et choses qu’ ils évoquent sont de mon canton : quelques villages sérères perdus parmi les tanns (les terres plates ,que recouvre la mer ou le bras de mer à l’époque des grandes marées),les bois, les bolongs (les bras de mer ou chenaux, bordés de palétuviers) et les champs. Il me suffit de les nommer pour revivre le Royaume d’enfance… »
Dans les poèmes de SENGHOR, même si la femme semble représenter l’Afrique, elle symbolise aussi bien la femme noire que la femme blanche. Avec ce thème SENGHOR réussit d’innombrables variations, ne se lassant jamais d’évoquer le visage, la poitrine, la voix des signares ou les yeux, les cheveux, les mains de la Normande. Ce souci de symbiose culturelle sera développée par le thème de la civilisation de l’universel (Négritude=enracinement +ouverture) et le syncrétisme religieux (cohabitation bénéfique ente les religions)
Le thème de la fonction du poète donne tout son sens à ce recueil. En effet, il permet à SENGHOR de définir le rôle que l’écrivain noir doit jouer au sein de sa société en étant comme le propose Césaire « la bouche des malheurs qui n’ont point de bouche ». Il doit être griot, le« dyâli » c’est-à-dire celui qui transmet une parole, qui vient du passé et qui demeure puissance de vie pour les auditeurs présents. Il ne s’agit pas seulement pour le poète de maîtriser le pouvoir de la parole mais aussi et surtout de porter aux oreilles du monde la parole retrouvée de son peuple (Donne-moi de mourir pour la querelle de mon peuple, et s’il le faut dans l’odeur de la poudre et du canon. /Conserve et enracine dans mon cœur libéré l’amour premier de ce même peuple /Fais de-moi ton Maître de langue ; mais non, nomme-moi son ambassadeur) .
Ce thème définit bien la poésie senghorienne qui est défense et illustration de la négritude, reconstitution d’une image positive de l’Afrique.
Le thème de la mort est constant chants d’ombre sous une forme lyrique, angoissante .Elle est parfois apaisante car en Afrique « les morts ne sont pas morts » et Senghor ajoutera que « En Afrique, la mort marque le passage, une simple porte, mais une porte importante entre la vie et la mort. La mort, c’est le commencement d’une autre vie avec les ancêtres ». En outre, la poésie permettrait au poète d’apprivoiser la mort.
III / Le style dans Chants d’ombre :
Le poète définit son style comme le style nègre, le style qui n’est pas répétition, le style qui n’est pas soumission en un mot le style qui n’est pas logique.
SENGHOR fait état des reproches qui sont faits à Aimé Césaire, en particulier celui de « lasser » de fatiguer « par son rythme de tam-tam » ; et SENGHOR ajoute : «… comme si le propre du zèbre n’était pas de porter des zébrures. » Il y aurait donc un rapport intime, étroit, nécessaire, entre le rythme et les traditions poétiques négro-africaines. Le poète s’en explique en associant le rythme et l’authenticité : le Nègre, dit-il « est d’un monde où la parole se fait spontanément rythme dès que l’homme est ému, rendu à lui-même, à son authenticité.»
L’importance des traditions africaines, dans le rôle qu’il attribue au rythme, est immédiatement marquée par le fait que le poète donne parfois des indications sur les instruments africains (tam-tams, kôras, balafong) qui doivent accompagner certains poèmes (Que m’accompagnent kôras et balafong ; Le retour de l’enfant prodigue).
Malgré l’influence de la poésie française, l’on sent bien que SENGHOR ne se contente pas de juxtaposer ce qui pourrait s’appeler octosyllabes, décasyllabes alexandrins, etc. Il crée des vers réclamant une ampleur de respiration plus exigeante que les vers français traditionnels, et qu’on aura tendance à appeler des versets. (Le verset c’est initialement ,chacun des petits paragraphes traditionnellement constitués pour diviser un texte sacré ,comme la Bible ou le Coran . Mais ce nom est employé également, depuis 1933, pour désigner une phrase ou une suite de phrases rythmées d’une seule respiration, et découpées dans un texte poétique à la façon des versets des psaumes.)
Même si l’utilisation du verset à la place du vers traditionnel dans la poésie senghorienne a parfois été considérée comme une influence de Claudel ou de Saint John-Perse, il n’en demeure pas moins que la poésie de Chants d’ombre revêt une originalité incontestable. Cette originalité est en effet marquée par :
- l’omniprésence de la nomination : cf. « Joal », « Masques ! O Masques », « Femme noire ». Dans la culture dont il vient, le pouvoir du verbe ne se définit pas comme dans la culture occidentale .En effet, dit – il, dans les langues négro-africaines, « presque tous les mots sont descriptifs ». Qu’est-ce que cela veut dire ? Que dans ces langues, nommer une réalité, c’est décrire - c’est donc véritablement, rendre cette réalité présente, (alors que depuis la fin du XIXème siècle un certain nombre de poètes français, symbolistes notamment, ont pensé que nommer, c’était désigner les choses en absence, et, d’une certaine façon, faire briller leur absence.)
-On note l’emploi d’un lexique inhabituel et exotique puisé dans la réalité africaine (Ex :Dyâli, tyédo, signares, guelôwar…) ; d’un vocabulaire religieux et profane (Hostie, Tatum Ergo, pangoles) ; de multiples figures de style telles que l’anaphore (femme noire), la personnification, l’allégorie (représentation de l’Afrique) ; des rejets qui mettent en valeur un mot clé ou une réalité : « A peine » (p. 12) et des procédés sonores qui compensent l’absence de rimes (voici que décline la lune lasse vers son lit de mer étale)
-Le style dans Chants d’ombre est aussi marqué par des images surréalistes et des associations de mots étranges, des écarts syntaxiques qui réveillent l’imaginaire du lecteur et lui suggère plus de pistes d’interprétations ; des écarts lexicaux qui produisent plus de sens parce qu’ils échappent à la banalité : « Les patènes des joues », « je t’adore o beautés, de mon œil monocorde »p. 16
-On peut aussi noter la rareté de la ponctuation qui est parfois absente, ce que SENGHOR revendique comme « ponctuation expressive » qui assure une fluidité et une ampleur de la pensée.
-L’originalité de la poésie senghorienne se trouve aussi dans le mélange entre la tonalité épique ( par exemple quand le poète veut faire revivre le passé de l’Afrique et sa grandeur mythique) et la tonalité lyrique ( quand il évoque ses propres sentiments).
Le retour de l’enfant prodigue
Éléphant de Mbissel, entends ma prière pieuse.
Donne-moi la science fervente des grands docteurs de Tombouctou
Donne-moi la volonté de Soni Ali, le fils de la bave du lion- c’est un raz de marée à la conquête d’un continent.
Souffle sur moi la sagesse des Keïta.
Donne-moi le courage du Guelewar et ceins mes mains de force comme d’un tyédio.
Donne-moi de mourir pour la querelle de mon peuple, et s’il le faut dans l’odeur de la poudre et du canon.
Conserve et enracine dans mon cœur libéré l’amour premier de ce même peuple.
Fais de moi ton maître de Langue ; mais non, nome-moi son ambassadeur
Soyez bénis, mes Pères, qui bénissez l’enfant prodigue !
Je veux revoir le gynécée de droite ; j’y jouais avec les colombes, et avec mes frères, les fils du lion.
Ah ! de nouveau dormir dans le lit frais de mon enfance
Ah ! bordent de nouveau mon sommeil les si chères mains noires
Et de nouveau le blanc sourire de ma mère.
Demain, je reprendrai le chemin de l’Europe, chemin de l’ambassade
Dans le regret du Pays noir.
Léopold S. SENGHOR, Chants d’ombre, 1945