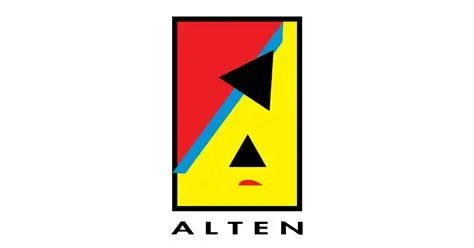2014 : L'Afrique : La marche vers l'indépendance
SUJET 2 : COMMENTAIRE DE TEXTE
La loi-cadre, présentée en 1956, par le ministre Deferre, accentua la parcellisation (…). La fédération, simple « groupe », ne représentait plus une unité politique ; le pouvoir local passa aux mains des partis. La décentralisation administrative était devenue politique. Quid de l’AOF ?
C’était compter sans le nationalisme africain, lentement mûri à travers les luttes syndicales et politiques des années trente, affirmé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Bloc, rassemblement ou regroupement, les partis africains n’aspiraient pas uniquement à l’indépendance mais aussi à l’unité. Est-ce un hasard ? Alors que la Côte d’ivoire, puis la Guinée et le Dahomey acceptèrent la cassure, ce fut au Sénégal et au Soudan que les projets d’union se développèrent et faillirent se réaliser.
L.S. Senghor dénonçait vigoureusement la Balkanisation et militait pour un regroupement politique, « une fédération primaire », dans le même temps où Modibo Keïta, au nom du panafricanisme, réclamait la fusion (…)
Sénégalais et Soudanais tentèrent de faire évoluer leur Etat au sein de la nouvelle Communauté (…) définie par la constitution de 1958.
Réunie à Dakar, du 14 au 17 janvier 1959, une assemblée constituante composée des représentants du Sénégal, du Soudan, du Dahomey et de la Haute-Volta établit un projet de construction politique panafricaine : la Fédération du Mali (…) Quelques mois plus tard, tous les territoires de l’ancienne AOF étaient devenus indépendants.
Le Sénégal et le Soudan se trouvèrent face à face. On sait ce qu’il advint (…)
LAKROUM, (Monique), dans l’Afrique occidentale au temps des français : colonisateurs et colonisés (c.1860-1960), sous la direction de Catherine Coquery-vidrovitch, éditions La Découverte, Paris, 1992, pages
188-189.
Q U E S T I O N S
1) Résumer le texte ci- dessus, au 1/4 de sa longueur, avec une marge de plus ou moins 10% (indiquer le nombre total de mots du texte et celui de votre résumé). (08 points)
2) Proposer un titre au texte, (02 points)
3) Commenter, le passage en gras dans le second paragraphe en illustrant le propos par des exemples précis. (05 points)
4) Considérant le passage « Le Sénégal et le Soudan se trouvèrent face à face. On sait ce qu’il advint », rappeler, en quelques lignes, dans quelles conditions le Sénégal et le Soudan se sont retrouvés seuls, « face à face » et ce qui advint de la Fédération du Mali. (05 points)
2010 :
SUJET II : COMMENTAIRE DU TEXTE
Ainsi donc une sorte de complicité planétaire sollicitait l’Afrique Noire dans la première décennie d’après-guerre et la poussait vers la liberté. Dans ce nouveau printemps des peuples (printemps souvent sanglant), des effluves incoercibles balayaient le globe. Encore fallait-il des gens pour les capter. En effet toutes ces influences extérieures, si décisives qu’elles fussent, n’auraient pas pu créer l’Afrique Noire d’aujourd’hui si des facteurs internes puissants de libération n’avaient été déjà au travail. Parmi eux la colonisation elle-même (…)
En effet, un effort de guerre exceptionnel fut demandé aux peuples africains (…). La fin de la guerre va amener le légitime désir de retrouver un rythme de vie normal, moins inhumain. Mais les principes coloniaux eux-mêmes inculqués par l’Education et la pratique administrative, ne débouchaient-ils pas sur la revendication anticolonialiste quand on les poussait au bout de leur logique ? (…).
N’oublions pas non plus que les pays colonisateurs ne présentaient pas un front homogène à cet égard.
Joseph Ki zerbo (1920-2006)
Histoire de l’Afrique Noire d’Hier à demain
Hatier.Paris 1978 pp. 474 – 475

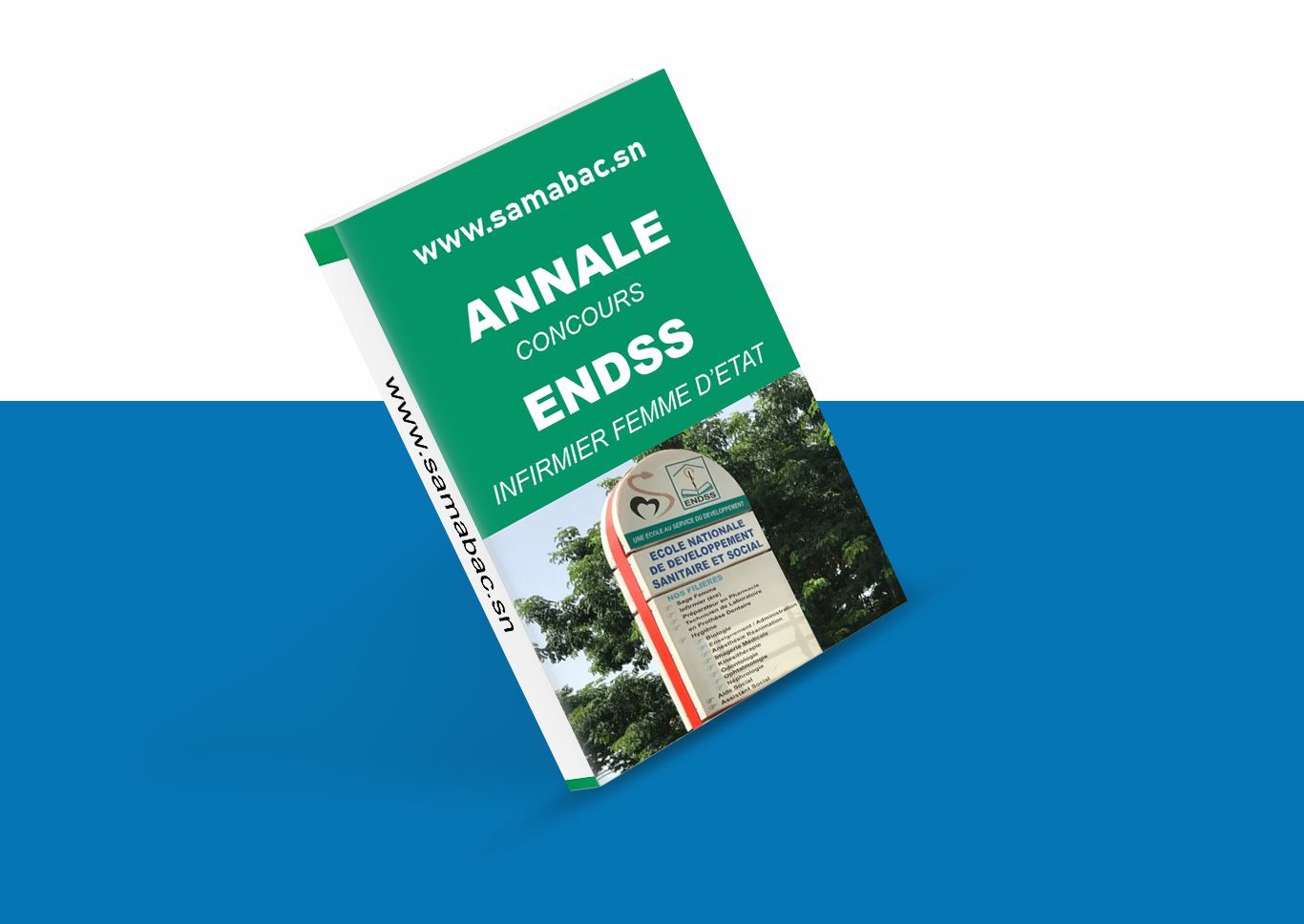
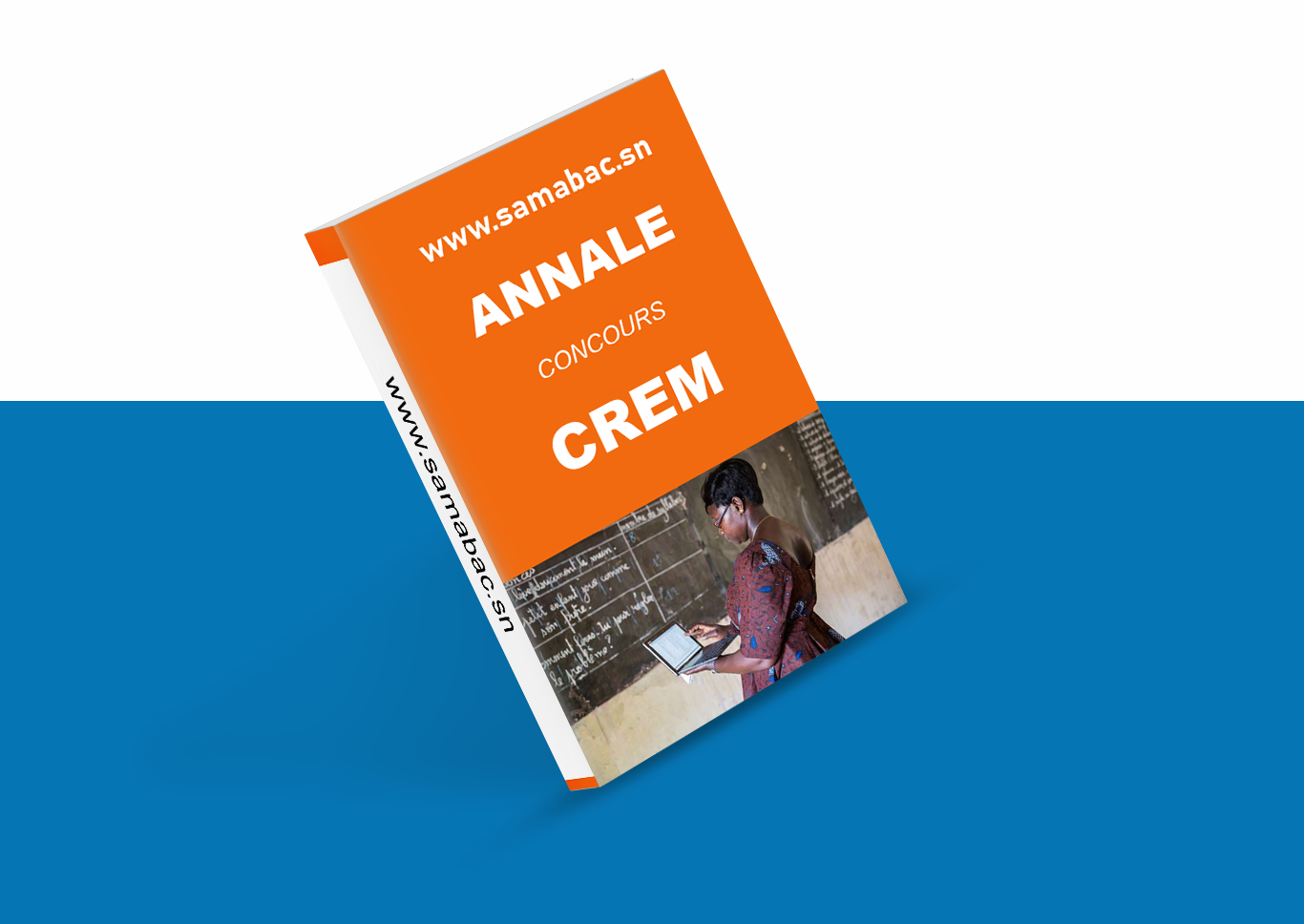

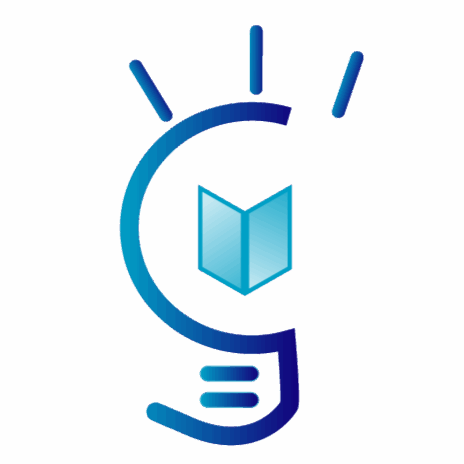



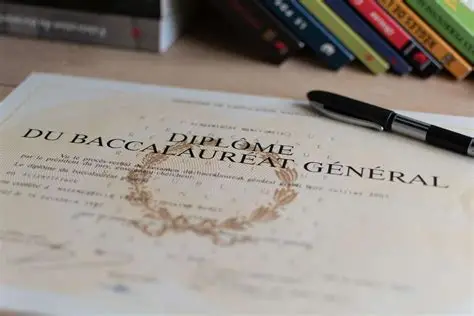
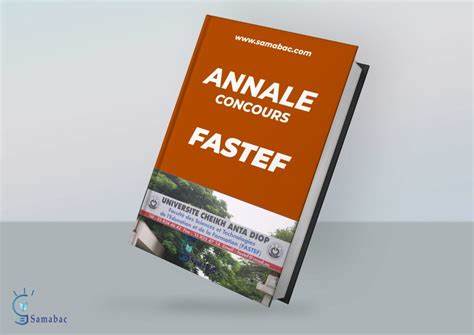




.jpeg)