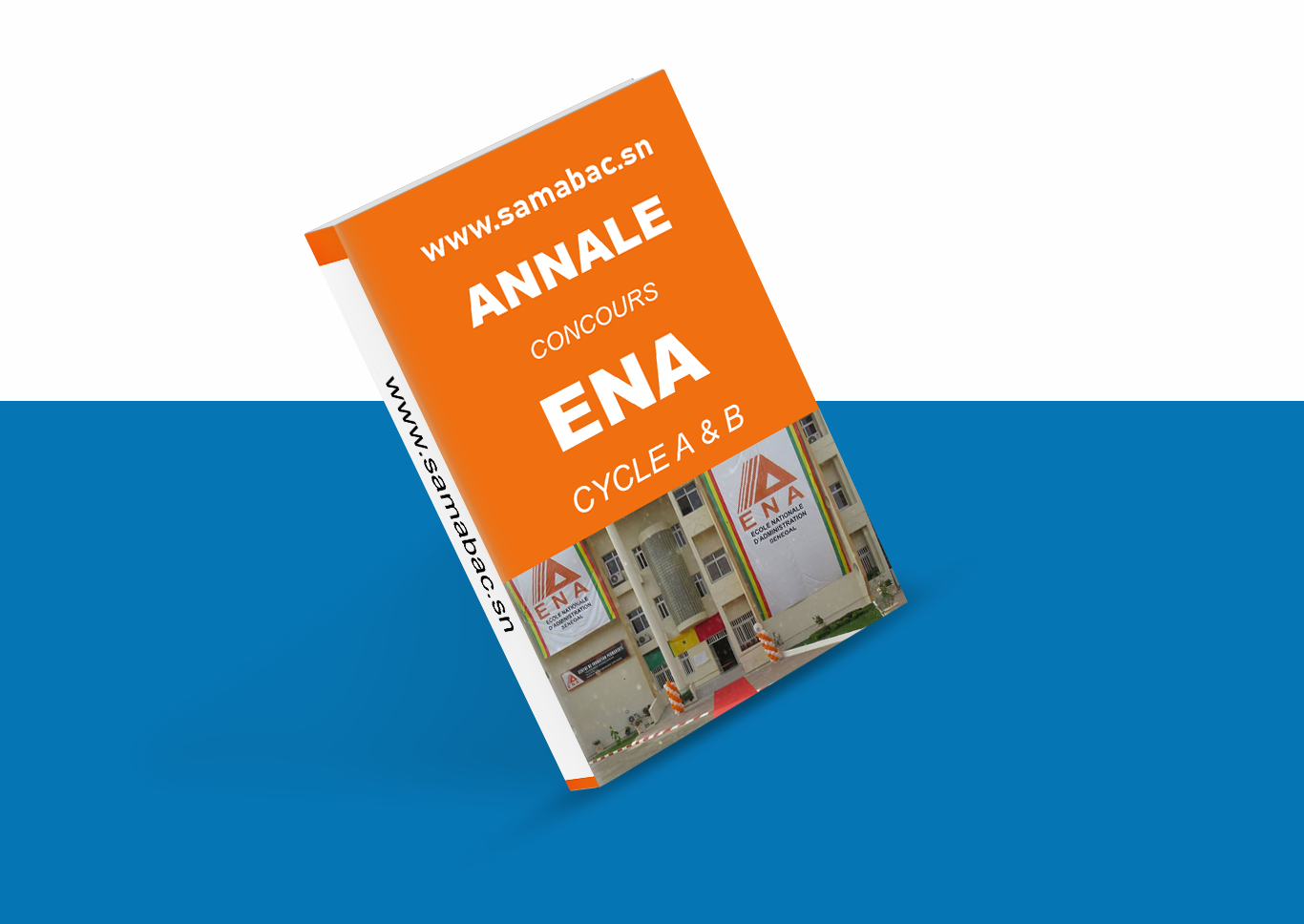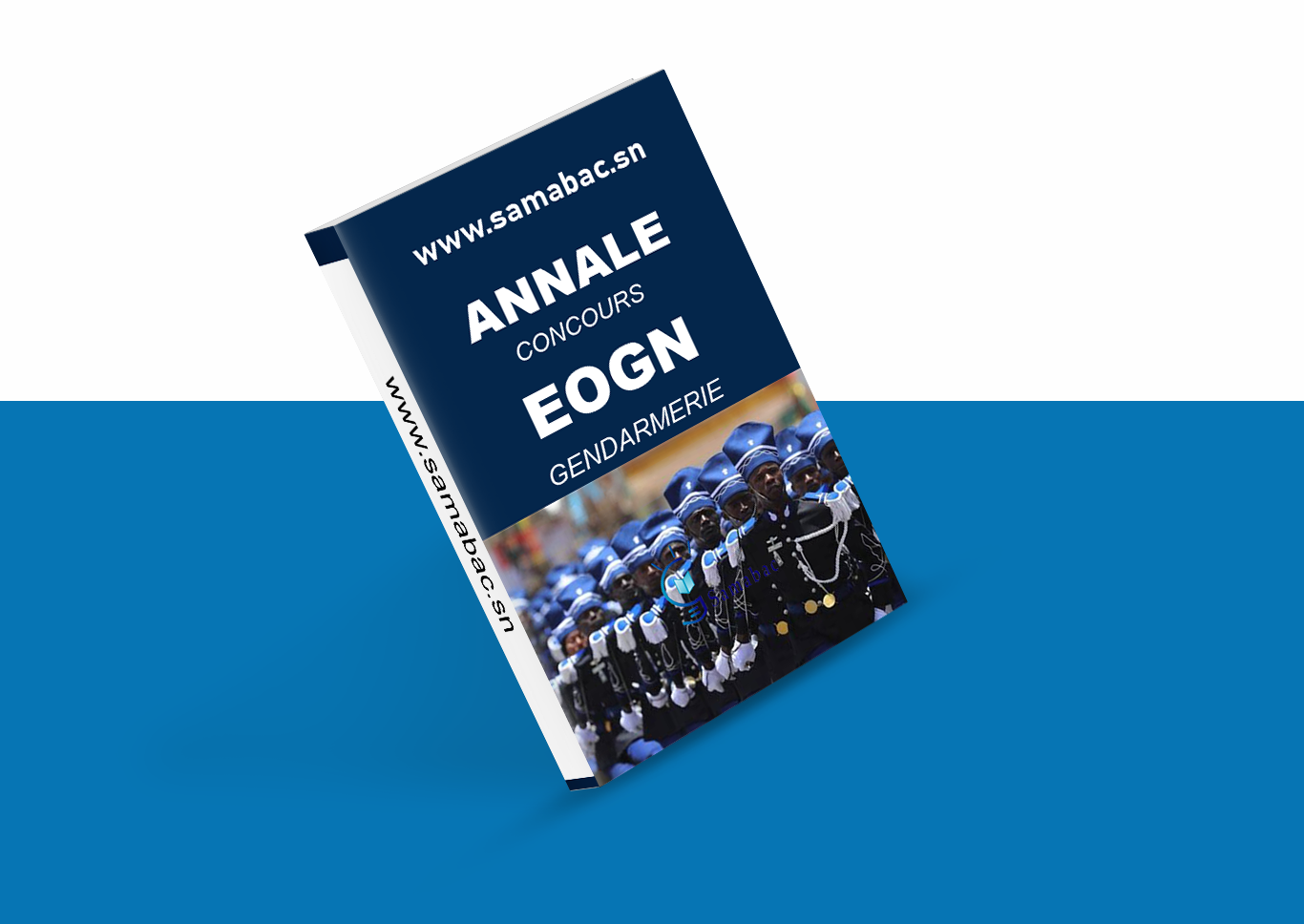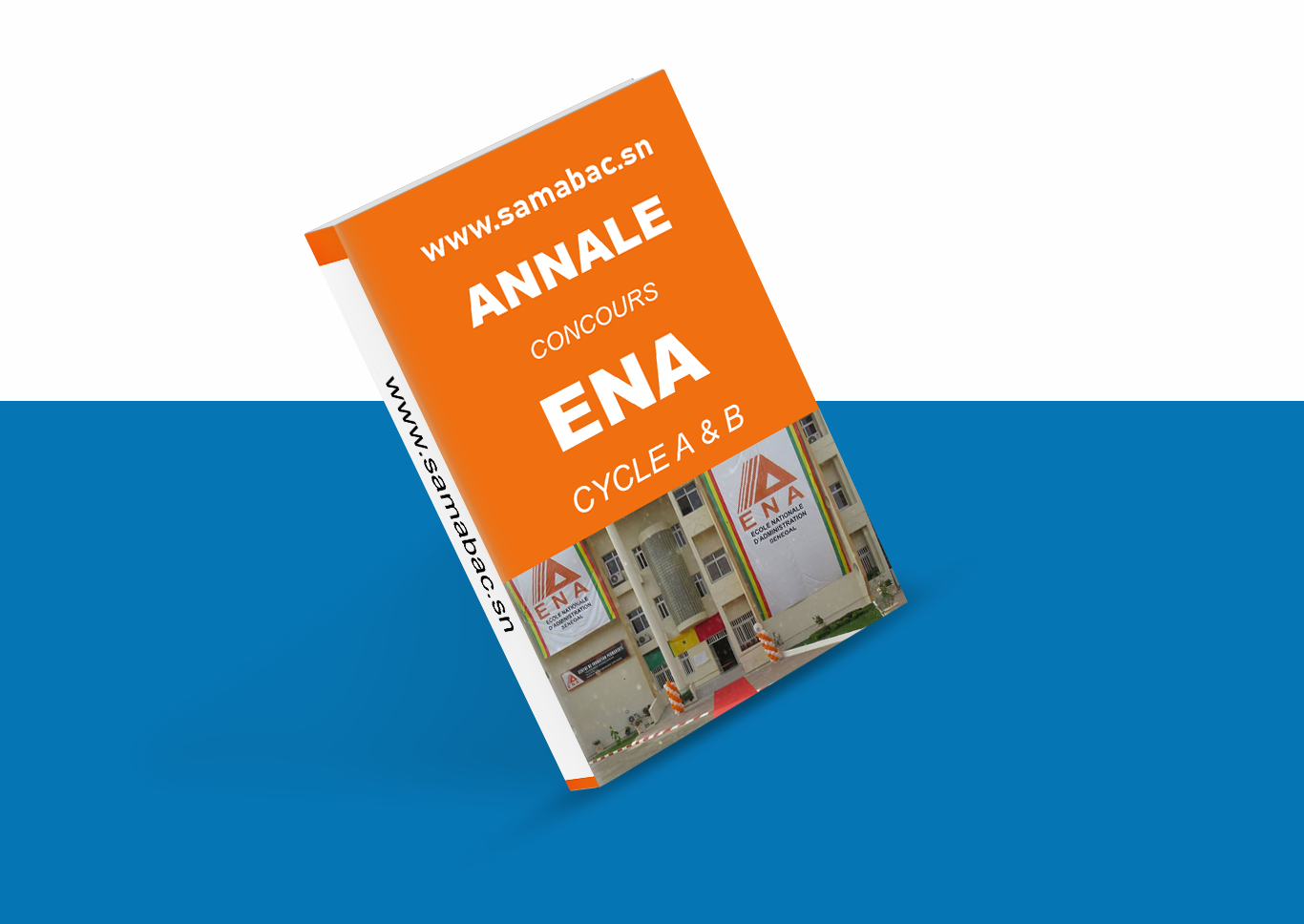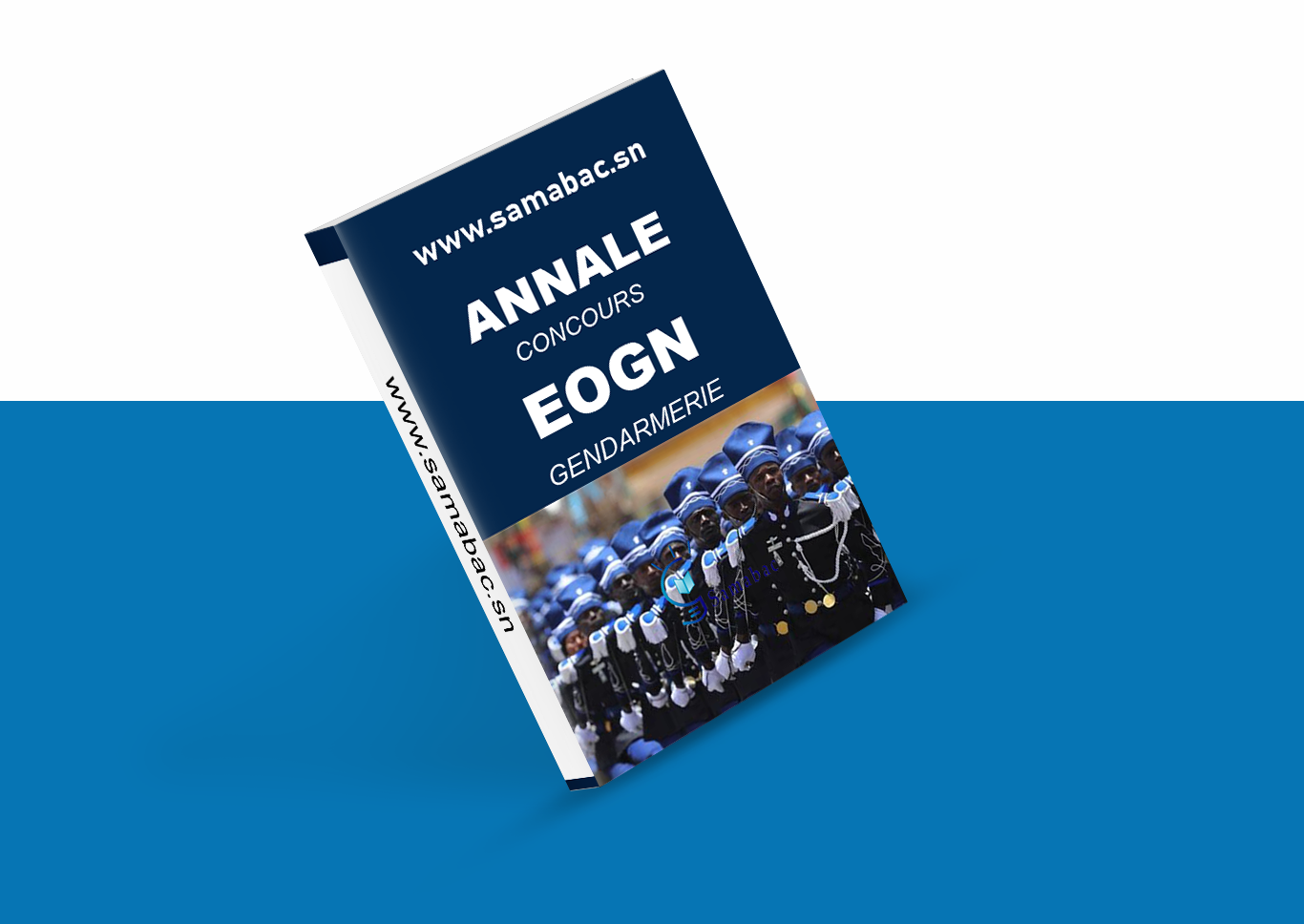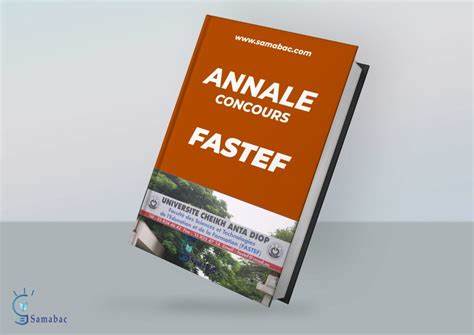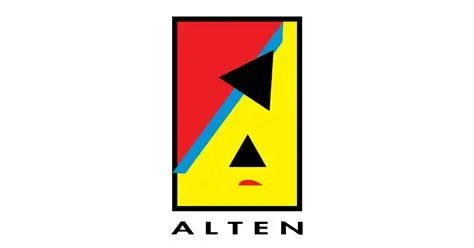CORRECTION DE L’EXERCICE DE
Q.C.M sur LE SIÈCLE des LUMIÈRES
1. APRÈS LES QUERELLES DE SUCCESSION AU POUVOIR SUITE À LA MORT DE LOUIS XIV EN 1715, LE MONARQUE LIBERTIN DEVENU ROI EST :
- Philippe d’Orléans
Lorsque Louis XIV meurt à l’âge de 72 ans, ses enfants et petits-enfants sont déjà morts. Le petit garçon prénommé Louis, son arrière-petit-fils âgé de 5 ans est trop jeune pour prendre la tête du gouvernement. C’est donc son cousin, le duc d’Orléans qui assure la régence du royaume pendant 7 ans. Par ailleurs, dès que le jeune Louis XV atteint l’âge de 13 ans, il fut installé sur le trône et la régence prit fin.
Mais même si on doit lui reconnaître une politique intérieure et étrangère éclairée, Philippe d’Orléans entretient lors de sa régence des mœurs légères : partout, dans les salons, le palais, les salles de spectacles, c’est la fête au quotidien, la débouche permise ou instituée en péché mignon. Se creuse alors et davantage un écart social très considérable entre riches et pauvres. Heureusement que ces endroits réuniront par la même occasion des hommes d’esprit qui confrontent leurs idées afin de leur donner des proportions de réalité plus palpables qui conduiront à la Révolution française de 1789.
2. CET ESPRIT LIBERTIN DU ROI FUT PARTICULIÈREMENT RAILLÉ PAR :
- Beaumarchais dans Le mariage de Figaro
En effet, ses excès libertins inspirent à certains écrivains de cette époque des œuvres satiriques telles que fut le projet d’écriture, mais sans se découvrir, de la pièce de Beaumarchais intitulée Le Mariage de Figaro. La critique voit derrière cette œuvre dramatique la dénonciation de l’abus de pouvoir immoral lié aux privilèges du hasard de la naissance qui président aux choix des hommes à des postes de responsabilité. Voilà sans doute pourquoi le valet Figaro affronte son maître pour rompre le pacte social qui déterminait leurs relations.
Par ailleurs, d’autres écrivains sauront se délecter autrement de ce libertinage, c’est-à-dire en en apportant la preuve puisqu’ils en ont fait une source d’inspiration tout en suivant le monarque dans le même sillage : Choderlos de Laclos, Crébillon Fils, le Marquis de Sade…
3. CETTE MÉTONYMIE OU MÉTAPHORE DE L’HOMME MODERNE SORTI DES TÉNÈBRES DE L’IGNORANCE POUR TENDRE VERS UN ESPRIT CRITIQUE PLUS ÉCLAIRÉ, C’EST :
- les Lumières
Fondée sur la connaissance rationnelle et l’idée de liberté, la raison éclairée constitue ce qui apporte le bonheur à l’homme sur terre. C’est pourquoi, s’étendant de la mort de Louis XIV en 1715 à la Révolution française de 1789, cette période révolutionnaire rejettera cette étroitesse d’esprit non conforme à la raison, telle que la superstition (explication non rationnelle des phénomènes naturelles), l’obscurantisme (le rejet de toute idée qui conduit vers un mieux-être, quitte à se sentir désormais à l’étroit dans sa zone de confort), ces attitudes qui sont aux antipodes de la raison d’où sort la lumière de la vérité.
4. L’ESPRIT DE CEUX QUI S’OPPOSENT À LA DIFFUSION DES CONNAISSANCES, DE L’INSTRUCTION, DE LA CULTURE DES MASSES, EST DÉNOMMÉ :
- l’obscurantisme
Dérivé de « obscurant », issu du latin « obscurus » qui signifie « sombre, ténébreux », l’obscurantisme désigne, de manière péjorative, cette attitude, opinion ou doctrine considérée comme rétrograde et opposée au progrès de la raison dans les domaines de la science, de la morale. Un obscurantiste s’oppose par exemple à la propagation des nouvelles théories scientifiques.
5. LES HOMMES DE LETTRES OU D’ESPRIT DE CETTE ÉPOQUE APPELÉS « philosophes des Lumières » ÉTAIENT :
- libertaires
Même si tous ces mots ont pour racine le mot « liberté », il convient de vite lever l’équivoque sur leur sens et leur emploi.
« Libertaire » est l’adjectif qualificatif qui désigne celui qui ne reconnait aucune limite à la liberté individuelle en matière sociale. Poussé à bout, il arrive souvent que cet esprit libertaire soit anarchiste. Il est exactement l’opposé du mot « liberticide », c’est-à-dire celui qui tue les libertés. Qu’en est-il de « libertin » ? Reprenons qu’à l’image de Philippe d’Orléans, c’est celui qui agit en toute indépendance par rapport aux mœurs, aux normes sociales et religieuses.
6. L’OUVRAGE COPRODUIT OÙ ÉTAIT CONDENSÉE LA PENSÉE PHILOSOPHIQUE DE CES HOMMES QUI REDÉFINISSENT LES TERMES DE RÉFÉRENCE D’UNE SOCIÈTÉ IDÉALE SE NOMME :
- le dictionnaire encyclopédique
Quatre incontournables rédacteurs de l’encyclopédie dont les noms riment méritent d’être retenus : Diderot, Rousseau, D’Alembert, Voltaire. Voici les propos du dernier nommé à ce sujet : « le siècle passé a mis celui où nous en sommes en état de rassembler en un corps et de transmettre à la postérité le dépôt de toutes les sciences et de tous les arts… Il a été commencé par Diderot et d’Alembert, traversé et persécuté par l’envie et l’ignorance, ce qui est le destin de toutes les grandes entreprises ». Le gigantisme du projet est donc de dresser un bilan organisé des connaissances et de brosser un « tableau général des efforts de l’esprit humain dans tous les domaines et dans tous les siècles ». Mais comme le prévoyait Voltaire, les rédacteurs se heurteront à la vindicte de l’Etat et de l’Eglise qui sentaient leur pouvoir affaibli par des idées qui allaient à l’encontre des lois et des dogmes.
7. PARMI CES ŒUVRES, SEULE UNE N’A PAS ÉTÉ ÉCRITE PAR VOLTAIRE. C’EST :
- Paul et Virginie
L’auteur de ce roman publié en 1788 est Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre. Comme Roméo et Juliette, l’un étant l’incarnation de la générosité et l’autre celle de la vertu, Paul et Virginie sont le symbole de la jeunesse et de l’amour parfait. Leurs mères rejetées par la société se sont réfugiées dans une île et élèvent ensemble leurs enfants. Ces derniers se sont aimés plus que comme frère et sœur. Malheureusement, l’effondrement de leur amour au bord de l’eau émouvra plus d’un lecteur. On a l’impression que l’auteur narrativise autrement la pensée de Rousseau selon qui l’homme naît bon mais c’est la société qui le corrompt.
8. L’AUTEUR DU ROMAN INTITULÉ Les Confessions, C’EST :
- Rousseau
Dès la préface de ce roman paru en 1782, pour assumer le caractère sincèrement autobiographique de ses écrits, l’auteur fait ce serment : « je forme une entreprise qui n’eut jamais d’exemple et dont l’exécution n’aura point d’imitateur. Je veux montrer à mes semblables un homme dans toute la vérité de la nature ; et cet homme, ce sera moi. Moi seul ». Avec deux destinataires, c’est-à-dire le lecteur et Dieu, cette œuvre prétend donc être unique, authentique et tout simplement humaine. Ainsi, vers la fin du siècle, comme Bernardin de Saint-Pierre, malgré le bouillonnant projet d’actualité raisonné des Lumières, des auteurs ont opté pour cette tendance plus tard dénommée « préromantisme » et résolument liée à la sensibilité.
9. L’ŒUVRE D’UN ÉCRIVAIN CONTESTATAIRE DE CETTE ÉPOQUE RISQUAIT :
- la censure
Ce n’est pas une œuvre qui s’expose à l’exil ou encore à l’emprisonnement mais plutôt son auteur. Donc pas de confusion même si le dénominateur commun est la sanction. Cette l’interdiction de publication d’une œuvre d’art appelée la censure a connu diverses raisons mais à l’époque du siècle des Lumières tellement contestataire, la plus en vogue est celle relative à une œuvre qui s’attaque à l’Etat à la noblesse ou au clergé. Voltaire en a surtout payé les frais, lui qui a connu tellement de sanctions sur ses ouvrages polémiques plusieurs fois censurés ou sa propre personne (embastillement, bastonnade, exil en Angleterre…).
10. PUISQUE PROTESTATAIRE OU DU RÉGIME OU DE L’ÉGLISE, AFIN D’ÉCHAPPER À DES SANCTIONS AUXQUELLES ILS S’EXPOSENT, DES ÉCRIVAINS ONT IMAGINÉ DES SUBTERFUGES POUR SE TIRER D’EMBARRAS ; CELUI ADOPTÉ PAR VOLTAIRE EST :
- la production d’écrits apparemment anodins : les contes philosophiques tels que Zadig (1748), Micromégas (1752) ou encore Candide (1759) constituent des récits imaginaires à vocation fortement didactique. Ce dernier nommé par exemple est très ironique, voire extrêmement engagée ; l’auteur s’en prend à la noblesse, à l’optimisme illusoire, au fanatisme religieux, à l’esclavage… même s’il n’en donne pas toujours l’air puisqu’il s’agit d’un conte à l’image à peu près des fables de Jean de La Fontaine.
- la parution d’ouvrages à l’étranger : en 1726, suite à la querelle entre Voltaire et le chevalier de Rohan, le séjour d’exil pendant trois ans en Angleterre inspire à cet auteur son admiration sans condition du régime parlementaire britannique qu’il oppose à la monarchie absolue régnant en France ; il publie Les Lettres anglaises (1734). L’auteur ne sera pas arrêté ni nullement inquiété puisque l’Angleterre restera une terre d’asile pour tous les exilés mais son œuvre sera aussitôt censurée avec l’interdiction formelle du parlement français d’en faire la diffusion.
- la pseudonymie : Voltaire s’appelle François-Marie Arouet et surnommé « AROUET L.J » (Le Jeune). Ces mêmes dernières lettres (« AROUET L.J ») servent à former le faux nom VOLTAIRE qui est donc son anagramme, à l’image de François Rabelais (Alcofribas Nasier). A rappeler qu’au XVIIIème siècle, on écrivait encore v au lieu de u et i au lieu de j, comme en latin.
Au final, Voltaire a expérimenté tous ces subterfuges afin de rester hors d’atteinte pendant longtemps, en se mettant sous le couvert de l’anonymat, en faisant paraître des œuvres à l’étranger ou encore en feignant d’amuser tout simplement son public.
Issa Laye Diaw
Donneur universel
WhatsApp : +221782321749
Lien de la page Facebook :
https://www.facebook.com/profile.php?id=100044574573212