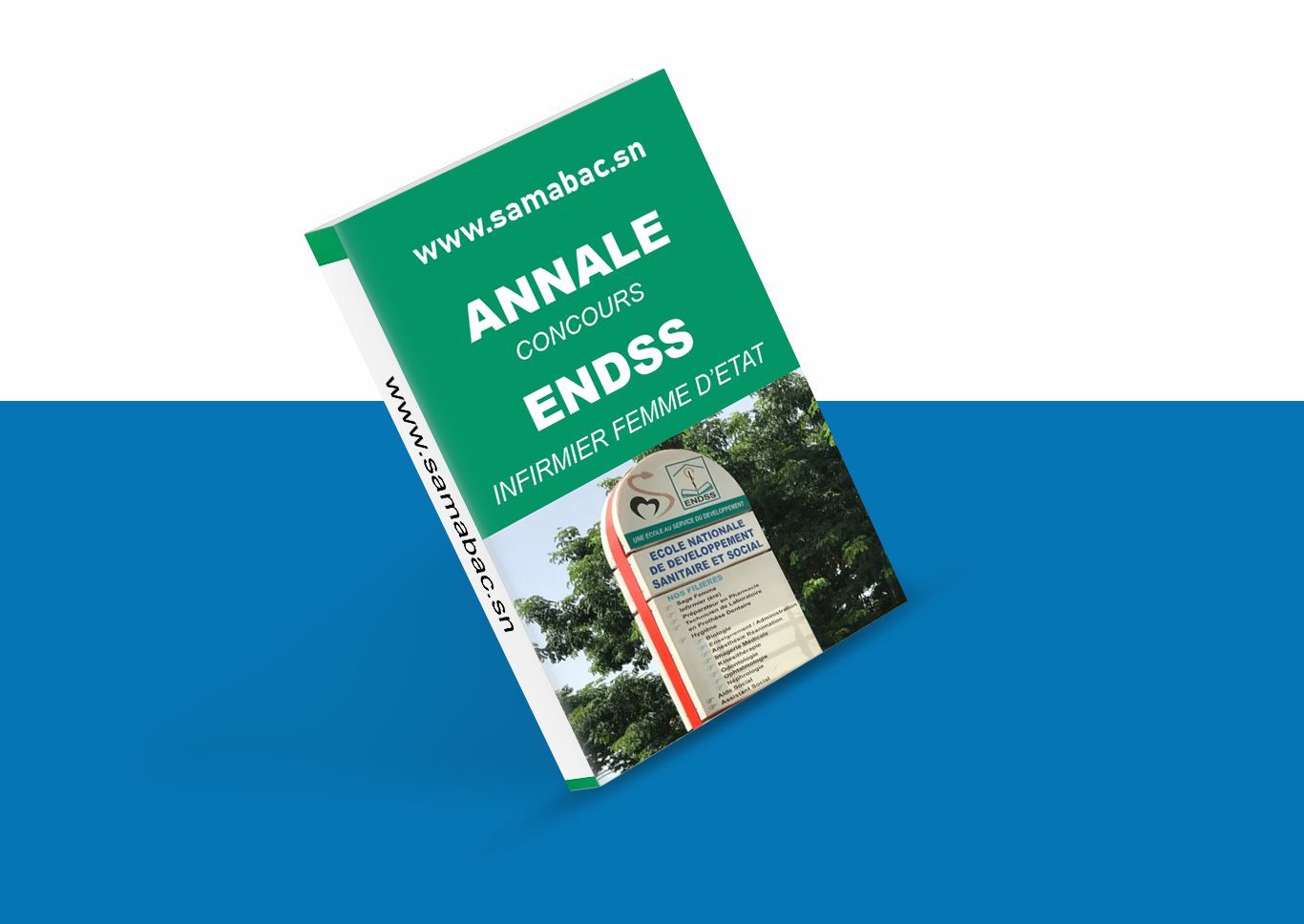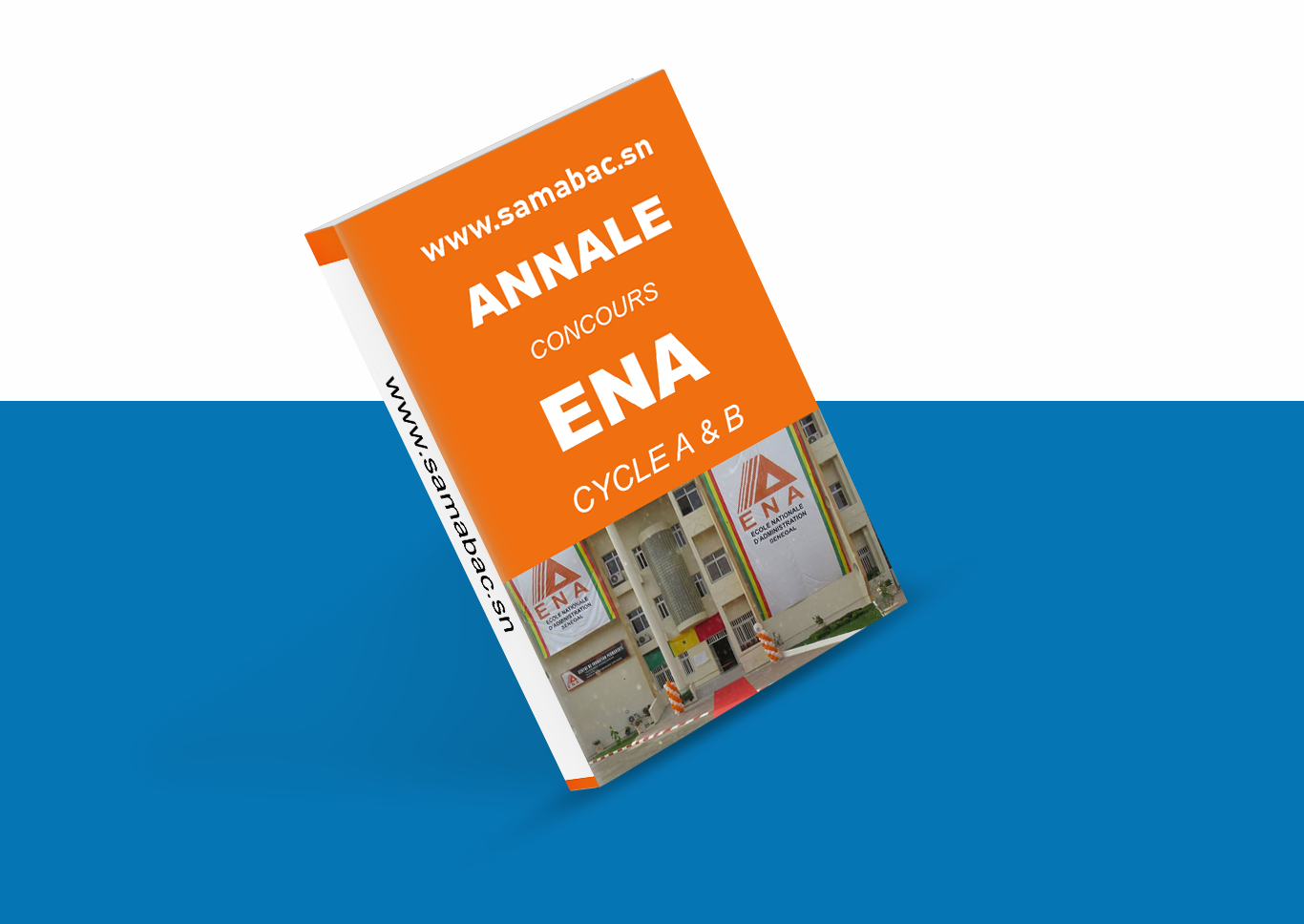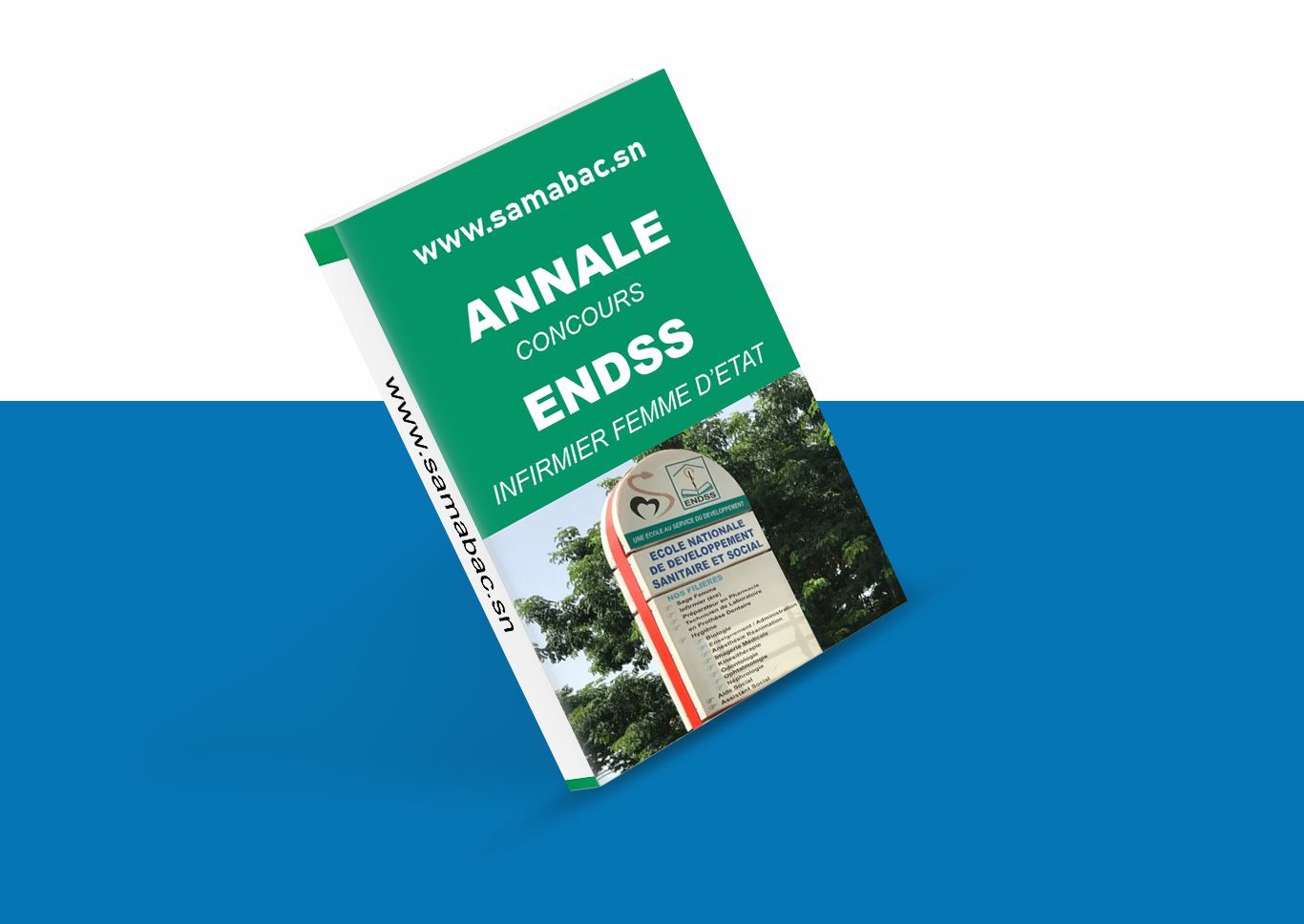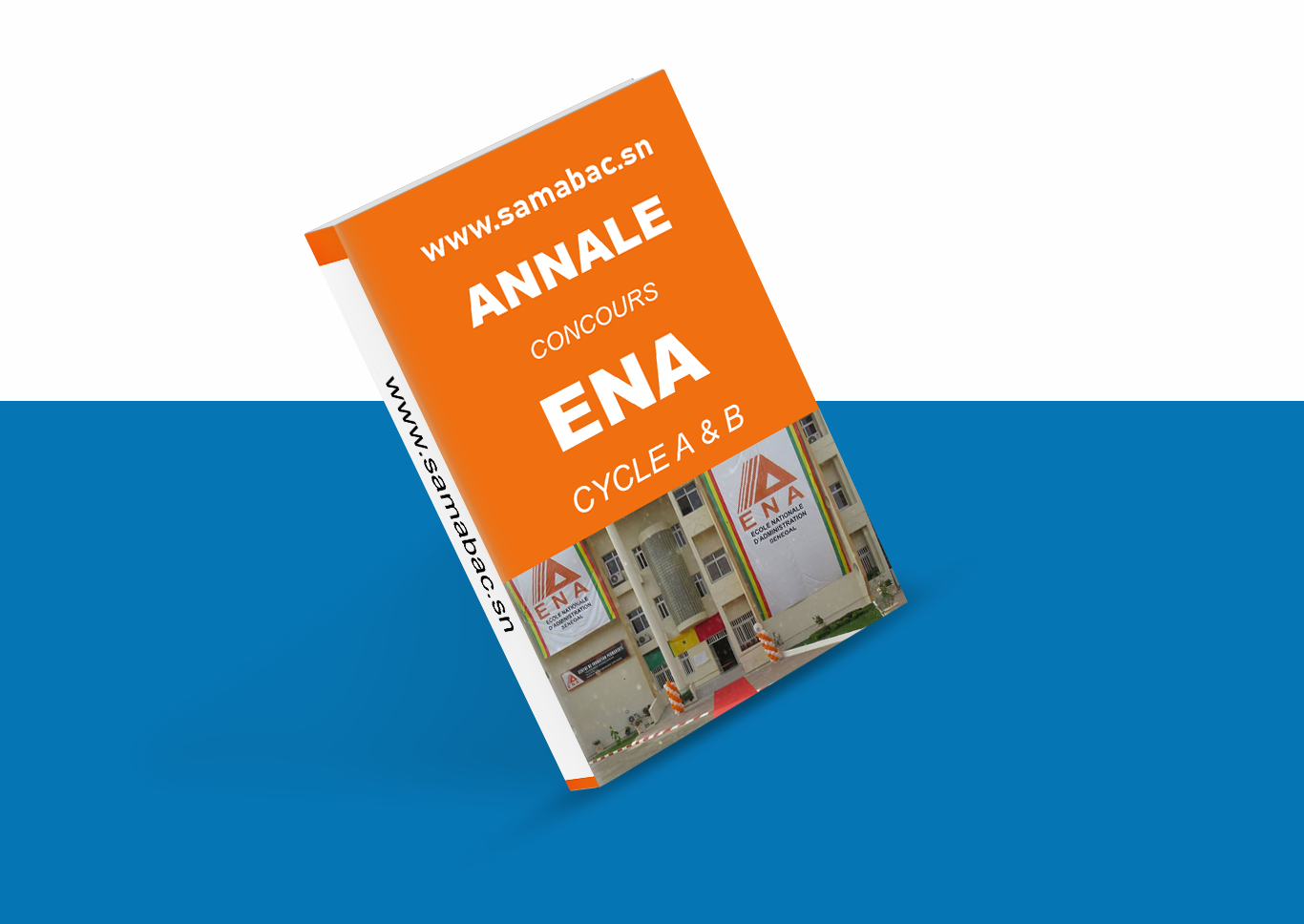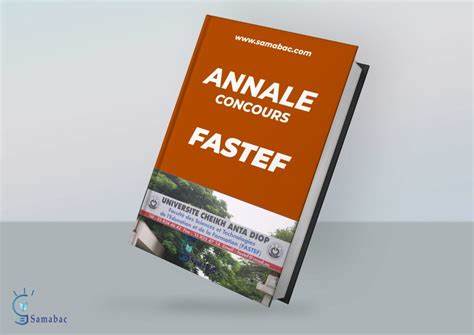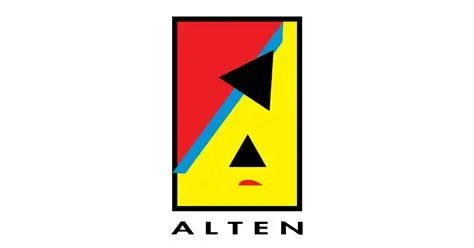Sujet corrigé de philosophie : La science peut-elle résoudre toutes les interrogations ?
Correction :
Les grandes parties:
1- Les sciences sont-elles l’unique mode de réponse aux questions que l’Homme se pose ?
a) Partons de l’idée commune selon laquelle la pensée scientifique est le seul moyen d’atteindre des connaissances vraies. Bien sûr, il est toujours possible de donner une réponse à toute question. Mais encore faut-il que cette réponse soit correcte, valide, vraie, c’est-à-dire acceptable pour tous les esprits qui l’examinent, et non pas une simple opinion.
Qu’est-ce donc, que répondre à une question de manière scientifique ?
Il s’agit d’utiliser des méthodes sûres d’accès à une vérité que sont la démonstration et la preuve expérimentale. Moyennant l’utilisation de ces méthodes, la vérité d’une connaissance est garantie, établie, la réponse obtenue est de l’ordre de la certitude.
b) La démonstration est un processus de l’esprit rationnel qui permet de s’assurer de la vérité d’une idée par la liaison déductive établie avec d’autres idées mieux connues. Aristote la définit ainsi : « un discours dans lequel certaines choses étant posées, quelque chose d’autre s’en suit nécessairement. » (Analytiques I).
Une vérité démontrée est nécessaire car déduite logiquement d’autres vérités qui la fondent. Le syllogisme est la forme canonique de la démonstration étudiée par Aristote. La science où les démonstrations sont les plus parfaites sont les sciences formelles, logique et mathématiques.
c) La puissance de conviction de la démonstration a conduit les penseurs modernes à vouloir l’ériger en modèle de toute science. Ainsi, on la retrouve au niveau des sciences expérimentales.
En effet, les sciences de la nature tentent de déduire la connaissance de certains événements à partir de lois de la nature qu’elles ont établies grâce à l’expérimentation inductive.
Mais les penseurs modernes ont également tenu pour possible de répondre de manière scientifique aux questions métaphysiques, d’ordinaire réservées à la méditation philosophique et à la religion, concernant des objets inaccessibles à l’expérience sensible (Dieu, l’âme, la liberté).
L’idéal d’une métaphysique scientifique se retrouve ainsi chez Descartes par exemple, dans l’usage qu’il fait de la preuve ontologique de l’existence de Dieu.
Preuve, a priori, qui ne met pas en jeu une expérience de la divinité et qui s’appuie uniquement sur le raisonnement démonstratif à partir du concept de Dieu. Dieu étant défini comme l’être souverainement parfait, il serait moins parfait s’il n’existait pas, donc, l’être souverainement parfait ne peut pas ne pas exister.
Cependant peut-on se satisfaire de cette vision impérialiste du mode de connaissance scientifique ?
2- La connaissance scientifique est-elle sans limites ?
a) Le projet d’une science métaphysique a rapidement été contesté. Naturellement d’abord par les philosophes sceptiques. Hume, par exemple, a remis en cause le cogito cartésien en montrant que la conscience ne donnait nullement accès à un moi intérieur unifié.
Réveillé dans son « sommeil dogmatique » par les analyses huminennes, Kant a cherché, dans la Critique de la raison pure à établir les limites du pouvoir de connaître de l’entendement seul, c’est-à-dire, hors de l’appui de l’expérience sensible.
Dans l’un de ses textes il en vient ainsi à critiquer les tentatives rationalistes pour prouver l’existence de Dieu. Selon lui, on ne saurait déduire une existence d’une essence. Ainsi, il est impossible de prouver, ni l’existence de Dieu, ni son inexistence. Les questions que l’on se pose au sujet des objets métaphysiques ne sont pas susceptibles d’obtenir une réponse de type scientifique.
b) Le positivisme scientifique s’est ainsi construit sur l’idée que la science ne pouvait apporter des réponses qu’en ce qui concerne des objets d’expérience possible, des faits.
Pour Auguste Comte dans son Cours de philosophie positive, la science doit se contenter d’expliquer « comment » les phénomènes naturels et humains se produisent et ne jamais chercher à donner réponse à la question « pourquoi » ils se produisent ainsi et pas autrement, ce qui relève d’une interrogation métaphysique.
c) Cependant, faut-il pour autant renoncer à s’interroger sur
les grandes questions métaphysiques ? Le fait qu’elles ne soient pas justiciables d’une réponse de type scientifique, démontrée ou prouvée par l’expérience, les rend-elles nulles et non avenue ?
3- En quoi est-il nécessaire de penser les questions qui n’ont pas de réponse scientifique ?
a) Kant, ayant établi les limites du pouvoir de
connaître de la raison humaine et interdit le domaine métaphysique à son investigation, n’est pas pour le fossoyeur de la métaphysique. Au contraire, il s’estime l’avoir sauvé.
En effet, s’il n’est pas possible effectivement d’établir un savoir, de connaître ce qu’il en est des objets métaphysiques (l’âme humaine est-elle immortelle, Dieu existe-t-il, l’Homme est-il libre ?), il est néanmoins capital de les penser.
Autrement dit, il faut distinguer le domaine des questions simples, auxquelles on peut espérer trouver une réponse unique vraie, et les problèmes, qui, selon la définition d’Aristote, sont « les questions au sujet desquelles il existe des raisonnements contraires ».
Ainsi, il existe des objets au sujet desquels nos questions sont essentiellement problématiques, au sens où on ne peut espérer leur donner une réponse simple et exclusive. Les objets métaphysiques sont de ceux-là. Mais si on ne peut espérer obtenir une certitude scientifique à leur égard, il n’empêche qu’il est nécessaire de les penser, de les méditer.
b) Cela est nécessaire notamment du point de vue pratique.
Les enjeux pratiques concernant les questions que nous avons évoquées sont, en effet, capitaux. Se penser comme libre, penser qu’un Dieu existe peut donner sens à l’existence et à l’action humaine. Il peut donc être considéré, si l’on suit Kant, que l’existence de Dieu est une vérité moralement nécessaire. Ainsi, la réponse donnée à cette question n’est pas une certitude scientifique mais une certitude morale.
c) Il faut donc distinguer l’ordre pratique et l’ordre théorique.
La science est du domaine théorique de la vérité des connaissances. Tandis que du point de vue existentiel, moral, pratique, des questions se posent, qui nécessitent qu’on leur apporte des réponses bien que celles-ci ne puissent être de type scientifique.
Conclusion
Il existe donc bien des questions essentielles
(métaphysiques, existentielles, religieuses…), qui ne relèvent pas du régime de réponse scientifique, à commencer certainement par la question que pose le sujet auquel nous venons de répondre !
Corrigé réalisé par Monsieur Benjamin Derbez, professeur de philosophie
TELECHARGER